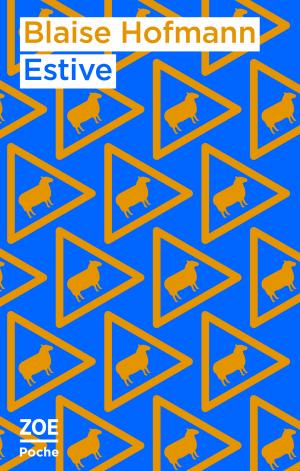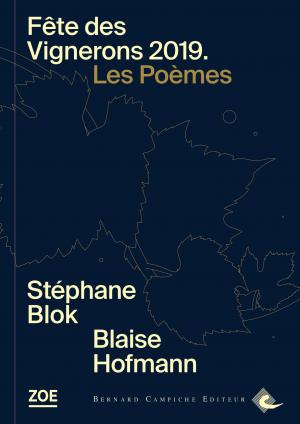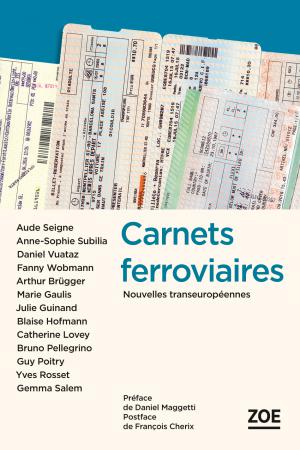parution mai 2011
ISBN 978-2-88927-768-1
nb de pages 208
format du livre 105 x 165 mm
prix 0.00 CHF
Estive (poche)
résumé
Le temps d’un été, Blaise Hofmann est devenu berger. Son troupeau, mille brebis, « mille machines à vie » imprévisibles, il a dû l’apprivoiser, tout comme le climat, la solitude et la nature. Reportage dans les Alpes et quête identitaire, Estive est surtout un véritable récit de voyage, manifeste sur le dépaysement à une heure de chez soi.
Né à Morges en 1978, Blaise Hofmann est l’auteur d'une dizaine de romans et récits de voyage. Il reçoit en 2008 pour Estive le Prix Nicolas-Bouvier au festival des Étonnants voyageurs de Saint-Malo. Ses derniers ouvrages sont Marquises (2014), Capucine (2015), Monde animal (2016), Deux petites maîtresses zen (2021) et Faire paysan (2023).. Chroniqueur dans divers journaux suisses romands, il écrit aussi régulièrement des pièces de théâtre et des livres jeunesse, dont Les Mystères de l’eau (2018) et Jour de Fête (2019). En 2019, il a été l'un des deux librettistes de la Fête des Vignerons.
Blaise Hofmann, lauréat du prix Nicolas Bouvier 2008 pour "Estive"
Info Levallois
"Contemplatif et résolument moderne, ce carnet de route fait partager au lecteur l’expérience d’un jeune homme confronté à la dureté et à la beauté de la vie des paysans et des bergers, et qui s’interroge sur l’écologie, l’exotisme des métiers ruraux et la solitude. Bien que cette histoire soit vécue, il ne s’agit pas d’un témoignage mais d’un texte littéraire comme une invitation à l’introspection, au voyage immobile..."
"Vous rêvez "d’aventures exotiques" près de chez vous, de devenir berger le temps d’un été... Ce livre est pour vous !! Blaise Hofmann nous confie avec délicatesse et drôlerie son expérience de gardien de mille brebis au cœur des Alpes. Ça décoiffe : ) )"
"Quittez tout et devenez berger dans les Alpes!"
Faire paysan (2024)
Entre le monde agricole et la population des villes, le dialogue semble rompu. On s’accuse mutuellement de ne rien connaître à la terre ou de l’empoisonner à coups de pesticide, et l’urgence climatique ne fait qu’envenimer la situation. Fils et petit-fils de paysans, devenu écrivain, Blaise Hofmann part à la rencontre de celles et ceux qui pratiquent encore le «plus vieux métier du monde». Le portrait qu’il en dresse, entre humour, tendresse et indignation, se lit comme une enquête sur notre époque.
Faire paysan (2023, domaine français)
En ces temps de crise écologique, les paysans ont mauvaise presse. Le fossé se creuse entre eux, qu'on accuse d'empoisonner la terre, et une population urbaine qui aspire à une autre relation à la nature mais ne distingue pas un épi d'orge d'un épi de blé.
Lorsque Blaise Hofmann, fils et petit-fils de paysans, revient vivre à la campagne, il est le témoin direct de ces tensions. Lui qui a voyagé dans le monde entier part à la rencontre de celles et ceux qui, tout proches de lui, pratiquent encore le "plus vieux métier du monde", qui est "aussi le plus essentiel". Avec humour et tendresse, porté par une indignation grandissante, il emprunte les voies du reportage sur le terrain et d'une réflexion plus intime pour brosser le portrait d'un monde agricole qui se révèle, contre les idées reçues, en constante réinvention de lui-même.
Deux petites maîtresses zen (2021, domaine français)
Japon, Cambodge, Laos, Birmanie, Thaïlande, Sri Lanka, Inde. En septembre 2019, l’écrivain-voyageur Blaise Hofmann s’en va sept mois en Asie, pour la première fois en famille. Ce sont de nouvelles contraintes, un temps constamment anticipé, des précautions, des routines, des frustrations ; c’est surtout l’émerveillement de voir le monde à quelques centimètres du sol, voyager lentement avec les yeux de deux petites filles qui sont à la maison où qu’elles se trouvent.
C’est l’occasion aussi de retrouver un continent standardisé, peuplé de gens comme lui, des touristes hypermodernes. Voici le récit d’un anti-héros faisant l’éloge de l’ennui, du détour. Blaise Hofmann livre un texte introspectif, aussi critique qu’ébloui, même quand un virus s’impose comme personnage principal de ce qui est peut-être le dernier récit de voyage d’avant la pandémie de Covid-19.
La Fête (2019, domaine français)
Lorsqu’en 2014, Blaise Hofmann est approché pour co-écrire la Fête des Vignerons 2019, il ignore tout de son histoire, de ses mythes, de la ferveur qu’elle exerce sur les gens depuis des siècles.
La curiosité l’emporte, le voilà catapulté dans l’univers de la Confrérie des Vignerons. Il invite le lecteur dans les coulisses de la Fête, raconte la gestation de cet événement unique au monde, patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, qui n’a lieu que cinq fois par siècle, rassemble 400000 spectateurs, un millier de choristes, des centaines de musiciens, danseurs, gymnastes et 5000 figurants.
Pendant quatre ans, Blaise Hofmann sera tour à tour intrigué, amusé, ému, furieux, perdu, passionné, épuisé, émerveillé. On découvre avec lui une communauté pétrie de traditions, des hommes et des femmes amoureux de la nature, de la terre. On suit le cycle des saisons et celui de la vigne. Et on accompagne l’auteur, touché au cœur, qui décide de reprendre une petite vigne familiale.
Fête des Vignerons 2019. Les poèmes (2019, domaine français)
Depuis 1797, le temps d’un été par génération, la place du Marché de Vevey accueille la Fête des Vignerons et son spectacle. Voici le livret de l’édition 2019, écrit pour la première fois de son histoire à quatre mains.
Au fil des poèmes qui le constituent, on retrouve le cycle des saisons et la terre, les hommes et les femmes qui exercent les travaux de la vigne. À la manière d’une treille, ce texte entremêle le régional et l’universel, le traditionnel et le contemporain, le concret et l’onirique. Un éloge des sens, de la lenteur, du vivre ensemble, de la nature, du « repaysement ».
Carnets ferroviaires. Nouvelles transeuropéennes (2017, domaine français)
Que ce soit de Lausanne à Paris, de Vienne à Genève ou de Glasgow à Londres, chacun des treize auteurs de ce recueil situe son histoire à bord d’un train qui parcourt l’Europe. À l’occasion d’un long trajet en chemin de fer, l’une se souvient de son voyage dix ans plus tôt, elle traque la différence entre son être d’hier et d’aujourd’hui. Un autre se remémore la géniale arnaque dont il a été l’auteur, un troisième retrace l’incroyable hold-up ferroviaire du South West Gang dans l’Angleterre de 1963.
Ces nouvelles donnent une vue d’ensemble inédite sur la manière de concevoir l’Europe comme espace physique et symbolique. Les auteurs étant de générations très diverses, le lecteur appréciera les différentes manières d’appréhender notre monde proche et de s’y situer.
Nouvelles de Aude Seigne, Blaise Hofmann, Anne-Sophie Subilia, Gemma Salem, Bruno Pellegrino, Arthur Brügger, Daniel Vuataz, Marie Gaulis, Fanny Wobmann, Catherine Lovey, Julie Guinand, Guy Poitry, Yves Rosset.
Préface de Daniel Maggetti, postface de François Cherix
Capucine (2015, domaine français)
Elle était l’un des modèles parisiens incontournables des années cinquante, puis l’actrice de Federico Fellini, Georges Cukor, Blake Edward, Joseph Mankiewicz. Elle a joué avec John Wayne, Woody Allen, Jane Fonda, Romy Schneider, Claudia Cardinale, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon...
Qui se souvient encore de Capucine ?
Blaise Hofmann part sur ses traces. À Saumur, sous les bombes de la Deuxième Guerre. À Paris, sur les podiums de haute couture et dans les caves à jazz de Saint- Germain-des-Prés. À Los Angeles, dans les fabriques de stars hollywoodiennes. Enfin, à Lausanne, où Capucine passe ses trente dernières années, avant de se donner la mort, le 17 mars 1990.
Ce roman biographique est un conte de fée tragique, cruel et actuel. C’est aussi le récit d’une enquête, un travail de mémoire.
Marquises (2014, domaine français)
Aux antipodes de l’Europe, voici les Marquises, une terre mythique, célébrée par Melville, Brel et Gauguin.
L’espace d’un hiver, Blaise Hofmann a parcouru les six îles habitées de l’archipel des Marquises. Et une île déserte.
Tour à tour bousculé, méditatif, ironique, emballé, il rend hommage à l’hospitalité des Marquisiens, à leur renouveau culturel. Il ne ferme toutefois pas les yeux sur les pick-up Toyota et les poulets aux hormones made in USA.
Blaise Hofmann fait le lien entre le passé de l’archipel et le quotidien d’aujourd’hui, il entremêle légendes insulaires, récits de navigateurs, comptes rendus de missionnaires, romans aventureux, correspondances de colons, presse locale, statuts Facebook et Tweeter. La nature y est aussi un personnage à part entière, une présence sensuelle.
C’est un carnet de route plein d’autodérision. Un regard empathique, curieux, critique et généreux sur ces îles du « bout du monde ».
L'Assoiffée (2009, domaine français)
Ce pourrait être un scénario de road movie, c’est le chemin choisi un beau matin par la narratrice qui décide d’une rupture dans sa vie, d’un départ sans objet ni moyens.
Dès lors un long ruban d’asphalte se déroule devant elle, les campagnes et les bourgs défilent comme un monde d’images tandis que les rencontres sont brèves, parfois rudes parfois douces. L’arrivée à Paris se transforme en un séjour d’une saison où gravitent, dans une ivresse de rencontres, des gueux, des amicaux, des indifférents, des malheureux, un monde où la narratrice pratique la témérité et la compassion. Puis elle largue les amarres de la ville pour se diriger vers l’océan, là où se dissolvent toutes les volontés.
D’une écriture incisive, souvent orale, l’auteur donne vie à une héroïne qui s’échappe de sa vie comme un électron échappe à son orbite pour gagner sa liberté.
Estive (2007, domaine français)
«Que fait un troupeau lorsqu’il est formé ? Il se déforme. Il faut le reformer. Je pense beaucoup à toi, Sisyphe.»
Estive est un récit où l’auteur romance un été de berger en charge d’un troupeau de moutons. Ce carnet de route dans une vallée alpine fait partager au lecteur, tout au long de rencontres inattendues, d’images poétiques et de réflexions philosophiques, le quotidien difficile des paysans et des bergers. Le livre n’est pas seulement un témoignage mais un «récit d’apprentissage».
Ce texte à l’écriture fragmentée, incisive et ironique, interpelle autant la dysneylandisation des Alpes que l’aspect devenu exotique des métiers ruraux de montagne.
Né en 1978, Blaise Hofmann a publié un récit de voyage en 2006, Billet aller simple.
Estive (poche): extrait
Grenier I
Des pas sur le plancher. Deux coups à la porte. Eh mec! C’est l’heure. J’ai dormi comme une masse. Pas besoin de pousser le volet. Il fait encore nuit. Il est cinq heures. Bonjour les chiens. Robert assis à la table. Salut. Un peu d’eau sur le visage. Une tranche de pain. J’y étale quelque chose. Mâchonne sans appétit. Le café bout. Il est trop chaud. J’y ajoute une giclée de pomme. Fais comme Robert. De la Goldamine de Zoug. Conséquent. Je remplis la besace de croquettes. Pour Maya et Fume, les chiens de protection qui ne quittent pas le troupeau. Robert cherche ce qui pourrait lui servir de bâton, s’en allume une et s’en va. Il prend de l’avance. Tu m’rattrapes! Tina et Brina le suivent, lui, car c’est mon deuxième jour d’estive.
Le soleil point derrière la Tour du Famelon. Pas un nuage. Plutôt photogénique. Les profils des sommets sont bien découpés. Robert progresse lentement. Il dessine de larges zigzags. Les pâturages laissés aux moutons sont ceux dont la pente est trop abrupte pour les bovins. Sur la carte, ils se situent là où les lignes sont les plus rapprochées.
Robert, assis dans l’herbe, d’un côté du troupeau. Moi, assis dans l’herbe, de l’autre. Lui avec Tina. Moi avec Brina. Une parole, une seule.
—Début de l’été, les moutons grimpent. Vers la fin, ils vont vers le bas. Ils vont là où l’herbe est bonne.
Tout l’été devant nous pour faire connaissance et pas besoin d’en rajouter.
La matinée durant, on évite que les moutons empruntent le passage de la Chaux, de son côté, ou filent vers le Grand Chalet, du mien. Quand des bêtes dépassent la limite que l’on a choisie, on fait travailler les chiens. —Laisse-les brouter, j’te dis. T’es en train de tout tasser l’herbe avec tes coups d’chien!
Manifestement contrarié, Robert me reproche d’envoyer Brina parfois trop tôt, parfois trop tard, toujours trop brusquement. Non, Robert n’est pas un fin pédagogue. Voilà trois heures que je joue à un jeu dont j’ignore les règles. Le plus sûr est d’imiter ce qu’il fait de son côté, mais le troupeau n’obéit pas à une logique symétrique. Bluffer ne suffit pas. De mon côté, j’ai à faire avec la variable parasite, les Vertes, les bêtes qui portent un point vert sur le dos, environ deux-cents brebis élevées en forêt qui, dès qu’elles le peuvent, vont s’y réfugier. Autour des dix heures, les premières bêtes sont pleines, se couchent et ruminent. D’autres broutent encore, mais presque immobiles. Même les Vertes se sont regroupées à l’ombre d’un pierrier. C’est agréable. Robert en refume une. J’ouvre un bouquin que je croyais écrit sur mesure pour la profession, un petit format qui tient dans la poche, à peine soixante pages, onze chapitres distincts, les Onze lettres à Pénélope.
«Cette lettre-ci, paresseux Ulysse, c’est ta Pénélope qui te l’envoie. Mais ne me réponds pas: viens…»
—Eh colinet, va voir là-bas si ces salopes de Vertes ne foutent pas le camp dans les bois!
À peine le temps de lire l’épigraphe, trois vers d’Ovide. Le livret ouvert, retourné sur la besace, et quelques pas pour contourner le troupeau jusqu’à une butte qui me permet de voir qu’elles sont toutes là.
«Je devine un reproche, comme une sourde angoisse entre tes lignes parce que cette guerre se prolonge.
Mais ce n’est pas ma faute! La dérive a emporté ton homme dans la grimace difforme du lointain et je ne pourrai te revoir qu’après avoir lacéré la chair vive des antipodes…»
—Choppe voir celle-là… celle qui boite… non, là… la charolaise… tu vois pas qu’elle a le piétin!
Robert a raison. L’être opaque qui gouverne les chiens contredit la littérature fragile, nuancée et soucieuse d’aller vers l’autre. Le yin contrarie le yang. Fuir l’instant présent pour s’immerger dans la vie d’un autre, l’époque d’un autre, le style d’un autre, c’est du temps perdu. À peine si les pages sont bonnes pour allumer un feu, fatiguer les yeux avant de s’endormir, écrire dans les marges le numéro de celle qui vient de mettre bas, le sexe et la couleur de ses agneaux.
À partir d’ici, la théorie se range au fond de la poche ou reste à la case. On s’appuie sur le bon sens, formule fétiche de ceux qui regardent comment ça marche avant de critiquer le mode d’emploi. On tient compte des résultats concrets. On anticipe les stimuli-réponses, les facteurs naturels qui régissent le système, car si chaque mouton est peureux, passif et grégaire, le troupeau possède une intelligence systémique, un rythme, des hiérarchies, des dominances, des récurrences. On observe, sans autres instruments que les yeux, la patience et l’intuition. Cela s’appelle le bon sens.
Au berger ensuite de se montrer bon tyran en laissant au troupeau l’illusion de la liberté.
—Avec cette tchaffe, les bêtes ne remueront pas avant trois quatre heures. On est peinards. Allons grailler!
Robert se retire, d’un pas engourdi prend la direction de la case. Un temps, j’hésite, mais la faim l’emporte sur l’envie de voir ce qui se trame derrière les crêtes. Je lui emboîte le pas.
Du pain complet et presque frais, le fromage du Grand Ayerne, dont la croûte odorante ne vous lâche pas le bout des doigts, un saucisson sec, du beurre liquéfié et un litre de vin rouge servi dans deux verres «Astérix» et «Obélix» qui sentent encore la moutarde. Lorsque je me penche vers le robinet, il préfère me mettre en garde. «Vaut mieux la bouillir, on sait jamais ce qui traîne dans ces citernes, l’an dernier, y avait un crapaud qui bouchait l’entrée du tuyau.»À l’ombre de la case, à peine le bourdonnement d’une mouche, on gueuletonne en silence, de part et d’autre d’une table en bois massif qui semble peser une tonne. «T’as pas intérêt à y faire une raye.» Robert raconte l’avoir portée sur son dos depuis la ferme de l’Aveneyre. C’est un cadeau de quelqu’un qui lui est cher. Lorsque je cherche à y voir un peu plus clair sur les habitudes du troupeau, les réactions des chiens, le risque de maladies et la spécificité des différents pâturages, il me répond que «ça veut déjà assez venir». Pas besoin d’en rajouter. «Un café, une sieste et on y retourne!»
La panse pleine, Robert bâille et se retire. La fatigue s’installe, la nuit n’est pas prête de tomber, mais le yang me reprend et je noircis quelques feuillets, assis en tailleur sur le muret de la case, torse nu en plein soleil, enchanté comme un vacancier. De l’autre côté de la Chaux, le troupeau est silencieux. Il chaume.
Naïf, un brin rêveur, je croyais à la structure innée du troupeau. Elle ne l’est pas. Dans un sens, c’est rassurant. Dans l’autre, beaucoup de travail. Plusieurs semaines pour constituer un esprit d’équipe, des jours entiers à décourager les velléités d’indépendance, à dessiner avec l’aide des chiens le contour recherché, à réunir les bêtes tôt le matin, à ne les abandonner qu’à la nuit tombée, à réguler des éléments chaotiques et confus, dans un décor mouvant et éphémère.
Que fait un troupeau lorsqu’il est formé? Il se déforme. Il faut le reformer. Je pense beaucoup à toi, Sisyphe.
La nuit, le troupeau se concentre. Les forces centrifuges n’éclatent qu’aux premiers rayons de soleil. Le système tend alors au désordre, à l’entropie. Comme un inlassable big-bang miniature, chaque matin, à une vitesse inversement proportionnelle à l’intensité du soleil, les bêtes partent en quête de la meilleure herbe selon un mouvement uniforme, jusqu’à buter contre un rocher, une falaise, un chien, un berger. Alors, sans cesser de brouter, l’animal rebondit sur l’obstacle dans la direction opposée. Le troupeau dessine, grandeur nature, sur l’alpage, un schéma implacablement logique.
Laissées en liberté, les bêtes se réunissent en groupes d’affinité familiale, psychique ou raciale. La mère avec ses petits, les agneaux indépendants réunis en bande, les bêtes élevées en forêt entre elles, les charolaises à l’écart des autres. Chaque clique s’organise autour d’un ou de plusieurs animaux pilotes, des bêtes dominantes, à fort esprit d’insubordination, qu’il vaut mieux avoir à l’œil. Le but étant de restreindre les velléités de dispersion du troupeau, sans empêcher ce dernier de brouter, de lui imposer une limite pour qu’il ne mange pas que la meilleure herbe et piétine le reste. On obtient ainsi un troupeau, un organisme chaotique mais prévisible, une société précaire mais
ordonnée, un système qui obéit à une équation dépendant de l’heure, de l’eau, de l’herbe, de la température, de l’appétit, du soleil et de quelques autres variables que j’aurais tout loisir de découvrir ces prochains mois.
—Eh les animaux!
Il est dix-sept heures. Robert dit au revoir aux chiens. Il dit vouloir rester, mais son patron l’attend cette nuit pour des livraisons. Il est déjà en retard. Il me dit «à jeudi»et encore une fois «tu verras, le métier veut déjà venir». Cette fois, je suis seul. Jeudi, c’est dans cinq jours.
Seul à exercer un métier qui «veut déjà venir», à expérimenter un schéma évident, une cosmogonie petit format. Dans le troupeau, je suis dieu. Sur ce minuscule lopin de terre, j’expérimente la vie d’une petite société de mille membres, mille machines à vie qui consomment de l’eau, de l’herbe, produisent de la viande et des agneaux. Au sein de cette modeste
société, j’ai l’arrogance d’un Prométhée qui croit dominer la nature et tire, à la place d’un autre, les ficelles de marionnettes vivantes.
L’état de grâce est fugace. Malhabile avec les chiens, nerveux avec les moutons, mal positionné, trop autoritaire, trop braillard, je marche plus qu’il n’en faut, m’épuise, avance d’une bonne heure le retour au Grenier, y distribue du sel, qui facilite la digestion et stimule l’appétit, clôture le passage de la Chaux et contient tant bien que mal les bêtes dans un périmètre restreint jusqu’à la nuit. Si tous les jours sont comme celui-ci, non, je ne tiendrai pas jusqu’à octobre.
En juin, les journées sont interminables, longues comme des jours sans pain. Une touffe d’orties remue à peine dans l’embrasure de la porte. Des oiseaux invisibles poussent de petits cris tièdes. Un moucheron remonte les carreaux poisseux de la fenêtre. Le café italien de vingt heures ne suffit pas. De vagues bêlements et la clochette des deux mules. Grelots de vache, grelots de froid. On devine la rivière au-dessous. On sent les insectes se glisser sur la nuque. Deux phares d’automobile remontent la vallée. Debout sur le pas de la porte, je distingue à peine les premiers moutons qui me narguent en contournant les clôtures, filant vers la Chaux.
Tina, à droite!
Tina ne comprend pas. Je m’énerve. C’est pire. Je marche. Brina me suit. Je cours. Tina est partie rapercher. Elle en oublie deux qui continuent de filer vers le Grand Chalet. Je presse le pas. Il fait nuit. Les Tours d’Aï sont éteintes. Ne subsistent que les vestiges rosés du soir. Putain de bordel de merde, Tina, j’ai dit à droite. La montagne résonne. Toute la vallée m’entend. Tina comprend. C’est bien, Tina. Au pied, Tina! C’est bien.