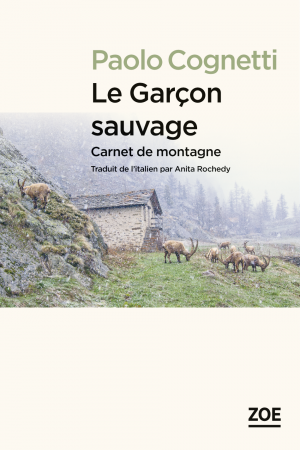parution mai 2023
ISBN 978-2-88907-106-7
nb de pages 208
format du livre 105x165 mm
Le Garçon sauvage
Traduit de l'italien par Anita Rochedy
résumé
Après un mauvais hiver qui le laisse à bout de forces, le narrateur décide de quitter la ville pour tenter une expérience de solitude dans le Val d'Aoste, à 2000 mètres d'altitude pendant plusieurs mois.
L'occasion pour lui de se lancer des défis de tous ordres, allumer un feu en plein orage, apprendre à se perdre, ne plus avoir peur du noir et du silence, la nuit venue. Là-haut, il redécouvre le bonheur de marcher sur le fil des crêtes, suspendu entre l'enfance et l'âge adulte, avant de redescendre, réconcilié avec l'existence.
Préface de Vincent Raynaud
Né à Milan en 1978, Paolo Cognetti a étudié les mathématiques et la littérature américaine, avant de se lancer dans une école de cinéma et de monter sa maison de production indépendante. Auteur de documentaires littéraires, de textes sociologiques et de romans, passionné par New York et par la montagne, il partage sa vie entre sa ville natale, le val d’Aoste et Big Apple. Son roman Sofia s’habille toujours en noir, paru chez Liana Levi en 2013, lui a valu de figurer dans la sélection du Prix Strega.
"Le Garçon sauvage vous emmène au cœur du Val d'Aoste. Le langage poétique et simple de ce texte retranscrit parfaitement les rencontres, les joies, mais aussi les difficultés rencontrées par le narrateur. Un vrai bol d'air frais!" Clémence, Gwendoline et Thibault
"Après une période difficile, Paolo Cognetti a vécu plusieurs mois dans le Val d'Aoste à la recherche de solitude. C'est cette vie toute simple au milieu de la nature et traversée de rencontres qu'il nous partage dans ce récit au verbe et à l'atmosphère paisible." Élodie
Le Garçon sauvage. Carnet de montagne (2016, autres traductions)
Le Garçon sauvage commence sur un hiver particulier : Paolo Cognetti, 30 ans, étouffe dans sa vie milanaise et ne parvient plus à écrire. Pour retrouver de l’air, il part vivre un été dans le Val d’Aoste. Là, il parcourt les sommets, suspendu entre l’enfance et l’âge adulte, renouant avec la liberté et l’inspiration. Il plonge au cœur de la vie sauvage qui peuple encore la montagne, découvre l’isolement des sommets, avant d’entamer sa désalpe, réconcilié avec l’existence. Néanmoins, ce séjour initiatique ne parvient pas à l’affranchir totalement du genre humain : « je pourrais me libérer de tout, sauf de la solitude. »
Traduit de l'italien par Anita Rochedy
Le Garçon sauvage: extrait
Pourquoi cette histoire m’intéressait-elle autant ? Parce qu’il me semblait important de me répéter une chose élémentaire : le paysage qui m’entourait, en apparence si authentique et sauvage, avec ses arbres, ses pâturages, ses torrents et ses rochers, était en fait le produit de siècles de labeur, un paysage artificiel au même titre que celui de la ville. Sans l’homme, rien de ce qui était là-haut n’aurait été pareil. Pas même le ruisseau, ni certains arbres majestueux. Même le pré où je prenais le soleil aurait été une forêt dense, rendue impénétrable par les troncs et les branches tombées, les rochers couverts de mousse, et un sous-bois rempli de genévriers, de buissons de myrtilles et de racines intriquées. Il n’y a pas d’état sauvage dans les Alpes, mais une longue histoire de présence humaine qui traverse aujourd’hui une époque d’abandon : certains le déplorent comme la fin d’une civilisation, moi, il m’arrivait au contraire de me réjouir quand je voyais des vestiges engloutis par le sous-bois ou un arbre sortir de terre là où, un temps, on avait semé le blé. Il faut dire que ce n’était pas mon histoire qui disparaissait. Moi qui rêvais de voir revenir les loups et les ours, je n’avais pas de racines là-haut, rien à perdre si la montagne se libérait enfin de l’emprise de l’homme.
Ainsi, mes explorations prirent la tournure d’une enquête, une tentative de lire les histoires que le terrain avait à raconter. Plus trivialement, je ramassais les déchets. Un vieux seau en bois pourri à moitié enfoui dans une fosse à purin, une serrure rouillée. L’histoire qui m’intéressait était exclusivement humaine : pourquoi, par exemple, la baita derrière la mienne avait-elle ce prolongement sur le côté ? Les affaires avaient peut-être mieux marché à un moment donné, si bien que la famille avait dû agrandir l’étable ? C’était la plus grande de toutes, mais aussi la plus austère. De toutes petites fenêtres, trois planches branlantes en guise de balcon. La troisième baita tournait le dos aux autres, la façade orientée vers le nord. Là aussi, il avait fallu qu’ils aient une bonne raison pour se priver du soleil : une querelle autour des limites de propriété peut-être ? La quatrième était la plus soignée, peut-être aussi la plus récente. Elle avait un petit balcon avec quelques tentatives de décoration, des vitres aux fenêtres et même du mortier sur les murs extérieurs – un mélange rugueux, avec quelques bosses ici et là, d’un blanc cassé qui me plaisait beaucoup. Dehors, il y avait deux enclos de travers, pour les poules ou les lapins ou quelque animal domestique. Comme le hameau était légèrement en pente, la baita blanche dominait de sa hauteur celle à l’envers, celle avec la grande étable ainsi que la mienne, qui en contrepartie jouissait d’une vue imprenable.
En les observant, il m’arrivait parfois de me demander : avait-elle vraiment existé, cette époque où Fontane était habité ? J’avais peine à le croire. Pour moi qui depuis tout petit voyais la montagne comme un grand champ de ruines, le présent se résumait depuis longtemps à un tas de morceaux que nul ne pouvait plus recoller. Tu ne pouvais rien faire d’autre que les tourner entre tes mains et imaginer à quoi ils avaient bien pu servir, comme il m’arrivait parfois de le faire quand, en décalant une pierre, je trouvais un manche de bois, un gros clou tordu, du fil de fer entortillé.
Aussi absurde que cela pût paraître, chaque baita avait un numéro. Un beau jour, un fonctionnaire avait dû recevoir l’ordre d’inscrire au cadastre tous les édifices, et depuis, toutes les ruines éparpillées dans la montagne possédaient une petite plaque avec un chiffre. Ma baita avait le numéro 1. Tôt ou tard, pensais-je, je descendrai en plaine et m’enverrai une carte postale, lieu-dit Fontane n° 1, puis m’en retournerai là-haut pour accueillir le facteur qui montera clopin-clopant. La baita avec la grande étable avait le 2, celle qui nous tournait le dos, le 3, celle qui avait été peinte en blanc, le 4. Mais les seuls habitants qu’il y avait ici étaient les loirs et blaireaux dont j’entendais parfois les allées et venues. La population, c’était moi. Comme Robinson sur son île déserte, je pouvais proclamer haut et fort : «J’étais seigneur de tout le manoir: je pouvais s’il me plaisait, m’appeler roi ou empereur de toute cette contrée rangée sous ma puissance; je n’avais point de rivaux, je n’avais point de compétiteur, personne qui disputât avec moi le commandement et la souveraineté.» Je représentais à la fois l’habitant le plus en vue et l’indigent, le noble propriétaire et son fidèle gardien, le juge, l’invité, l’ivrogne, l’idiot du village: j’avais tant de moi dans les jambes qu’il m’arrivait parfois le soir de devoir sortir et m’en aller dans les bois pour me retrouver un peu seul.