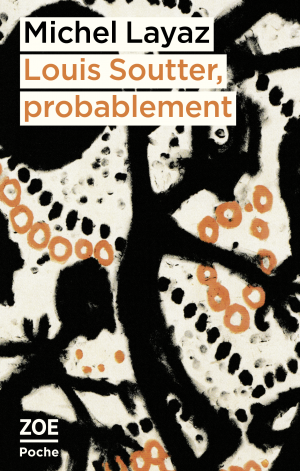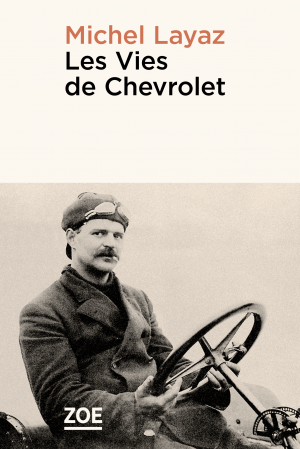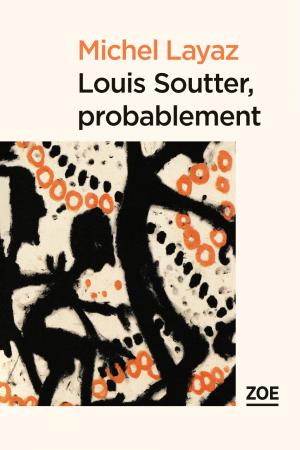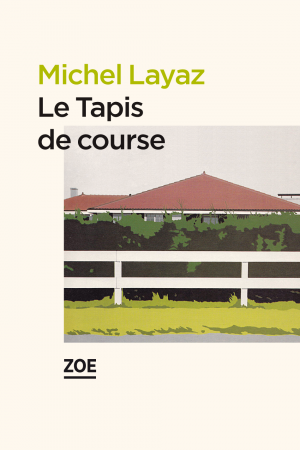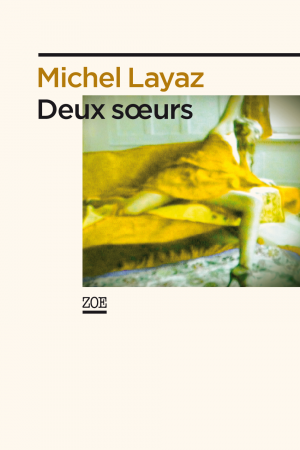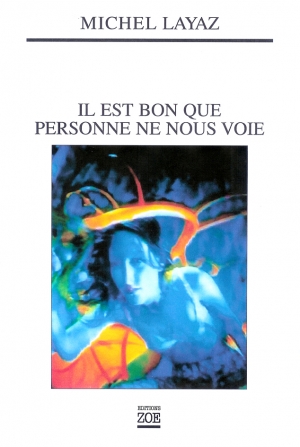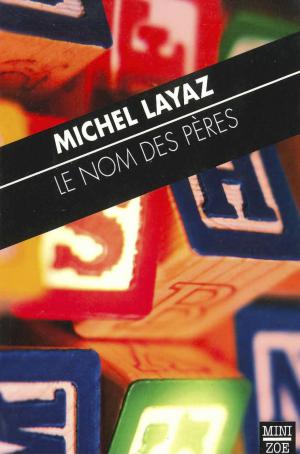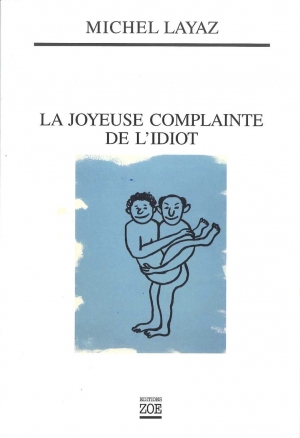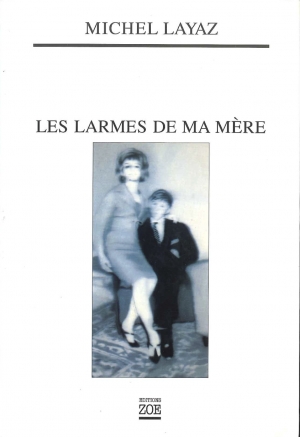parution septembre 2021
ISBN 978-2-88927-937-1
nb de pages 272
format du livre 105x165 mm
Louis Soutter, probablement
résumé
Aujourd’hui mondialement reconnus, les dessins et les peintures de Louis Soutter (1871-1942) n’ont été remarqués de son vivant que par un cercle restreint de connaisseurs. Parmi eux, Le Corbusier et Jean Giono ont été subjugués par le trait libre de l’artiste, vrai sismographe de l’âme. Formé à la peinture académique, violoniste talentueux, marié à une riche Américaine, puis directeur de l’École des beaux-arts de Colorado Springs, Soutter mène pourtant, dès 1902, une vie d’errance jusqu’à son internement forcé à l’âge de 52 ans dans un asile pour vieillards du Jura suisse. C’est là qu’il parvient à donner forme à l’une des œuvres les plus inclassables de l’histoire de l’art.
Il fallait l'écriture souple et subtile de Michel Layaz pour faire ressentir l’étrangeté de cet homme et nous entraîner le long d’une vie marquée par la solitude, ponctuée aussi par quelques éclats de lumière et transportée surtout par la puissance de la création.
Préface de Michel Thévoz
Louis Soutter, probablement a reçu le Prix suisse de littérature, le prix Bibliomedia et le prix Régis de Courten.
Né à Fribourg en 1963, Michel Layaz fait partie des principaux auteurs romands contemporains. Commencée en 1993 avec Quartier Terre (L’Âge d’Homme), son œuvre littéraire compte aujourd’hui une quinzaine de romans, dont plusieurs primés. Parmi ceux-ci Ci-gisent (Zoé, 1998), écrit à la suite d’un séjour à l’Institut suisse de Rome, Les Larmes de ma mère (Zoé, 2003 ; Prix Dentan et prix des auditeurs de la Radio Suisse romande), ou encore la Joyeuse complainte de l’idiot (Zoé, 2004). Plus récemment, son texte Louis Soutter, probablement (2016) remporte un prix de littérature suisse, le prix Bibliomedia et le prix Régis de Courten; Sans Silke (2019), quant à lui, obtient le prix Rambert. En 2021 paraît Les Vies de Chevrolet.
Michel Layaz, lauréat du prix suisse de littérature 2017 pour "Louis Soutter, probablement"
Michel Layaz, lauréat du prix Bibliomedia 2017 pour "Louis Soutter, probablement"
Michel Layaz, lauréat du Prix Régis de Courten pour "Louis Soutter, probablement"
La Pépinière
"Michel Layaz, en cueilleur d’impressions, met à nu, dans Louis Soutter, probablement, les forces inépuisables et contraires qui animaient le peintre suisse de la première moitié du XXe siècle. Publié aux Éditions Zoé en 2016, l’ouvrage dépasse amplement les contours d’une biographie. Intense !"
Vigousse
"Du violoniste, du peintre, du « fou » vaudois, Michel Layaz fait un frère d’âme dans une biographie qui n’en est pas une ( le « probablement » du titre ). D’une écriture riche et inspirée, il plonge dans les tourments de Soutter, dans ses instants de grâce aussi, quand un crayon à la main, le reclus, l’exclu libérait « les formes tapies là », les entraînant « dans des compositions grouillantes, des cohortes d’aubes et de crépuscules », se débarrassant « de ses craintes, douleurs, tortures, secrets intimes et désirs bannis »." P.B.
Le Monde
"Cette vie inimitable, l’écrivain suisse Michel Layaz en scande et en date à la perfection les instants cruciaux. Une narration qui n’est pas celle de la biographie historique, mais fait la part belle tant à l’exactitude des faits qu’à leurs dimensions intimement poétique et tragique. Une grande réussite." François Angelier
Daily Passions
"Ce livre est dense et remarquablement écrit, il laisse peu de temps morts ou faibles au lecteur… Pourquoi ? Et bien parce que cette vie Louis Soutter la mène en perpétuel mouvement, qu’il marche, joue du violon ou dessine. Parce que l’auteur semble regarder un effet stroboscopique permanent. Parce qu’ils – le livre et l’auteur – cherchent à cerner ce Louis et que l’adverbe du titre ne laisse rien de fixe, de définitif, d’immobile."
Une chronique Noé Gaillard à lire en entier ici
Deux filles (2024, domaine français)
Après un long voyage en Asie, Olga, vingt-deux ans, rentre à Paris, accompagnée de Sélène, rencontrée dans un cimetière chinois. Quand les deux filles ne récoltent pas des légumes dans des fermes alternatives, elles remettent de la joie chez le père d’Olga, très seul depuis que sa femme l’a quitté. En surface, l’harmonie est totale. Mais plus le père observe Sélène, moins il peut taire le malaise qui monte en lui. Les dessins miraculeux d’un homme sans domicile, un bouquetin sur un étroit chemin de montagne, une femme pâle dans un tea-room: dans ce roman aussi troublant qu’habile, on se met à voir des signes partout.
En déjouant nos attentes, Michel Layaz interroge notre conception des liens familiaux et ce que veut dire donner la vie.
Les Larmes de ma mère (2022)
Pourquoi cette mère, avec son troisième fils, marque-t-elle autant de différences ? Pourquoi des larmes le jour de l’accouchement ? Devenu adulte, le narrateur reconstitue son enfance au contact d’objets qui ont peuplé son quotidien et qui détiendraient la clé de la relation avec sa mère, cette femme insaisissable mêlant fierté et tourmente, sensualité et mépris.
Les Vies de Chevrolet (2021, domaine français)
« Che-vro-let ! Che-vro-let ! » : début XXe siècle, l’Amérique est ébahie devant les prouesses de Louis Chevrolet. Né en Suisse en 1878, le jeune homme a grandi en Bourgogne où il est devenu mécanicien sur vélo avant de rejoindre, près de Paris, de florissants ateliers automobiles. En 1900, il quitte la France pour le continent américain. Très vite, au volant des bolides du moment, Fiat ou Buick, il s’impose comme l’un des meilleurs pilotes de course. En parallèle, il dessine, conçoit et construit des moteurs. Ce n’est pas tout, avec Billy Durant, le fondateur de la General Motors, Louis crée la marque Chevrolet. Billy Durant la lui rachète pour une bouchée de pain et obtient le droit d’utiliser le nom de Chevrolet en exclusivité. Des millions de Chevrolet seront vendues sans que Louis ne touche un sou. Peu lui importe. L’essentiel est ailleurs.
Pied au plancher, Michel Layaz raconte la vie romanesque de ce personnage flamboyant qui mêle loyauté et coups de colère, bonté et amour de la vitesse. À l’heure des voitures électriques, voici les débuts de l’histoire de l’automobile, avec ses ratés, ses dangers et ses conquêtes.
Sans Silke (2019, domaine français)
Silke se souvient du temps passé à La Favorite alors qu’elle avait dix-neuf ans et s’occupait chaque fin d’après-midi de la petite Ludivine. Embrasser les arbres, apprendre à voler comme les oiseaux, dormir à la belle étoile, neuf mois durant, toutes deux auront vécu côte à côte dans un monde onirique, en marge des parents de la fillette absorbés par leur relation exclusive.
Avec ce nouveau roman, Michel Layaz poursuit son exploration des failles familiales. Il attrape avec précision les gestes d’une enfant qui s’arcboute de joie après un coup réussi au billard, qui se caresse les épaules de satisfaction lors d’un moment d’intense concentration et dont les mots peuvent rappeler ceux des meilleurs poètes : « J’ai envie de larmes ».
Louis Soutter, probablement (2016, domaine français)
Aujourd’hui mondialement reconnus, les dessins et les peintures de Louis Soutter (1871- 1942) n’ont été remarqués de son vivant que par un cercle restreint de connaisseurs. Parmi eux, Le Corbusier et Jean Giono ont été subjugués par le trait libre de l’artiste, vrai sismographe de l’âme. Formé à la peinture académique, violoniste talentueux, marié à une riche Américaine, puis directeur de l’Ecole des beaux-arts de Colorado Springs, Soutter mène pourtant, dès 1902, une vie d’errance jusqu’à son internement forcé à l’âge de 52 ans dans un asile pour vieillards du Jura suisse. C’est là qu’il parvient à donner forme à l'une des œuvres les plus inclassables de l’histoire de l’art.
Il fallait une langue souple et subtile pour faire ressentir l’étrangeté de cet homme et nous entraîner le long d’une vie marquée par la solitude, ponctuée aussi par quelques éclats de lumière et transportée surtout par la puissance de la création.
Louis Soutter, probablement, a été récompensé du Prix suisse de littérature 2017.
Le Tapis de course (2013, domaine français)
« Pauvre type ! » Prononcée avec calme par un adolescent dans une file de supermarché, cette interjection bouleverse son destinataire, le héros de ce livre. Sans le savoir, l’adolescent vient de fissurer la vie intérieure d’un homme qui se protège par une routine sans faille, sûr qu’il est qu’aucun événement extraordinaire ne doit venir briser la logique implacable de l’existence qu’il s’est construite.
Pour éviter que son monde ne vacille, l’homme se résout à s’enregistrer sur son téléphone portable. Il raconte son quotidien : le travail, la bibliothèque, les collègues, le tapis de course, les quelques amis, la famille, la multitude de livres lus pour trouver quelques rares phrases à ajouter à son petit panthéon privé. Rien n’y fait. Le «Pauvre type» le hante.
Michel Layaz vit et travaille à Lausanne. Avec Le Tapis de course, il poursuit une écriture qui révèle, sans en avoir l’air, les traits de notre société contemporaine.
Deux soeurs (2011, domaine français)
Les deux sœurs. Des agitatrices dont la grâce sauvage se pare de magie ? Des justicières rebelles ? Des adolescentes souveraines entre enfance et âge adulte ? Les deux sœurs ont le droit de vivre seules dans leur maison, c’est le juge qui a tranché. Leur père est reclus dans un hôpital psychiatrique, leur mère vit à New York, c’est ainsi, les deux sœurs l’acceptent, elles aiment père et mère comme ça. Elles vivent sur un rythme rapide, léger, malicieux, parfois endiablé, dans une forme d’allégresse musicale à deux temps. Près d’elles, il y a un grand arbre, des coquilles d’escargot, des fils de fer qu’elles ont délicatement suspendus dans la chambre vide de leur père, il y a aussi un amoureux qu’elles autorisent à venir jouer avec elles et une assistante sociale qui oublie joyeusement sa fonction à leur contact.
Cher Boniface (2009, domaine français)
Marie-Rose, généreuse, idéaliste et orgueilleuse, aimerait que Boniface écrive. Boniface préfère rester « inoccupé et anonyme, et de loin ». Houspillé par sa belle, Boniface peine à cultiver son indolence désabusée et se voit devenir le héros don quichottesque d’aventures finalement très joyeuses. D’érudit paresseux, il apprend sous nos yeux à devenir gourmand de la vie. Et même passionné. Boniface a l’amour de la différence, Marie-Rose est une enthousiaste critique. Alors tout le monde est égratigné : les riches et les pas riches, les célèbres et les pas célèbres, la pensée unique, les snobs, les travailleurs, les adolescents, les écrivains, les journalistes, les inspirés et les sportifs.
Brillante et acerbe, l’histoire de Boniface Bé et de Marie-Rose Fassa est une diatribe impitoyable mais aussi délirante et farcesque contre la société d’aujourd’hui. Les éblouissantes énumérations opèrent chaque fois un subtil pincement chez le lecteur parce que l’ironie est mordante et qu’une joie vraie s’impose.
Michel Layaz signe ici son huitième roman.
Il est bon que personne ne nous voie (2006, domaine français)
Le narrateur, un garçon de quinze ans, travaille après l’école dans une boucherie. Il y rencontre Walter, un maître en sagesse. Dans le quartier populaire où il vit, le jeune homme est l’ami de Raton, maître de rien, et il se lie d’amour avec Charlotte qui va l’initier à d’étranges rituels et l’aider à grandir.
A la fin du livre, on comprend que ce texte troublant sur l’adolescence est dicté par le garçon devenu très âgé. Tandis que la mort approche, le vieillard vit un dernier amour pour Lucie qu’il surnomme Lucie-Lucifer. Cette infirmière sans égal a découvert un procédé pour que ses pensionnaires préférés puissent choisir en toute quiétude l’instant de leur disparition.
Le Nom des pères (2004, Minizoé)
La Joyeuse Complainte de l'Idiot (2004, domaine français)
La Joyeuse Complainte de l’idiot est le récit d’un internat peu ordinaire où vivent des adolescents encore moins ordinaires. En effet, La Demeure accueille de jeunes garçons dont l’intelligence décalée n’a pu s’accommoder du monde environnant. Racontée par l’un de ses membres, cette communauté tire force et originalité de son impérieuse présidente-directrice générale, Madame Vivianne.
«Il ne faut pas croire que les gens qui vivent à La Demeure sont des demeurés, ou des prisonniers, ou des délinquants, ou des fous, ou des brigands, ou de la mauvaise graine, ils sont seulement un peu de tout cela, et il serait vain de les réduire à quelques tours de passe-formules.
Il y a en nous des splendeurs qu’il faut peut-être aller chercher, des splendeurs enfouies sous des couches de désarroi, de tourments, de méchancetés, de désespoir, d’obstination, d’errances, de mauvaises routes, de mauvais choix, autant de dérives qui ne sauraient effacer la bonne pâte qui existe derrière tout cela et qui ne demande qu’à être pétrie.»
Michel Layaz vit à Lausanne et à Paris. Aujourd’hui, il est considéré en Suisse comme un des romanciers les plus importants de sa génération. Après le succès des Larmes de ma mère, ce nouveau roman est une preuve de la singularité et de la clarté de sa voix.
Les Larmes de ma mère (2003, domaine français)
Pourquoi cette mère, avec le cadet de ses fils, marque-t-elle autant de différences ? Et pourquoi des larmes le jour de l’accouchement ? Ce troisième fils, elle le vante et elle le persécute, elle le distingue et elle le tourmente. Devenu adulte, le dernier fils reconstitue son enfance grâce aux objets qu’il voit ou découvre dans l’appartement parental. Et si les objets se mettaient à parler ? Et si les objets détenaient la clé de l’énigme ? Grâce à une écriture précise, tendue, ce livre où se succèdent des épisodes cocasses et dramatiques, révèle l’intime en évitant l’écueil du sentimentalisme. Les mots sont à leur place sans jamais forcer et le lecteur voit son imagination croître au fil de ces récits d’enfance qui ne manqueront pas de résonner dans sa propre histoire.
Les Légataires (2001, domaine français)
Louis Soutter, probablement: extrait
Septembre 1887
Jeanne, Jeanne, descends ! Qu’est-ce que tu fais ? maman ne veut pas ! Louis crispait ses doigts, s’inquiétait de voir sa sœur perchée au milieu de l’arbre, un bras griffé, sa robe froissée par l’écorce. J’habite ma maison, j’invente de la lumière avec les feuilles. Et Jeanne qui bougeait une branche du frêne, jouait avec un rai de soleil, allumait et éteignait la lampe de sa maison. C’est joli, tu ne trouves pas ?
Les paupières battaient à toute vitesse. Jeanne aimait les arbres. Elle les aimait comme elle aimait les fleurs, les poissons, les vers de terre, les limaces, les souris, la moisissure, les bestioles sans nom, comme elle aimait lancer du pain aux canards et aux oiseaux, surtout à ceux qui - hop ! - montent à huit mille mètres pour faire le tour du monde. Jeanne aimait aussi cracher dans le noir, pincer les nuages du bout des doigts, se chatouiller le ventre et tout ce qu’on lui interdisait de toucher. Elle observa les fourmis qui s’activaient le long du frêne et de son avant-bras. Comme tous les enfants, elle avait sur les insectes un droit de vie et de mort. Je ne vous ferai aucun mal, murmura-t-elle, et même si je ne sais pas comment, vous aussi vous devez respirer. Descends ! Jeanne, descends ! insista Louis. Tu dois encore chanter ; après si tu veux nous reviendrons. Louis ouvrit les bras pour recevoir sa sœur. Il surestima sa force, perdit l’équilibre, et tous deux, enlacés, tombèrent. Jeanne riait de bon cœur, une joie sans méchanceté, sans rides. Elle se désolait d’avoir un frère qui avait moins de forces qu’un lapin. Louis fronça les sourcils. Ce n’est pas vrai, s’alarma-t-elle, tu as beaucoup plus de forces qu’un lapin. Jeanne ne savait pas mentir. À côté d’eux, sans qu’on ne l’entende, était arrivé le chien qui n’appartenait à personne. Jeanne lui passa une main sur la tête, enfonça un doigt dans la truffe du bon toutou. Louis fit partir l’animal, nettoya en hâte la robe de sa sœur. Va te laver les mains, vite ! ordonna-t-il. La petite gambada entre les pommiers, le poirier, le cerisier, les deux pruniers – ce n’est pas pour rien qu’on avait choisi d’appeler la maison Le Verger – elle pénétra à l’intérieur en évitant le salon où les invités du jeudi bavardaient, buvaient des tisanes ou du vin, mangeaient des tartes, raisinets ou mirabelles, évoquaient des affaires, locales ou internationales.
On félicita Fanny Yersin de ce que son fils avait été admis à travailler chez Louis pasteur. Une promotion hors pair, pérorait le médecin de famille, donnant sur pasteur des précisions qui traînaient au fond du premier cabinet médical venu. Une femme à la voix qu’on aurait dite passée au fumoir annonça qu’elle avait vu le chantier de cette fameuse Tour de 300 mètres que les parisiens s’étaient mis en tête de construire. Dans le salon des Soutter, comme par- tout ailleurs, la tour eut aussitôt ses partisans et ses opposants. Tant de métal tout de même ! Louis-Henry-Adolphe en profita pour dire que si Albert ferait comme lui des études de pharmacien, Louis songeait à l’ingénierie ou à l’architecture. Comme les discussions sur la tour échauffaient les esprits, Marie-Cécile vint clore le débat : l’homme peut bien bâtir une tour qui ne sert à rien s’il n’oublie pas de construire des temples et des cathédrales, témoins de sa piété et de sa grandeur. La maîtresse de mai- son avait souvent la parole qui pique. On évitait de trop s’y frotter. Son mari, de nature arrangeante, aimable, un peu lâche, acquiesça de façon visible, mais glissa dans l’oreille d’Albert ce qu’il aimait répéter à ses fils : si tu tombes entre les mains des pasteurs, tu ne fais rien de bon.
Louis-Henry-Adolphe connaissait le tempéra- ment de sa femme, il connaissait aussi la psychologie des clients qui passaient le seuil de sa pharmacie. De comprendre l’un et l’autre garantissait la paix du ménage, apportait des sous à la banque.
Les invités prirent place pour apprécier le moment musical et admirer ceux qui le proposaient : Marie-Cécile au piano, Louis au violon, Albert à la flûte, et la jeune Jeanne qui chantait avec sa mère, et parfois seule. On écoutait Tchaïkovski et Schubert en connaisseurs. On savait que si la musique demande certes du talent, elle exige d’abord du travail, de la persévérance, de l’acharnement, de l’humilité, autant de valeurs défendues âprement au Verger et loin à la ronde en ces terres nanties et protestantes. Plus encore que les garçons, les filles reçurent des vivats. Marie-Cécile, beauté austère, jouait avec cette grâce qui aurait permis aux plus imperméables de sentir naître en eux des émotions et qui rendait aux plus délicats le goût de la nuance. Et quand Jeanne chantait, c’était comme si elle avait oublié la présence des autres, comme si elle se trouvait seule au milieu des prés, entourée d’herbes folles et protectrices dans lesquelles on voudrait se rouler. Sitôt qu’elle devait s’arrêter, son visage se rebiffait, mais dès qu’elle reprenait son chant, on le voyait s’épanouir à nouveau. Avec des grandeurs bouleversantes, Jeanne offrait au ciel sa petite voix. En pariant qu’elle deviendrait cantatrice, personne n’aurait pris beaucoup de risques, mais qui aurait pu savoir que son besoin de liberté et son tempérament d’intrépide se briseraient contre les carcans de la morale ? Dans le destin des enfants Soutter, ce fut elle qui, la première, engloutie jour après jour sous les regards qu’on devine hypocrites et hostiles, lâchera définitivement prise. Les nages à contre- courant appellent la noyade.
Louis, plus que tout autre, aimait les réceptions au Verger : aucune tristesse, aucune crainte, une bienveillance générale qui laissait l’esprit s’assoupir, les inquiétudes se disperser. Si seulement ces moments à l’abri des sortilèges avaient pu s’éterniser. Pleine de vie, Jeanne était retournée à ses vagabondages, le jardin faisant office de monde, le frêne de forêt vierge.
Quand l’une ou l’autre avait été invitée, Louis osait s’approcher des jeunes filles à qui sa mère donnait des leçons de piano, flattées que leur professeure les distinguât. Du coin de l’œil, il regardait les chevilles et les poignets, devinait le reste. Un léger effroi traversait son corps. Albert, d’un naturel plus avenant, parlait avec assurance, n’avait lui besoin d’aucun déguisement pour s’affirmer. Par-dessus tout, Louis admirait sa mère, fier d’être son fils, il observait comment les hommes et les femmes la complimentaient, lui lançaient des paroles fleuries : des lys et des marguerites, des orchidées et des pâquerettes, et sur elle, même les chardons avaient des beautés. Louis s’en voulait de ne pas savoir mieux lui plaire. Il se souvint du dernier carnet de notes qu’il avait dû lui tendre au début de l’été. Marie-Cécile, d’un coup d’œil, avait tout enregistré. Elle aurait pu féliciter son fils, et pourquoi pas le serrer contre elle, l’embrasser, lui passer une main dans les cheveux. Louis ne figurait-il pas, comme elle le souhaitait, parmi les meilleurs élèves de la classe ?
Marie-Cécile s’était raidie, avait pointé la note de conduite, mauvaise, plus mauvaise encore que les fois précédentes, elle avait posé mille questions, des orties sur la langue, n’avait laissé à Louis le temps de rien. Mon fils a une mauvaise conduite, c’est toujours ainsi que le vent du désastre se met à souffler. Injuste et excessive, elle avait lancé ses pointes à l’aveugle, blessé quand il aurait fallu apaiser. Après les mots venait le silence, et après le silence quelque chose de pire que le silence. Marie-Cécile savait-elle que Louis restait le plus souvent à l’écart de ses cama- rades, comme vaincu par une sorte d’ennui inquiet ? lui avait-on dit que dans le préau, si parfois il s’approchait d’un groupe, il se lassait vite de la présence des autres, partait s’asseoir dans un coin sans qu’on l’appelle, les élèves préférant oublier celui qui grip- pait les élans et décourageait la bonne humeur ? se doutait-elle qu’en classe il n’était pas rare, à cause d’une sorte de rire, ou de cri, comme échappé de son corps, que tous les yeux se tournent vers son fils ? De la tristesse et de la gêne, bien sûr que Louis en éprouvait. Combien de fois il aurait voulu se sauver, sauter à travers la fenêtre, courir jusqu’à la forêt et attendre la pluie pour se faire rincer jusqu’à l’os, renaître enfin, devenir autre ? Depuis l’arrière de la pièce, Marie-Cécile remarqua les plis sur le front de Louis. Elle lui lança un regard et le pria de ramener Jeanne avant que les invités ne s’en aillent.
En ce premier septembre de l’an 1887, tandis que Louis s’attristait de ne pas être aimé par sa mère autant qu’il l’aurait souhaité, à une petite centaine de kilomètres de là, Frédéric Louis Sauser, alors qu’il aurait préféré ne pas naître, sortait du ventre de la sienne. Cette femme triste et résignée, jamais il ne put l’aimer, et c’est sous un nom flambant comme un sou neuf qu’il écrira L’Or, la merveilleuse histoire du général August Suter, celui que dans la famille de Louis on appelait abusivement, mais avec tristesse et admiration, L’Oncle Suter, celui dont Blaise Cendrars deviendra le lucide porte-parole en racontant son apothéose et son apocalypse.
Juillet 1898
Madge, la belle Madge sortit de l’eau. Elle s’était trempé les jambes jusqu’aux genoux. C’était une rivière d’eau vive, poissonneuse. Madge avançait, ne craignait ni les galets ni la glissade, ni les roches ni le vent des montagnes. Sans perdre l’équilibre et sans rougir, elle ajusta sa robe. D’un souffle, elle éloigna une guêpe. Elle était solide Madge, et habile. Une vraie américaine. Elle s’approcha de Louis, l’embrassa, le serra contre sa poitrine, relâcha son étreinte. Dans le jour blanchi par le soleil, une serviette virevolta. Mes pieds mon chéri, il faut les essuyer ! elle ne cessait de sourire Madge, un sourire vigoureux, invariablement le même, comme ceux que l’on verra bientôt sur les publicités qui vantent l’hygiène buccale et les vertus de la pâte dentaire. Madge la moderne ! Madge l’américaine ! Louis enroba les pieds de la belle avec le linge de bain, les frotta, passa le tissu entre les orteils, admira ces morceaux de chair dodus et rosés. Madge enfila ensuite ses chaussettes et ses bottes en cuir. Elle regardait son homme avec fierté, comme on jauge une belle prise : Demain tu seras directeur, lui dit-elle la bouche grande ouverte, directeur du département des beaux-arts de Colorado Springs.
Sa voix rayonnait. Sa poitrine gonflait. Il y aura une fête, on ne parlera que de toi, de nous, de notre triomphe, on jouera un peu de Beethoven.
Louis n’avait que vingt-sept ans, le jeune couple la vie devant soi. Madge brassait les ingrédients de la réussite au fond de son grand chaudron étoilé. Elle ne vit pas la main que Louis tenait posée sur son ventre, ou sur son estomac, les pensées sombres qui partaient se cacher là. Depuis deux ans il acceptait les douleurs, les accueillait comme il pouvait. Surtout ne plus en parler à Madge : intestins et amour font mauvais ménage. Madge mordilla l’épaule de son homme, l’aurait préférée plus ronde, plus grasse. Entre deux rires, elle le lui dit.
Que d’événements depuis leur première rencontre au conservatoire royal de Bruxelles, lui, le chouchou d’Eugène Ysaÿe, le maître adulé, elle, talentueuse quand elle saisissait son archet, plus encore quand elle se mettait à chanter. Ces deux-là se plurent et se le dirent. Mais ce n’était plus sur un violon que Madge voulait que Louis pose ses doigts. Elle avait hâte d’autres enchantements. Comme Louis se montrait timide, on devine que ce fut elle qui se glissa dans la chambre, retira froufrous, dentelles et corset, elle encore qui pleine d’aplomb se glissa sous les draps, qui mit ses lèvres entrouvertes sur celles de Louis, baisa sa bouche, caressa ses jambes, son torse, son sexe, se frotta à lui, l’embrassa avec ferveur, s’empara de son être et se laissa transporter par ce qu’elle découvrait, lâchant quelques notes de bonheur, une partition inconnue qui s’écrivait au présent. Ils eurent un certain plaisir. Sur le visage de Madge, la mine légèrement hautaine qu’elle portait en permanence sur ce qui l’entourait avait disparu. Voilà donc ce qu’est l’amour, avait pensé Louis, partagé entre l’émerveillement et un indicible malaise. Oui, que d’événements depuis leur rencontre : Bruxelles qu’on avait quittée, Louis qui avait choisi de mettre de côté ses études musicales et de se former à Lausanne comme peintre, puis à Genève, puis à paris, suivant des ateliers académiques de bonne réputation. Madge n’empêchait rien. Elle taisait ses projets, cachait ses caprices. Tous les philtres ne sont pas instantanés. Quand le moment opportun fut arrivé, elle eut en bouche les bonnes paroles, emmena Louis jusque chez elle, dans sa patrie à elle, pour le marier dans sa ville à elle, non pas à New York ou à Chicago où l’on s’était arrêté quelques mois et où Louis, subjugué, serait bien resté, mais ici, à Colorado Springs, à côté du somptueux Garden of the Gods, avec l’ocre des rochers, avec le bleu du ciel, avec l’air sec qui vous sarcle les poumons. C’était là qu’ils érigeraient leur palais. On vivrait maintenant à l’heure du Colorado. Et le succès montrait déjà le bout de ses pinceaux, irait grandissant. Madge avait des parents fortunés, de l’ambition pour deux. We all love America, patrie de tous les possibles, berceau de tous les baptêmes. Je veux que tu deviennes illustre, disait Madge, je veux que nos amis nous envient, je veux que mes parents t’adorent, je veux que le département des beaux-arts étincelle, je veux que les étudiants t’admirent, je veux que les habitants de Colorado Springs nous reconnaissent dans la rue, je veux avoir des enfants de toi, je veux que tout cela soit immortel, je veux que tu dessines mon portrait ce soir, à la maison, quelque chose de simple à donner à mum pour la remercier des vêtements qu’elle nous a offerts. Louis hocha la tête : apparemment, pour le portrait, il voulait bien.
Dans sa main gauche, Louis tenait la gomme, et dans la droite le fusain. Pour ne pas bouger, Madge lisait, installée sur un fauteuil de velours jaune. Louis avait acquis beaucoup de sûreté dans son art. tandis qu’il dessinait avec aisance, marquait la lèvre supérieure, soulignait la courbe des sourcils, donnait vie au visage, l’orage éclata, pas un de ces pétards mouillés à l’européenne, mais un orage d’ici. Quand tout va bien, c’est six mille éclairs à l’heure. Louis se concentrait. Il fallait quelque chose de réa- liste et de délicat qui puisse satisfaire tout le monde, belle-famille en tête. La foudre ne perturbait pas Madge. Elle continuait sa lecture, exagérant à peine son abandon. Pour réussir le portrait attendu, Louis dut garder son sang-froid. Le résultat fut plaisant : l’âme de Madge se reflétait dans le dessin, mais pas trop. D’ailleurs Louis n’aurait pas vraiment pu dessiner autre chose, c’était là ce qu’il savait faire, ce qu’il avait appris, c’était pour cet art-là qu’on l’aimait et qu’on l’avait engagé. Pleine d’une joyeuse vanité, Madge était descendue dans l’appartement de ses parents, un étage plus bas, pour montrer le dessin à sa mère, tout de suite. Louis resta seul. Il déboutonna sa chemise en soie, massa son ventre, ou son estomac. Le vacarme de l’orage changeait de cap, roulait plus au sud. Louis aurait voulu dormir, ne penser à rien. Il devinait que l’art ne consistait pas à offrir aux gens de jolis dessins comme ce portrait, des babioles de bonne facture produites par quelqu’un qui n’y avait mis ni son cœur ni rien. Était-ce là le rôle de l’artiste ? À cet instant, son art, il aurait pu le dédaigner, le mépriser même. Mais à la place, il n’avait pas mieux à proposer. Jetons au loin ces mauvaises pensées, se dit-il, écoutons Madge et poursuivons le chemin ! Dans deux jours, ce sera la fête. Qu’adviennent la réussite et les jours de gloire ! et nul embarras !