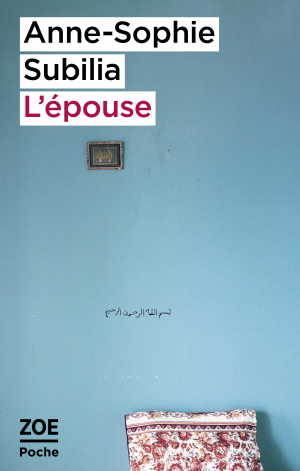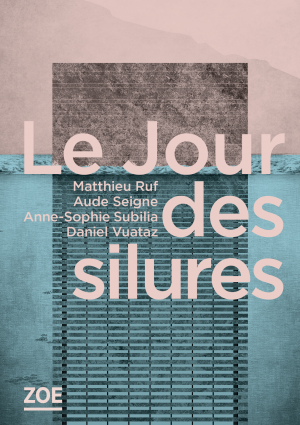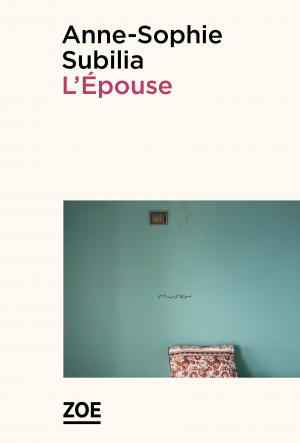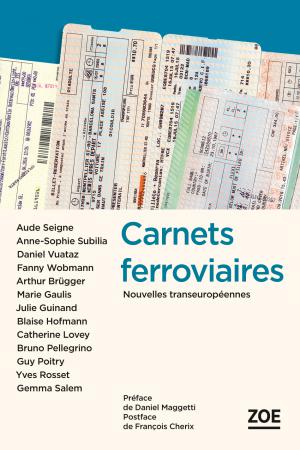parution mai 2016
ISBN 978-2-88927-320-1
nb de pages 144
format du livre 140x210 mm
Parti voir les bêtes
résumé
Il arpente campagne, forêts et bitume ; il hume, écoute, observe. Réinstallé dans le village de son enfance, il fréquente une poignée de paysans, s’occupe de Cyril, son filleul, s’éprend de Claire, bricole des meubles.
Il parle peu, parle mal. La modernité et l’urbanisation de sa contrée le rongent. Quant au chantier qui s’érige non loin, il en a peur. Mais ce molosse le subjugue aussi, le hante et l’emplit d’une étrange colère.
Dans une langue traversée d’oralité, Parti voir les bêtes parle d’un amour sans bornes pour une terre condamnée à disparaître. Ce roman fait entrer dans le regard de ceux qui éprouvent sans protection la beauté du monde.
Suisse et belge, Anne-Sophie Subilia vit à Lausanne où elle née en 1982. Elle a étudié la littérature française et l’histoire à l’Université de Genève. Elle est diplômée de la Haute École des arts de Berne, en écriture littéraire.
Elle écrit pour des ouvrages collectifs et des revues, pour la radio ou encore pour la scène avec Hyperborée, performance inspirée d’une navigation le long des côtes groenlandaises.
Poète et romancière, elle est l’auteure de L’Épouse (Zoé, août 2022), abrase (Empreintes, 2021, bourse Pro Helvetia), Neiges intérieures (Zoé, 2020, Zoé poche 2022), Les hôtes (Paulette éditrice, 2018), Qui-vive (Paulette éditrice, 2016), Parti voir les bêtes (Zoé, 2016, Arthaud poche 2018, bourse Leenaards) et Jours d’agrumes (L’Aire, 2013, prix ADELF-AMOPA 2014).
L'Agenda
"... Il y a une multitude de tiraillements dans ce texte : tradition contre modernité, nature préservée et urbanisation, fidélité avec l’héritage familial versus liberté individuelle. On observe sans cesse ces passages du monde urbain au rural, l’un jugeant l’autre, mais toujours avec subtilité. (...) On réalise que le cadre rude, mais aussi en apparence idyllique de la campagne peut connaître des modifications rapides. Le “tu” [personnage principal du texte] voit en effet sa Gloye natale bouleversée par un chantier titanesque. L’exploitation agricole familiale se trouve sans cesse menacée. Une problématique des plus actuelles, finement amenée, traitant non seulement de la transformation de cette terre, dont le charme disparaît à mesure que le béton coule, mais aussi des rapports humains qui s’ensuivent : confrontation de milieux antagonistes, mélancolie, attachement, déchirement, nostalgie d’un autre temps.
Malgré le phénomène de mode actuel lié à une vie “plus verte”, l’auteure parvient à s’affranchir des clichés. Pas de grands discours superficiels ni de slogans tout faits, mais l’histoire simple et finalement terre-à-terre d’un coin de campagne paisible voué à disparaître, comme il pourrait y en avoir mille. Anne-Sophie Subilia manie l’art des phrases courtes - ce qui augmente encore leur impact. Elle choisit finement les mots, les agence savamment. (...)" Stéphanie de Roguin
Terre&Nature
"...Dans une langue typée, chargée d'empathie, l'auteure réussit la performance de développer un parler terrien, mais sans connotation régionale particulière. À décrire, avec tant d'images fortes, une campagne en proie à l'urbanisation, ce récit tient autant du roman que du manifeste (...)"
le phare
"... Anne-Sophie Subilia réussit le portrait sensible d'un écorché vif." Isabelle Rüf
Le Courrier
"... le héros de Parti voir les bêtes, jeune homme taiseux [est] désigné par un "tu" qui marque à la fois la distance et l'intime – le pronom traduisant autant sa posture existentielle que son peu d'aisance avec la parole. (...)
Tout en finesse et en silences éloquents, dans une écriture attentive et sensuelle, Parti voir les bêtes tisse des liens entre l'intime et le paysage, entre création et destruction, et dit à la fois l'espoir et la fin d'un monde." Anne Pitteloud
L'Hebdo – Le choix des libraires Payot
"... Ecrit à la deuxième personne du singulier, ce texte percutant donne à comprendre l'ambiguïté de notre monde déchiré entre le progrès et la protection de la nature, le rendement des usines et celui de la terre nourricière, que l'on pense insuffisant." Aurélie Sonnay
Le matricule des anges
"... À pas sûrs, Parti voir les bêtes [...] nous imprègne de l'amour passionné de Simon pour sa campagne et ses forêts. Un monde qui tremble à la frontière de sa propre disparition [...]." Virginie Mailles Viard
La Liberté
"Ses mots esquissent, suggèrent. Osent multiplier les retouches pour approcher la complexité du réel et de ceux qui y surnagent. [...] Anne-Sophie Subilia confirme les belles qualités d'écriture qu'on avait pu deviner dans [son] premier roman: la voici de retour avec Parti voir les bêtes, remarquable évocation d'un monde parvenu à son point de bascule. (...)
Un personnage attachant, jamais nommé, toujours tutoyé, ce qui le rend d'autant plus proche que ses questions sont aussi les nôtres: faut-il figer le paysage dans le souvenir qu'on en a? Faut-il laisser les choses en l'état, ou les temps modernes requièrent-ils déjà un "adieu aux prairies"? Oui, Anne-Sophie Subilia sait que "peu de mots [...] conviennent pour parler de ça correctement". Elle les trouve en insufflant dans ses phrases la pulsation cahoteuse de l'oralité, distillant çà ou là quelques savoureuses trouvailles [...] qui achèvent des faire palpiter cette prose puissante. (...)
[...] Une certitude: au sein de cette nouvelle garde dont la littérature romande peut s'enorgueillir, la voix claire d'Anne-Sophie Subilia est assurément de celles qui comptent." Thierry Raboud
RTS – Entre les lignes
Réécouter l'émission Entre les lignes du 10 mai 2016 avec Anne-Sophie Subilia sur https://www.rts.ch/espace-2/programmes/entre-les-lignes/7676664-entre-les-lignes-du-10-05-2016.html#7676663
Le Temps
"... Anne-Sophie Subilia a sa musique propre, un accès direct aux émotions, au non-dit, un rapport charnel à la nature. (...)" Isabelle Rüf
Français (poche)
Éditeur: Arthaud
Année: 2017
L'épouse (2024, Zoé poche)
Gaza, 1974. Accompagnant son mari délégué humanitaire, Piper cherche un sens à sa vie d’expatriée, entre l’oisiveté, la présence militaire, les regards posés sur elle. Heureusement, il y a Hadj, le vieux jardinier, qui démultiplie les fleurs à partir d’une terre asséchée, et les rencontres fortuites avec la petite Naïma. Mais cela suffit-il?
Avant-propos de Lisbeth Koutchoumoff
Le Jour des silures (2023)
Dans un futur proche, la montée des eaux a eu lieu. Jeune présidente d’une ville pratiquement engloutie, Colombe croit à la décrue. Alors que la population se serre dans les derniers étages des immeubles et mène une vie nouvelle, communautaire, aquatique, Boris et Salömon, un duo de scaphandriers, plongent dans les rues à la recherche de vestiges et d’archives. Une mission qui n’est pas sans danger – surtout quand disparaissent les enfants et que rôdent les silures.
Neiges intérieures (2022, Zoé poche)
Ils sont six à bord du voilier Artémis, partis pour quarante jours d'étude du territoire polaire et arctique. D'un côté une nature extrême, immense et ensorcelante; de l'autre la vie confinée "comme dans une navette spatiale", où tout est à réapprendre: fabrication du pain et préparation du poisson, hygiène intime et rapports sociaux rebattus par la promiscuité.
Préface d'Astrid de Larminat
L'Épouse (2022)
Janvier 1974, Gaza. L'Anglaise Piper emménage avec son mari, délégué humanitaire. Leurs semaines sont rythmées par les vendredis soir au Beach Club, les bains de mer, les rencontres fortuites avec la petite Naïma. Piper doit se familiariser avec les regards posés sur elle, les présences militaires, avec la moiteur et le sable qui s'insinue partout, avec l'oisiveté. Le mari s'absente souvent. Guettée par la mélancolie, elle s'efforce de trouver sa place. Le baromètre du couple oscille. Heureusement, il y a Hadj, le vieux jardinier, qui sait miraculeusement faire pousser des fleurs à partir d'une terre asséchée. Et Mona, psychiatre palestinienne sans mari ni enfants, pour laquelle Piper a un coup de coeur. Mais cela suffit-il ?
Plus que jamais, dans L'Épouse, Anne-Sophie Subilia révèle la profondeur de l'ordinaire. La lucidité qui la caractérise ne donne aucune circonstance atténuante à ses personnages.
Neiges intérieures (2020)
Artémis : seize mètres d’aluminium, taillé pour les mers de glace. Quatre architectes paysagistes embarquent sur ce voilier pour étudier le territoire du cercle polaire arctique. En plein cœur d’une nature extrême, soumis à une promiscuité qui fait de ce voyage un huis clos, ils vont être confrontés aux contraintes du groupe, du capitaine et de ce désert aussi toxique qu’ensorcelant.
Pendant les escales, la narratrice court sur le sol mousseux de la toundra. À bord, elle doit tout apprendre de la navigation, de ses compagnons, du froid, de la fabrication du pain comme de la préparation du poisson ou de l’hygiène intime.
Que ce soit de Lausanne à Paris, de Vienne à Genève ou de Glasgow à Londres, chacun des treize auteurs de ce recueil situe son histoire à bord d’un train qui parcourt l’Europe. À l’occasion d’un long trajet en chemin de fer, l’une se souvient de son voyage dix ans plus tôt, elle traque la différence entre son être d’hier et d’aujourd’hui. Un autre se remémore la géniale arnaque dont il a été l’auteur, un troisième retrace l’incroyable hold-up ferroviaire du South West Gang dans l’Angleterre de 1963.
Ces nouvelles donnent une vue d’ensemble inédite sur la manière de concevoir l’Europe comme espace physique et symbolique. Les auteurs étant de générations très diverses, le lecteur appréciera les différentes manières d’appréhender notre monde proche et de s’y situer.
Nouvelles de Aude Seigne, Blaise Hofmann, Anne-Sophie Subilia, Gemma Salem, Bruno Pellegrino, Arthur Brügger, Daniel Vuataz, Marie Gaulis, Fanny Wobmann, Catherine Lovey, Julie Guinand, Guy Poitry, Yves Rosset.
Préface de Daniel Maggetti, postface de François Cherix
Parti voir les bêtes: extrait
Depuis les carreaux de ta cuisine, qu’il s’agirait de laver un jour, la vue donne sur quelques vieux jardins en cascade. En ce temps-ci de l’année, aucun poireau ne flanche, ni l’oignon. Au contraire, ils tiennent bien droit sur eux-mêmes, et la vieille grébiche qui en est la propriétaire les arrache un à un pour ses potages de la semaine. Le reste fait des bosses sous la neige.
Le coq de Vladek déchire le feutre de la nuit. Depuis sa butte, il crie et envoie valdinguer le dindon et la volaille au complet. Ce coq perché t’aura tiré du lit un matin de plus. En ton for intérieur, tu lui dois une fière chandelle pour ça, et à plus forte raison pour t’avoir mis dans les oreilles l’épais silence qui entoure son cri. Ce restant de silence, avant que les choses recommencent, avant que la journée s’en empare et kidnappe la paix, t’est devenu tellement précieux ! Mais voilà, le passage des premières voitures finit de te réveiller. Tu rouspètes par habitude. Tu entrouvres la fenêtre pour regarder janvier et son relief craquelé. Le coq rechante. C’est la nouvelle année, 365 jours sonnants. La nouvelle année avec ses taches bleues et roses comme des pièces d’étoffe incrustées dans le stratus, et sa lumière rasante certains matins comme celui-ci. On entend presque craquer la grange, la fontaine des voisins (ou alors c’est dans ta tête…). Tu te demandes si tu as manqué le train des bêtes et le coup d’envoi de Maxime et Jonas. La moitié du village, une petite moitié, hiberne comme toi, en gardant l’œil fendillé sur les choses. Sentir cet œil te suffit à ne plus savoir s’il vaudrait mieux pour toi que tu repartes ou non.
Tu dis que c’est une contrée à deux vitesses, faite pour des cœurs différents. Le fil des ans la coupe en deux. Aujourd’hui, la fracture est visible à l’œil nu. Elle se manifeste à travers de petites choses : par exemple, quand le coq chante, mais que tout le monde s’en fout.
D’un côté, il y a ce que tu refuses de comprendre : pourquoi les gens ne se promènent plus à pied, pourquoi ils veulent tous une maison, pourquoi ensuite on ne les voit plus de la journée et que la maison reste close jusqu’à ce qu’ils rentrent à toute allure pour y dormir, pourquoi plus personne ne grimpe aux arbres, pourquoi le parc à jeux est vide, etc. Et d’un autre, il y a ce que tu aimes. Ta contrée sent fort. La bête, la paille, la châtaigne. Ça sent la transhumance, le foin qui roule dans l’écurie. Ça travaille avec les saisons. Sur l’heure du midi, la fourche reste piquée dedans longtemps. Ça t’embrume comme un trésor.
À l’extrême sud de cette contrée se trouve un lieu-dit au petit nom imprononçable pour les simples gens de passage : la Gloye. Ce lieu-dit, c’est ton village, à demi perché sur une butte. Il a ses commodités usuelles : une enfilade de fontaines en pierre, une place de jeux sous les arbres, un café qui fait restaurant avec plat du jour et télé sans le son allumée sur les news américaines, une boulangerie-fromagerie faisant office depuis peu d’épicerie 7/7. Il a aussi sa laiterie construite en 1976 (selon une date en fer forgé), sa pompe à essence et son champ de fleurs en self-service. Et puis il possède son propre système d’autobus scolaire et son rond-point, qui n’est encore qu’un carrefour de fortune fait de blocs en béton, mais l’officiel, le fleuri, ne devrait pas tarder à venir. Bref, la Gloye carbure.
C’est curieux, parce que jamais personne n’y a trouvé grand-chose. Du grès et de la molasse, certainement – et les paquets de boue vendus avec. Mais pour le reste, à part l’herbe et le bois… Pourtant, il a bien dû se produire des trouvailles pour que les camions défilent maintenant les uns après les autres, qu’ils empruntent à grand bruit le giratoire et ressortent ensuite de la carrière avec de la caillasse par mètres cubes servant à l’industrie, aux villas mitoyennes, aux locatifs qui poussent en cercles concentriques. Toi, tu te demandes si ça va s’effondrer un jour, mais tu constates que pour le moment, ça carbure.
Devant la ferme-aux-chats, tu mets de côté cette histoire de carrière. Les petites bêtes donnent l’air de t’avoir attendu (ce qui n’est pas vrai). Mais voilà, les chats t’attendent, dispersés, noirs et blancs, entre les billots de bois, sous le tas de tôle, dans l’encoignure qui recevra en premier le soleil. Tu comptes de loin cette innombrable portée de guetteurs avachis qui t’offrent leurs yeux mi-clos sans accepter pour autant que tu les caresses. Ce sont eux les vrais maîtres de la ferme, ce sont eux les petits seigneurs de la contrée.
Tu ne peux pas résoudre la question du temps : combien la vie t’en réserve ; combien tu as épuisé de ton quota. Tu as déjà usé près d’un milliard et demi de secondes. Un peu moins de deux mille deux cent quarante-six semaines. Tu dis brûlé pour parler des heures creuses. Tu dis vécu pour les autres. Mais bref, ce que tu sais, c’est que la vie en soi n’est avare en rien. La terre en soi non plus. Toutes deux ne se retiennent pas de donner, ne connaissent pas ça, les calculs. Par contre, on peut dire qu’elles se font racheter à bas prix, la terre surtout, et qu’on ne fait pas de très bons maîtres, à gaspiller à ce point leur beauté.
C’est à ça que tu penses énormément pendant que tu regardes les chats et les vieux pâturages. C’est à ça que tu pensais quand le mot lande a surgi, venu peut-être d’Angleterre ou d’Écosse. Le mot a navigué dans ta bouche. Tu aimerais t’en servir pour désigner ce qui t’environne, prairies et vallons compris. Le prononcer à la fois te console et t’assombrit. Combien de temps reste-t-il à ces landes avant d’être garrottées ? Combien de temps aux pâturages avant qu’on les rabote ? Te voilà muet à marcher sur des terres qui te font penser à l’avance à des rognures que tu voudrais bien essayer de sauver un peu. Tu regardes tes mains ; elles te paraissent infiniment inaptes. Pour les chats, par contre, tu ne t’en fais pas ; il en éclot des tonnes chaque printemps.
Ton souci, ce sont certaines poignes dégoûtantes, très habiles, celles qui fréquentent plusieurs négoces à la fois, prêtes à répudier ou vendre quand ça les arrange, prêtes à des compromissions de toutes sortes pour parvenir à des fins pas racontables. Des histoires moches circulent ; les entendre te file le cafard, tu ne préfères pas. Tu hésites des fois à partir t’isoler. Tu ne sais pas si ça compterait comme un acte de courage ou de lâcheté. Ce ne serait pas une solution à long terme en tout cas et ça ne règlerait pas tout (et la compagnie des hommes te manquerait à un moment donné). Mais ce serait peut-être une alternative temporaire, une décision par défaut, dans l’unique but de reprendre des forces. Tu pourrais prononcer le mot lande autant que tu veux. Ensuite, tu reviendrais parmi les tiens. Mais sans doute qu’au retour la beauté et la laideur t’arracheraient les yeux encore plus.
Il y a trois ans, quand tu as vu la pancarte « à louer » placardée sur un cabanon, tu n’as senti aucune hésitation. Des glands de chêne et un vieux fauteuil en osier traînaient sur le semblant de terrasse. Il y avait de l’unanimité : cette ancienne remise était pour toi, suffirait. Tu t’es renseigné, tu as fait connaissance avec la grébiche qui t’a accompagné sur place une après-midi.
Tu n’avais pas remarqué les problèmes de salpêtre et d’humidité. Tu n’avais pas vu que la lumière y était fruste. Ton regard s’était attardé avec envie sur le poêle à bois. Tu avais demandé s’il te serait laissé. C’était oui. Tu avais alors songé aux quelques travaux à entreprendre pour subdiviser l’espace, désenfouir la poutre portante, redonner façon au carrelage. Depuis ce qui serait la chambre, tu pourrais voir grandir le chêne. Des bosquets de noisetiers et de mûres poussaient à proximité. En plus, à ce moment-là, Tristan, qui avait vu partir ses fils un à un, t’avait parlé de son atelier qui ne servait plus à rien qu’aux rats et où tu pourrais bricoler dans tes heures creuses, tant que tu lui laissais un coin pour ses outils ; il n’était pas mécontent de partager l’espace avec un gars comme toi, en souvenir de ton père qui avait été son copain du temps de la petite école. Bref, plusieurs choses s’alignaient comme des noix sur un bâton pour que tu fasses ton baluchon et que tu trouves ton compte au lieu-dit.
Certes, tu t’éloignais de Cyril alors que vous étiez habitués à vous côtoyer au quotidien. Il n’y avait qu’une centaine de pas entre ton logement et la rue des Rosiers numéro 5. Quand ton neveu sonnait chez toi à l’improviste, vous lanciez un coup de fil à sa mère, sans jamais bien savoir quelle allait être sa réaction, selon qu’elle était irritée, pressée ou détendue. Cyril guettait ton expression jusqu’à ce que ce soit réglé, vous preniez le goûter et parce que tu voulais qu’il ait des repères concrets, tu t’efforçais de l’aider dans ses devoirs, mais ça te mettait vite dans tous tes états, les stupidités qu’on lui faisait apprendre, et vous partiez au parc où c’était plus commode de saisir comment fonctionnent les vents, d’où viennent les nuages et ce qu’est une samare.
Les premiers temps de la Gloye, Cyril affichait moins d’enthousiasme à venir te trouver. Il te semblait normal que le petit ait besoin d’un temps d’adaptation. Mais après deux mois sans visite, tu as appelé sa mère. Les excuses d’Alice t’ont paru si vagues, cela t’a mis la puce à l’oreille que le problème ne venait peut-être pas de l’enfant, mais d’elle. Ta sœur a fini par cracher le morceau : ta cabane sentait bizarre. Cette phrase t’a fait bondir. Tu n’es pas doué pour les discussions, encore moins téléphoniques, mais tu avais rarement entendu quelque chose d’aussi absurde, qui flairait le prétexte et la mauvaise volonté. Et alors ? Parce que ça sentait, vous alliez être privés de contact, Cyril et toi ? Le gamin était un homme, avec un jour du poil au menton ; il devait grandir en homme, les hommes vivent dans un monde qui sent ; la vraie vie, ce n’était pas les déodorants, les flacons, les bougies parfumées, ni tous ces trucs chimiques qui font des dégâts qu’on préfère ignorer, un homme, ça sent ce que ça sent, il était hors de question de faire de Cyril une petite nature qui dit qu’il a mal au nez, et d’ailleurs, qui a le plus mal au nez dans cette histoire, hein ?! N’empêche, cette conversation a suffi à ce que tu te démènes pour que la semaine suivante, tu trouves le moyen de chasser cette odeur de moisi et, ce faisant, de dénicher le cadavre d’une fouine en réajustant les plinthes du coin salon.
Le matin, quand tu ressens à ce point les deux vitesses, ça te paralyse et te vieillit d’un coup. On le voit bien. Tu ressembles à un conifère qu’on pourrait abattre sur le champ. Pendant ce temps, les véhicules giclent sur toi la pluie de la nuit. Et puis la beauté fait mal à dire, comme si en la disant, tu ne servais qu’à amoindrir sa portée (c’est ce que tu crois).
Ce qui est beauté pour toi ne l’est pas pour tous. On te l’a dit assez souvent, mais tu résistes à t’en convaincre. Quand tu arpentes la lande, cette miche qu’on grignote, et que monte le double sentiment triste et lumineux, impossible pour toi de croire que ça n’est pas largement partagé. Tu aimerais le crier. Quand tu aperçois des dizaines de grues à la ronde et encore plus de camions sur la route, des camions bigarrés de toutes sortes, impossible de croire que ça peut rendre heureux quiconque. Tu ravales les mots qui te viennent, parce qu’aucun d’eux ne te semble approprié. Mais ce silence te pèse encore plus et tu finis par émettre des phrases pour dire combien ça te déchire d’être le cul entre deux chaises, dans ce lieu-dit insoupçonné qui tire d’un côté et de l’autre. La faille est là. Cette faille, tu la regardes s’élargir peu à peu. La beauté tombera dans le trou.
Il y aurait bien les chants. Les chants te semblent une bonne idée. Un chant par exemple pourrait dire mieux que quoi que soit les joies douloureuses. Un chant pourrait sûrement exprimer la joie subite, lorsque tu sors de chez toi, d’être saisi par les cris rauques du coq. Ils glissent le long du talus à toute heure du jour, ils suspendent le cours du temps et te rappellent sauvagement un fragment d’enfance que tu te plais à ruminer : la hache du poulailler qu’on replantait, une fois l’affaire terminée, dans la souche étoilée de sang. Ces petits meurtres à ciel ouvert, inévitables, que tu n’aimais pas voir, mais que tu attendais néanmoins. Et ces œufs tièdes qu’il fallait déterrer. Il suffit d’un cri pour que tu voyages.