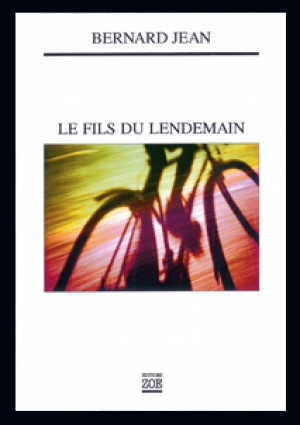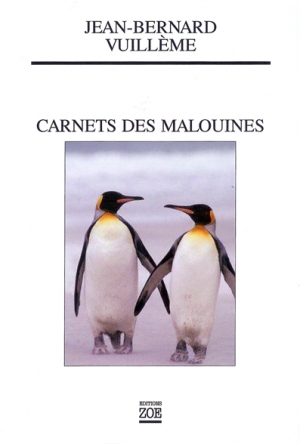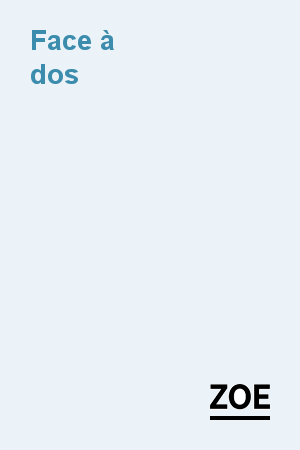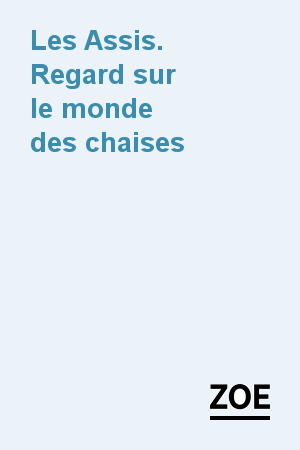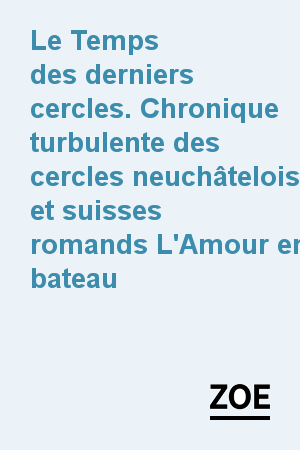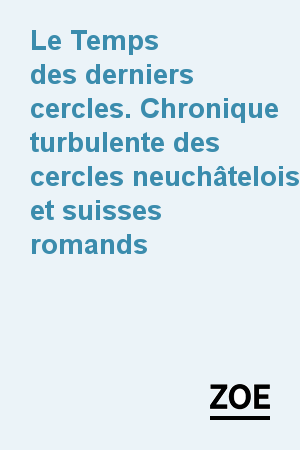parution septembre 2015
ISBN 978-2-88182-955-0
nb de pages 256
format du livre 140 x 210 mm
Sur ses pas
résumé
Suite à la découverte d’une vieille clé, Pablo Schötz décide de remonter le cours de ses anciens domiciles. Mais la bonne serrure tarde à se présenter. Cette clé serait-elle le Graal qui estomperait la distance entre le passé et le présent, qui « rassemblerait le petit garçon et l’homme mûr en train de se demander si ce petit garçon a vraiment existé ? ». Voici le récit haletant d’une cavale au-devant d’un passé.
Périple vertigineux et parcours particulier dans le XXe siècle : le confort de la modernité apparaît dans les foyers avant d’être refusé par les soixante-huitards, le téléphone à touches remplace celui à roue mobile. Lucie la première épouse, une maison de paradis, puis la solitude, puis une nouvelle famille. Passé et présent se bousculent de maisons enmaisons, de couloirs en couloirs, et le motif des sols font fait surgir des souvenirs où le particulier dit ce qui est propre à chacun, l’universel.
Écrivain, journaliste, critique littéraire, Jean-Bernard Vuillème est l’auteur d’une vingtaine de livres, des fictions (romans, nouvelles) et des ouvrages littéraires inclassables, proches de l’essai. En 2017, il est lauréat du Prix Renfer pour l’ensemble de son œuvre. Aux éditions Zoé sont notamment publiés : Sur ses pas (Prix de l’académie romande 2016), M. Karl & Cie (Prix Bibliomedia 2012), Une île au bout du doigt (2007), Lucie (Prix Schiller 1996) et L’Amour en bateau (1990).
En 2019, Jean-Bernard Vuillème a reçu le prix de L'Institut neuchâtelois pour l'ensemble de son œuvre et de sa carrière, une récompense reçue avant lui par Agota Kristof et Denis de Rougemont, notamment.
Jean-Bernard Vuillème est lauréat du Prix de l'Institut neuchâtelois
Remise du prix le 16 mars à 16h30 à l'aula de la Faculté des lettres de Neuchatel
dans viceversa Littérature
Le livre des clés.
Propos recueillis par Elisabeth Jobin et Marina Skalova
« C’est un sept pièces lumineux dont on ne saisit pas tout à fait l’agencement, du moins au premier abord. On s’égare dans un couloir, entre la salle à manger et les toilettes, on en profite pour guigner: quelques portes sont entrouvertes. L’appartement de l’écrivain Jean-Bernard Vuillème est typiquement chaux-de-fonnier. Nulle part ailleurs, on ne pourrait prétendre à un tel espace, à ces hauts plafonds, ce plancher en bois verni. Ni à ce calme: niché dans le massif du Jura, à l’écart des grands axes, La Chaux-de-Fonds cultive ses particularités.
Des particularités à la fois culturelles et sociales, et qui transparaissent dans le roman que nous tend Jean-Bernard Vuillème à notre arrivée. Celui qui s’est intéressé, au cours de son parcours d’écrivain, aux lieux et à leur atmosphère, à leur empreinte sur la mémoire sensible, revient dans Sur ses pas sur les appartements qu’il a occupés, ces espaces qui circonscrivent les vies. «J’ai remonté tous mes domiciles, depuis le premier», nous confie l’écrivain né dans la ville du Haut en 1950. Le porte-à-porte a abouti à une exploration des lieux de la mémoire, «du lieu comme boîte à personnages. Au fond, c’est une idée toute bête, mais c’est justement ce que font les écrivains, à mon avis: persévérer dans une idée toute bête.»
Le livre retrace les explorations systématiques de Pablo Schötz, personnage sur lequel Vuillème projette des expéditions qu’il nous confie avoir faites lui-même au cours de l’année écoulée. Le point de départ est simple: ayant trouvé une clé ancienne dans un tiroir, Schötz se met en quête de la serrure correspondante. Le lecteur accompagne donc cet homme discret tandis qu’il sonne aux portes de son passé. Il demande la permission aux locataires actuels de visiter les lieux. Si chaque étape emprunte un chemin particulier, elle aboutit toujours à un même constat: dans ces pièces qui furent un jour siennes, se sont aujourd’hui substitués des étrangers qui, à leur tour, ont encombré ces espaces de leurs objets, de leurs histoires, de leur mémoire. Si chaque visite réactive le souvenir de Schötz, elle laisse également affluer des impressions immédiates. Les temporalités s’interpénètrent. Et sous le prisme du lieu, se dessine le parcours de l’existence de Schötz.
Voyage dans l’intime
Parce qu’elle est ancrée géographiquement, la trame du livre nous évoque le récit de voyage. «Je n’y avais pas pensé», réagit Vuillème. «Mais vous avez raison: le roman est un voyage. Un voyage dans l’intime.» Car c’est bien de l’intimité de l’auteur qu’il s’agit, puisque Schötz est un alter ego assumé de l’auteur: «J’ai voulu éprouver ces retours sur les lieux. Ce qui ne veut pas dire que tout ce que je raconte est à prendre au pied de la lettre.» De fait, Vuillème use de stratégies narratives pour se protéger et gagner quelque distance sur son expérience réelle. Par discrétion sans doute, il augmente le récit d’un niveau fictionnel supplémentaire en introduisant le personnage du narrateur, un écrivain qui s’engage auprès de Schötz pour écrire à sa place ses pérégrinations. Une précaution qui s’avère être de trop, tant ces jeux formels sont anecdotiques en regard de l’histoire contée.
Car qui frappe à la lecture du livre, c’est bien davantage l’écriture fluide, vive, qui laisse se rejoindre le sensible, le souvenir sélectif et la symbolique du lieu. Les visites d’appartements sont autant d’instants de clairvoyance qui, mis bout à bout, forment un memento mori littéraire. La vie de Schötz, ainsi parcourue, semble se résumer à une série de lieux entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Une observation qui fait trembler le personnage: «Il en pleurerait, cette vie si courte en somme, quelques adresses avant la dernière adresse, quelques mots encore avant la dernière phrase, il n’a jamais pensé vraiment, avant cet instant, qu’il marche vers sa propre mort. La dernière demeure. Déciderait-il à la fin de ce livre de déménager pour être sûr de vivre encore un peu?»
L’écriture prend fin
Sur ses pas tient lieu de bilan de vie. Tout entier, il est empreint d’une mélancolie assumée, d’un regard quelque peu résigné et qui transparait dans notre conversation avec Jean-Bernard Vuillème. L’auteur se surprend à nous parler de sa perception de l’exercice littéraire, entre enchantement et dépit: «C’est magnifique, l’écriture, parce qu’elle donne un sens à la vie», nous confie-t-il en nous fixant de ses yeux bleus. «Bien sûr, il faut compter avec des séances d’isolement. Pourtant, même si on va chercher la matière à l’intérieur de soi, c’est au travers des autres, de l’intérêt qu’on leur porte, qu’on parvient à se situer soi-même dans le monde.» Or, prendre les autres à parti, les emporter dans son projet d’écriture, demande une énergie qu’il n’est plus certain de vouloir dépenser: «C’est la première fois que je n’ai aucun projet en route. Jusqu’ici, quand je terminais un livre, j’avais toujours une ébauche du suivant, ou l’impatience de terminer ce que j’étais en train d’écrire, parce que mon esprit était déjà pris par le projet suivant. Alors qu’aujourd’hui, je me demande si on peut tout simplement décider d’arrêter d’écrire.»
Une question que se posent nombre d’écrivains à la publication d’un récit autobiographique. «J’ai commencé à écrire pour tirer au clair quelque chose qui était noué, littéralement, à l’intérieur de moi», résume Vuillème. Dans Sur ses pas, ce nœud enfin se défait. L’écriture a ce pouvoir, celui de délier, de mettre les choses à plat. C’est le grand mérite de ce dernier livre (mais s’agit-il réellement du dernier?): le propos s’y répand, les phrases passent du baume sur les blessures. L’étape est peut-être nécessaire pour envisager une suite qui, certainement, sera tout autre. »
Elisabeth Jobin
Terre & Nature
Un roman à clé
« Il a fallu cette vieille clé, dénichée dans un tiroir, pour que le personnage de Pablo Schötz pénètre dans le couloir du temps retrouvé. Jean-Bernard Vuillème signe un bel ouvrage d’investigation, où la psychanalyse est bousculée par la fiction et l’ethnologie. Mais au-delà des genres, sur la piste merveilleuse de ses domiciles passés, le personnage finit par se présenter au bureau du narrateur et par prendre ainsi demeure dans l’esprit du romancier Vuillème. Pablo Schötz l’habite alors comme “une petite part de lui-même”. »
notre temps
« (…) Comme à son habitude, Jean-Bernard Vuillème soigne son écriture en auteur vivant au pays de l’horlogerie : grande précision des mots, élégance du ton, un brin d’humour. Les lecteurs chaux-de-fonniers apprécieront plus encore les descriptions de la ville, l’évolution de l’urbanisme et les commentaires concernant les logements typiques de la région. Le final vaut son pesant de cacahuètes, avec un clin d’oeil presque enfantin aux têtes de chapitres qui racontent les découvertes spatiales depuis les années 1950. (…) »
Bernadette Richard
24 heures
« Le 6e roman de l'écrivain chaux-de-fonnier Jean-Bernard Vuillème est une sorte de remake sociologique et contemporain d'un conte à la Perrault. En plus déjanté.
C’est parce qu’il y avait semé des cailloux que le Petit Poucet repéra le chemin de sa maison. Pablo Schötz, le héros du nouveau roman de Jean-Bernard Vuillème, lui, use d’une clé mystérieuse, dénichée fortuitement dans un vieux tiroir, pour tenter de revisiter toutes celles où il a vécu depuis son enfance. S’ensuit un périple ébouriffant, à la fois géographique (géolocalisant) et autobiographique, qui lui fait remonter le temps. C’est-à-dire des étapes de son passé qui furent jalonnées par des domiciles épars. N’osant introduire impunément son énigmatique sésame dans les serrures, il frappe aux portes et se fait accueillir diversement par des locataires réfractaires ou accueillants.
Il s’aperçoit que le vieux téléphone à roue mobile a été partout remplacé par une technologie numérique. Que la vie des couples s’est encore compliquée. Et que dans la maison de ses grands-parents, on ne respire plus à la cave l’odeur du cellier, ni aux cuisines celle du pain frais.
Le surprend aussi une sorte de «décadence domestique» animalière qui permet aux souris de coloniser une maison «infestée de chats». Les neuf chapitres de ce récit rétrospectif sont tous pimentés d’observations amusantes de cet aloi – une façon élégante de camoufler le chagrin de n’être plus un enfant, alors qu’on n’a pas suffisamment «grandi dans sa tête».
Parvenir à divertir le lecteur, tout en lui passant de profondes inquiétudes, réclame une intelligente contention de ses propres émois, et une maîtrise éprouvée des mots qui les sous-entendent et les sous-tendent. » Gilbert Salem
Le Courrier
« Une formidable quête intime et un parcours singulier dans le XXe siècle.
Qui n’a jamais rêvé de revoir les lieux où il a vécu autrefois? Sa chambre d’enfant transformée par d’autres meubles? Le salon alors immense dont les murs semblent s’être rapprochés tandis que les couleurs et les odeurs familières l’ont déserté? Ou ce premier studio après le départ de la maison familiale, meublé de bric et de broc, aujourd’hui occupé par une dame qui lui donne une tout autre atmosphère? Qui sont ces gens qui vivent entre les murs de nos souvenirs? Seraient-ils gênés à l’idée de nous ouvrir la porte sur leur intimité? Quand Pablo Schötz découvre chez lui une vieille clé inconnue, il décide de se lancer à la recherche de la serrure qui lui correspond en visitant tous les domiciles qu’il a habités depuis sa naissance. Lui qui est journaliste et écrivain demande à un ami d’écrire ce qu’il lui racontera de son périple. C’est ainsi ce dernier qui relate la quête de Schötz: narrateur parfois critique et toujours décalé par rapport à l’événement et sa charge émotionnelle, il ne peut s’empêcher d’imaginer, d’interpréter ou de combler les vides, partageant ses doutes dans des intermèdes à la première personne alors que la bonne serrure tarde à se présenter.
La vie des lieux
Le dispositif du dernier roman de Jean-Bernard Vuillème est ingénieux, qui instaure ce filtre pour raconter avec pudeur et un humour subtil une cavale au-devant du passé qui est avant tout quête de soi. Il faut un certain courage pour sonner chez des inconnus, expliquer sa drôle de démarche, exhiber sa clé au détour d’un couloir. Pourtant, hormis une jeune femme aimable qui ne cesse de lui poser des lapins, tous acceptent d’ouvrir leur porte à Pablo Schötz. Sols carrelés et nouvelles moquettes, chambres devenues salons ou l’inverse, pièces redécouvertes et fenêtres sur rues ou jardins lui renvoient le reflet des années enfuies et de lui-même en personnage de sa propre vie, à la fois familier et tout autre – chaque lieu étant une partie singulière de son identité liée à un contexte, à des relations nouées ou rompues.
Comme Pablo Schötz, le Neuchâtelois Jean-Bernard Vuillème est journaliste et écrivain, auteur d’une quinzaine de titres – romans, récits, nouvelles et essais. On se souvient de M. Karl & Cie, satyre inquiétante et déjantée d’une grande entreprise, ou du plus grave et autobiographique Le Fils du lendemain, signé du pseudonyme Bernard Jean (1): il y montrait un narrateur «né de travers», qui se sentait «singe, fils-singe», et se mettait en quête de son père biologique après qu’un test ADN ait confirmé son vertige identitaire. Dans Sur ses pas, le même récit des origines marque les lieux premiers: le dénommé Nebel, nouveau propriétaire de la maison rachetée à un austère pasteur, «a vite pris ses aises avec la jeune locataire mariée» qui vit dans l’un des deux modestes appartements sous les toits et «a malencontreusement engrossé Madame d’un petit Schötz au faciès de Nebel». C’est dire si les lieux influencent dès l’origine les destinées: sans ce voisinage, pas de petit Schötz. Et celui-ci de se demander où il a été conçu précisément – chez le propriétaire ou dans le lit conjugal de ses parents?
Maison familiale, premier appartement du jeune couple qu’il forme avec Lucie, logis avec jardin pour quelques belles années avec leur fils Jean, séparation et retour dans des murs exigus, nouvelle rencontre, nouvelle famille, situation à présent confortable... Les demeures défilent et appellent les souvenirs, l’histoire individuelle s’inscrivant aussi dans une évolution plus vaste pour offrir un parcours dans le XXe siècle. Le décompte des années est marqué par des exergues qui, au début de chaque chapitre, relatent les avancées de l’exploration spatiale, de son essor à la fin de la Seconde Guerre mondiale à la sonde Voyager 1, premier objet fabriqué à pénétrer l’espace interstellaire en 2012. On voit ainsi le confort de la modernité arriver dans les foyers des années 1950 – chauffage central, salles de bains – avant d’être rejeté par les soixante-huitards, les premières voitures et le développement des routes, le téléphone mural à roue remplacé par celui à touche...
Dans la lune
Ce clin d’œil aux explorations spatiales suggère-t-il aussi l’insignifiance de cette quête infime, voire la posture de l’écrivain, lui-même toujours dans la lune, entre deux mondes, distrait par ses lubies? «On ne peut pas remonter le fil du temps, de domicile en domicile, et vivre pleinement ici et maintenant», commente le narrateur. «Et moi, ai-je vraiment habité un seul lieu de mon existence?» se demande d’ailleurs Schötz. La fin du roman nous ramène au présent, lors d’une soirée chez lui où sont conviées toutes les personnes auxquelles il a rendu visite. En quête d’un terme à son livre, le narrateur imagine alors un finale inattendu. Sans trop en dévoiler, disons simplement que Sur ses pas s’achève alors que la «clé du roman» – ou serait-ce de soi? –, récupérée par le narrateur, poursuit sa trajectoire dans le ciel nocturne vers, peut-être, un univers inconnu, «sans murs et sans maisons». Une scène cocasse et poétique qui marque avec finesse l’aboutissement d’une quête intime aussi pétillante qu’émouvante. »
Anne Pitteloud
Espace 2
Le 7 septembre dernier, au Livre sur les quais de Morges, Diane Meur et Jean-Bernard Vuillème étaient les invitiés d'« Entre les lignes » sur RTS-Espace 2.
Le Temps
« Jean-Bernard Vuillème signe un roman à clé. Mais quelle porte ouvre-t-elle?
Pablo Schötz trouve un jour une clé dans un tiroir. Jamais vue. Dérouté, il se lance en quête d’une serrure et remonte le fil de sa vie de logis en logis, de porte en porte. Telle est la fable facétieuse de "Sur ses pas"
Vous connaissez Jean-Bernard Vuillème pour avoir lu, dans ces colonnes, des critiques de sa plume. Mais notre collaborateur est aussi écrivain. On lui doit de nombreux livres, notamment Lucie (1995), qui lui vaudra le Prix Schiller en 1996, M. Karl & Cie, Prix Bibliomedia 2012, et Pléthore ressuscité, qui, en 2008, décroche le Prix Michel-Dentan.
Voici un nouveau roman intitulé Sur ses pas, où Jean-Bernard Vuillème retrouve la verve burlesque et inventive qu’il déployait dans Pléthore ressuscité. Le livre commence comme une fable. Un jour, Pablo Schötz cherche des punaises. Il ouvre un tiroir et tombe sur une clé: "Il s’en est emparé et l’a examinée attentivement avant de l’introduire sans conviction dans deux ou trois serrures. Non, décidément, elle ne correspondait à aucune nécessité actuelle." "Aucune nécessité actuelle", c’est donc dans le passé qu’il va falloir chercher ce que cette clé – un peu fée peut-être comme dans le conte de Barbe-Bleue? – est en mesure d’ouvrir. Ou pas.
Pablo Schötz s’attache tout de suite à l’énigme de la clé. Il se lance dans une quête systématique de la serrure adéquate. Le voici parti en vadrouille sur ses propres traces, remontant le fil de sa vie et de tous ses domiciles antérieurs, sonnant aux portes, rendant visite aux fantômes de son passé, épouses, parents, enfants encore tout petits, confronté soudain à de nouveaux carrelages, à des moquettes aux couleurs criardes, à des cuisines rapetissées par la rénovation, à des chambres à coucher devenues des salons, confrontant des espaces jadis familiers, aujourd’hui transformés de manière étrange par le passage du temps et des différents locataires. Il rencontrera une foule de personnages, pour la plupart inconnus, qui, néanmoins dans un temps différent, ouvrirent les mêmes fenêtres et se brossèrent les dents aux mêmes lavabos que lui.
Jean-Bernard Vuillème ne se contente pas d’inventer une fable: il construit aussi son cadre. Pablo Schötz est écrivain et journaliste – tout comme lui. Vuillème et Schötz partagent, outre quelques aventures communes, la géographie d’un canton, celui de Neuchâtel, avec une prédilection pour les hauts, même si le littoral, tout comme les Alpes que l’on contemple de loin, ne sont pas absents du périple. "Admirer les Alpes et être capable de nommer ses principaux sommets est une marque décisive de suissitude. Les Suisses s’identifient aux Alpes et leur tendance à citer des sommets à la moindre occasion et de les réciter avec une ferveur patriotique est particulièrement marquée chez les habitants du massif voisin bien moins glorieux, du Jura…" Ecrivain et journaliste donc, Pablo Schötz n’en décide pas moins de demander à un confrère – un malin qui dit "je" et qui intervient dans quelques chapitres intercalaires et pour un final grandiose avec toute la troupe – d’écrire, pour lui, ses aventures survenues dans les immeubles du passé. Or, entre l’auteur et son personnage principal, tout ne va pas de soi: "Comme je pourrais le traiter en rabatteur de récits, Schötz pourrait me prendre pour son scribe de service, une sorte de larbin de luxe engagé pour orchestrer l’ultime partie de cache-cache d’un écrivain…", songe celui qui écrit. Pléthore ressuscité interrogeait avec malice la question du personnage – on y voyait un personnage, abandonné par son auteur, revenir soudain à la vie entre les pages d’un livre. Dans Sur ses pas, l’écriture et l’imaginaire sont de nouveau en question. Qui du personnage ou de l’auteur l’emportera? On cherche encore la clé.»
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/2cf26900-52de-11e5-a62b-2400f7582c03/Jean-Bernard_Vuillème_signe_un_roman_à_clé._Mais_quelle_porte_ouvre-t-elle
L'Express arc-presse
« (…) De-là à sonner aux portes pour demander à visiter les lieux, il faut un certain culot ?
En général, je téléphonais quand même pour expliquer ma démarche. Mais c’est vrai, il faut du culot, alors que je suis quelqu’un de timide que 40 ans de journalisme ont plus ou moins réussi à soigner. Pourtant, personne ne m’a fermé sa porte. Au fond, c’est une démarche que beaucoup aimeraient faire, moi j’avais le prétexte d’un livre.
Plus de 50 ans se sont écoulés et vous retrouvez vos premières maisons identiques à vos souvenirs ? Vous poussez un peu ?
Ca semble incroyable mais l’enfance est une sorte de réserve naturelle. J’ai vu ces appartements avec mes yeux d’alors. C’était l’idée de ce va-et-vient de la mémoire entre passé et présent que je voulais explorer. (…) »
Interview par Catherine Favre
Avec Sur ses pas, Jean-Bernard Vuillème poursuit le chemin identitaire initié dans Le fils du lendemain. Mêlant les voix d’aujourd’hui aux sombres présences des fantômes du passé, Pablo Schötz revisite tous ses domiciles, afin de trouver dans quelle serrure enfiler la clé trouvée par hasard au fond d’un tiroir. Cette quête existentielle dans des lieux, « des maisons qui grouillent de vies parallèles, de caresses et de coups, de tendresse et de violence » est aussi « un récit d’aujourd’hui sur un récit d’hier, la trame même de l’histoire depuis que le monde existe. Ces étranges remontées de domiciles, ces retours aux sources enseignent la fatalité de la solitude à travers la mémoire qui brasse, mélange, efface, et telle la marée, recrache des restes sur la plage. » Depuis quelques années, l’auteur consacre tout son temps à l’écriture parce qu’il n’a pas pu vouloir autre chose. C’est porté par la nécessité, violente parfois, de traduire le monde que Jean-Bernard Vuillème a misé sur l’exigence folle d’écrire de la plus belle manière des histoires universelles – dont la clé serait, peut-être, celle d’un univers inconnu, sans murs ni maisons.
Vincent Bélet, Payot La Chaux-de-Fonds
La Mort en gondole (2021)
« En pleine crise d’obsolescence », le narrateur prend le train pour Venise où il va prêter main forte à Silvia. Cette éternelle étudiante consacre une thèse à Léopold Robert, peintre neuchâtelois tombé dans l’oubli, mais célébré dans l’Europe entière dans la première moitié du XIXe siècle. Plus fascinée par la réussite de cet homme, parti de rien, que par son œuvre, Silvia tente de comprendre comment il en est venu à se trancher la gorge dans son atelier, à 40 ans. Avec son acolyte, elle écume les lieux, ruelles, monuments, par lesquels le peintre est passé. Leurs dialogues, comme un match de ping-pong, ponctuent une Venise tour à tour du XIXe et du XXIe siècles.
M. Karl & Cie (2011)
Un homme se rend à un entretien d’embauche dans une vaste compagnie d’assurance à Gorgengut, un lieu difficile d’accès. A sa grande surprise il est immédiatement engagé au poste de médiateur. Son regard interrogateur et son imagination semblent avoir convaincu la directrice des ressources humaines. Il sait observer, explorer, garder ses distances, se montrer proche et humain.
La maison d’assurances pour laquelle il déploie son ardeur professionnelle est faite de labyrinthes et d’opacité. M. Karl, en cherchant pathétiquement sa place dans l’entreprise, fait découvrir au lecteur les aventures rocambolesques qui se déroulent en coulisses.
Dans un univers kafkaïen et chaplinesque, Jean-Bernard Vuillème explore les relations humaines au sein de la direction, ainsi que les fantasmes de M. Karl, avec un grand sens de la dérision.
Une île au bout du doigt (2007)
Le Fils du lendemain (2006)
"Celui qui est né de travers se sent singe, fils-singe, et se retient parfois au milieu d’une phrase de ne pas pousser des cris de singe. Il trouve ses racines dans les grimaces et les facéties de ses plus lointains ancêtres et rôde volontiers autour de leurs cages.»
Ce roman raconte le vertige identitaire d’un homme à la recherche de son père biologique. Le Fils du lendemain dit d’une manière à la fois brûlante et distanciée, grave et légère, le poids de ces indicibles et banales vérités dissimulées au coeur des familles unies ou désunies.
Carnets des Malouines (2005)
Les Malouines ou les Falkland ? Deux noms pour un même pays font un bon sujet de conflit et promettent un sac d’embrouilles. Mais tout serait calme depuis juin 1982 quand les Britanniques, manu militari, en ont expulsé les envahisseurs argentins. Ce qui n’empêche pas ces mêmes Argentins de continuer d’appeler Malvinas cet archipel situé à 400 kilomètres de leurs côtes. Or, malgré les 12 000 kilomètres qui l'en séparent, Londres voit dans cette appellation une preuve supplémentaire de la nature manifestement britannique des Falkland, puisque les Argentins n’avaient fait qu’emprunter le nom de Malvinas aux marins bretons de Saint-Malo qui les avaient baptisées Malouines… Plus de vingt ans après la guerre qui a vraiment fait de Margaret Thatcher la Dame de fer, la question de la souveraineté oppose encore Argentins et Britanniques.
Parti là-bas pour écrire un roman, Jean-Bernard Vuillème en a d’abord rapporté ces Carnets des Malouines. Ses notes, prises au jour le jour dans cette minuscule communauté de Britanniques du bout du monde, protégés par deux soldats pour trois habitants et coupés de tout lien avec l’Argentine voisine, ne manquent ni d’intérêt, ni surtout de piquant.
L'Amour en bateau (2002, Zoé poche)
Face à dos (1999)
Lucie (1995)
Sur ses pas: extrait
Chapitre I
Le vol spatial prend son essor à la fin de la Seconde Guerre mondiale grâce aux avancées allemandes dans le domaine des fusées.
Tout a commencé le jour où Pablo Schötz a ouvert un tiroir en quête de punaises et qu’il est tombé sur une clé dont l’étrangeté lui a sauté aux yeux. Non, se dit-il, je ne l’ai jamais vue, et au lieu de saisir la boîte de punaises, il s’en est emparé et l’a examinée attentivement avant de l’introduire sans conviction dans deux ou trois serrures. Non, décidément, elle ne correspondait à aucune nécessité actuelle. Peut-être l’avait-il trouvée en débarrassant l’appartement de sa mère, quelques années auparavant, avant de la glisser distraitement dans ce tiroir ? De petites énigmes de cette nature jalonnent nos existences et ne retiennent pas notre attention plus de quelques secondes, éventuellement quelques minutes. Mais il arrive parfois qu’au lieu d’effleurer notre regard et notre esprit, une énigme du genre de cette clé sans serrure nous harponne et ne nous lâche plus, et nous absorbe plus que de raison dans son mystère d’objet abandonné dans un tiroir.
La découverte de cette clé a conduit Pablo Schötz à se lancer dans une recherche systématique, autrement dit à remonter le cours de son existence, de domicile en domicile, chronologiquement, jusqu’à trouver la serrure correspondante. Peut-être fait-il semblant de chercher la serrure pour mieux remplir le grenier de sa mémoire. En tout cas il marche en quête de trous dans son passé, trou de serrure, trou de mémoire, il tâte la clé tapie dans les profondeurs d’une poche. Il marche en direction du premier domicile, un trou noir, celui dont il est sorti un jour, ou plutôt un soir, fruit des amours clandestins de sa mère et de l’ancien propriétaire des lieux. Il dira Bonjour, j’ai vécu ici avant vous, c’était chez moi avant d’être chez vous, bonjour, si nous parlions un peu !. Les habitants d’aujourd’hui feront récit à l’habitant d’hier, quoi qu’ils disent et même quoi qu’ils taisent. Les lieux parlent. Ce sera un récit d’aujourd’hui sur un récit d’hier, la trame même de l’histoire depuis que le monde existe.
Le vertige de Schötz est dans sa tête comme la clé plongée dans les profondeurs d’une poche. Trouvera-t-il la serrure faisant défaut à sa mémoire ? Il aimerait aller là où il vivait sans négliger des données comme la configuration d’un appartement, la largeur d’un couloir ou encore le crépi d’un mur.
(…)
Chapitre II
Lancé le 4 octobre 1957 par l’URSS, Spoutnik 1 est le premier engin placé en orbite autour de la Terre. Il marque le début de l’ère spatiale.
Premières luttes, premières victoires, premières défaites. Premières peurs. Première bonne amie. Premières bagarres. Premiers baisers. La valse des Jos, d’abord Josette et plus tard Josiane et finalement Joséphine. C’était bon la première enfance, tout dans l’instant, le jeu, les copains, loin du monde des grands idéalisé et rassurant – on verrait plus tard pour leur ressembler, au-delà de l’éternité. Et quelle confiance ! Confiance en lui en dépit de. Le petit Schötz sentait confusément l’intrigue nouée en lui, dans sa chair, mais ne pouvait imaginer autre chose que le savoir, la solidité, l’amour de ses parents. Nebel vivait enfoui en lui et évident, enfui et inimaginable, M. Euh Un Peu, sans parler de Maman qui s’y frottait encore lors de rendez-vous clandestins, sa nostalgie de la maison d’avant, du lac, de la décontraction des bourgeois qu’elle ne retrouvait pas dans la bonhomie populaire de la ville du Haut où ils s’étaient installé dans un quatre pièces pour se rapprocher du lieu de travail du père et disposer de davantage d’espace que dans le nid d’aigle de leur premier domicile conjugal. Nebel était une plaie suintante sous une croûte aussi souple qu’une peau. Les apparences étaient sauves.
Il y avait Maman et Papa quoi qu’il en soit et quand il devint clair qu’entre eux tout allait de travers, l’enfant trouva la force de croire que tout allait s’arranger. Il aurait tout misé sur l’harmonie conjugale entre ses parents, contre tout bon sens, les enfants n’ont aucun bon sens, la vie aurait dû correspondre à une image d’Epinal malgré les ombres du mensonge et le sentiment d’étrangeté que lui inspirait son père. Papa ne ressemblait pas à papa ainsi qu’en témoignait la stupeur épidermique qu’ils éprouvaient l’un et l’autre, le père voyant bientôt clairement dans son fils cadet un avatar du vieux prince charmant de sa femme – mais c’était papa.
On ne se débarrasse pas de l’enfance, on aimerait toujours baigner dans cet horizon immense, ce temps si vaste, mais il se perd dans cette éternité et on ne le retrouve pas en revenant sur ses pas. Schötz marche vers l’adresse où il a passé les dix premières années de son existence. Il foule le sol de ses premiers pas, longe le trottoir sur lequel un petit garçon poussait sur les pédales de son tricycle. Ce petit garçon n’existe plus, c’était lui, Schötz, on ne le verra pas aujourd’hui reprendre ses anciennes chevauchées sur son tricycle, même adapté à sa taille adulte, les gens diraient Regardez-moi ce grand fou, ce cinglé sur son tricycle sur mesure ! Et tandis qu’il marche dans cette rue où il a tant joué, aujourd’hui quasi déserte, sans jeux, sans cris, sans bagarres, Schötz revoit avec une précision confondante la vieille photo de lui sur son tricycle. Ici même où marche le grand Schötz, quasi vieux Schötz, n’est-ce pas étonnant, oui, étonnant, comme la banalité même et son invisible dédale en chacun de nous ?
Une vieille image lui apparaît avec netteté. Assis sur son tricycle, le petit Schötz fixe l’objectif, bien conscient, dirait-on, qu’il pose pour la postérité. Il esquisse un sourire. De petites lunettes cerclent son regard, il a un visage plein avec deux petites joues rondes et un front haut barré par une mèche blonde. Sa tête est ceinte d’un bonnet de laine (rouge, se rappelle-t-il, bien que l’image soit en noir et blanc) en forme de casquette dont les larges attaches lui couvrent les oreilles avant de s’amincir en un cordon qui se boutonne sous le menton. C’est la fin de l’hiver, trottoir noir et luisant, de la neige colle aux roues, au bord des pédales. Le petit Schötz penche légèrement le buste sur la gauche, ses mains gantées de laine posées sur le guidon. Il porte une veste imperméable à fermeture Eclair non tirée jusqu’en haut laissant apparaître un pull dans l’échancrure et la peau tendre du cou. Les pieds sont posés bien à plat sur le trottoir, dans des bottes noires en caoutchouc assez larges pour contenir deux bons tiers de canons de pantalons également noirs sous les genoux. On sent que le petit Schötz brûle de reprendre les pédales. A l’arrière-plan, une bande de neige lourde, et, au pied de l’immeuble, un soupirail protégé par un grillage. Ainsi posait le petit Schötz, ainsi se voit-il quelques décennies plus tard en train de longer le même trottoir, tripotant une clé au fond d’une poche. Une clé qui débloquerait la serrure entre ces deux moments, et, par magie, rassemblerait le petit garçon et l’homme mûr en train de se demander si ce petit garçon a vraiment existé ?
Bien sûr qu’il a existé, sinon comment saurait-il qu’il vivait ici, comment ferait-il pour ressentir à ce point la permanence des lieux et l’inconsistance de sa propre vie ? Et même l’inconsistance de tout souffle et de toute chose. Le nom de la rue a changé, ou plutôt de la portion de rue inscrite dans le prolongement de la rue du Parc soudain interrompue par un champ longtemps vierge dans lequel une usine et plus tard un grand magasin avaient été construits. Les numéros situés dans le prolongement, au-delà du champ, constituaient un casse-tête pour les représentants de commerce qui n’arrivaient jamais, ou trop tard, à la fin de la rue du Parc. Cette portion de rue a été rebaptisée rue des Bouleaux, nom justifié par la présence de quelques-uns de ces arbres aux troncs blanchâtres qui donnent parfois l’impression de peler comme les gens à la peau trop sèche. Il y en avait deux autrefois, entre les deux maisons où une surface herbeuse, aujourd’hui remplacée par un garage collectif, servait de terrain de jeu. Les lieux où Schötz avait vécu ses premières années n’avaient que peu changé, mais l’adresse n’existait plus.
Et les habitants de ce temps-là, se demande-t-il en longeant le trottoir des chevauchées en tricycle, que sont-ils devenus ? Une nuée de visages et de silhouettes s’élève dans sa mémoire, des enfants de tous âges probablement méconnaissables ou même disparus. Disparus, comme son père depuis quelques jours. Sa VW Coccinelle noire au bord du trottoir. NE 5947. Des objets se gravent dans la mémoire, des chiffres, avec la force d’un totem. L’adresse disparue : Parc 223. Des visages aussi, des regards, de manière plus floue, s’insinuent au point d’être plus présents que jamais. Des expressions. Des voix. Et d’autres fois pas grand-chose, à vrai dire, alors qu’il allonge le pas, dépasse en imagination sa lointaine incarnation en petit garçon fonçant sur son tricycle. Il voit encore des losanges sur un pull de son frère Otto et un pli enfantin dans le cou de Josiane, la fille d’en face dont il était amoureux et qu’il observait derrière une petite fenêtre, juché sur un banc… Autre temps. Autres gens. Autre monde. D’ailleurs, ils ont aussi changé la porte, constate-t-il en la poussant, ce n’est pas la même que celle de son enfance, pareillement vitrée, certes, mais une boule ronde argentée a remplacé un poussoir fait d’une barre noire tirant une diagonale sur la vitre. Hormis ce détail… pour le reste… Schötz se retrouve dans le même escalier et chavire dans l’enfance d’après le tricycle. Il rentre tout juste de l’école. Mêmes marches de grès piquées de petites taches noires, et, incrusté au centre de la marche, un caoutchouc de couleur verte. Assez étroit, l’escalier est tracé sur les côtés par une double rangée de carreaux noirs et à droite d’une rampe constituée d’un muret surmonté d’un tablard en bois. C’était une maison neuve lorsque ses parents y avaient emménagé avec leurs deux enfants en 1951.
Toujours les mêmes caoutchoucs au milieu des marches. Un demi-siècle de pas, d’allers et venues, de récurages. Increvable caoutchouc. Il y a quelque chose d’insultant dans le fait qu’une chose aussi laide et insignifiante survive aisément à tous les êtres humains qui l’écrasent sous leurs pas. Qualité suisse ? Parlant des maris d’alors en train de récurer, Maman disait toujours Un comme ça, moi, j’en voudrais pas, pas des hommes, des pattes à relaver, je préfère encore le mien avec tous ses défauts ! Petit Schötz en déduisait que papa était un homme, lui, un vrai, qualité suisse, et que tous ces petits fonctionnaires dévoués à leurs épouses ne valaient pas pipette. Il les considérait à travers le regard de sa mère comme des antimodèles. Il valait mieux tromper sa femme, Maman s’en plaignait pourtant amèrement, que d’être fidèle et de récurer les corridors. Maman ne percevait nullement ces époux récurant en pionniers de l’émancipation féminine et de l’égalité, mais en types réduits à l’esclavage par des matrones. Pour petit Schötz, un homme ne devait par conséquent jamais s’abaisser à de telles tâches et il ne pouvait s’empêcher d’éprouver du mépris chaque fois qu’il croisait une de ces « pattes à relaver » à genoux dans l’escalier.