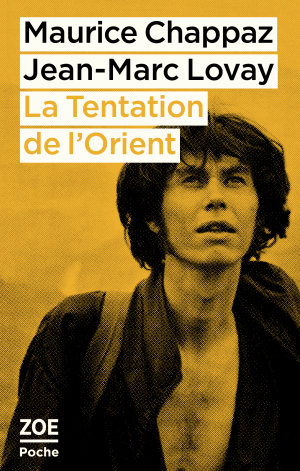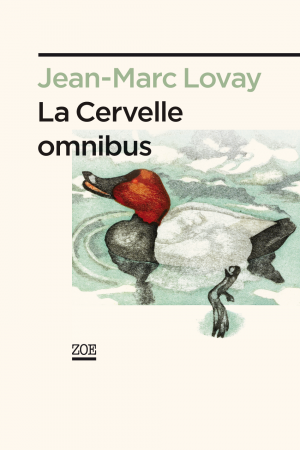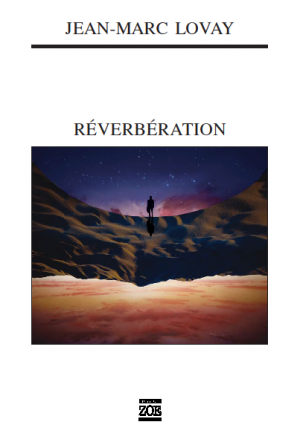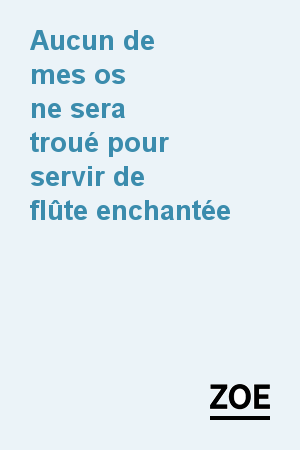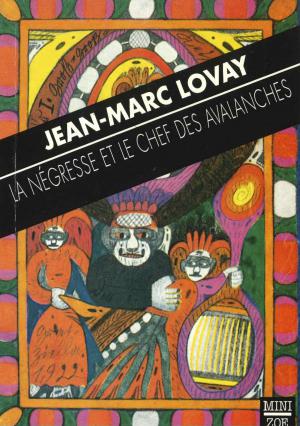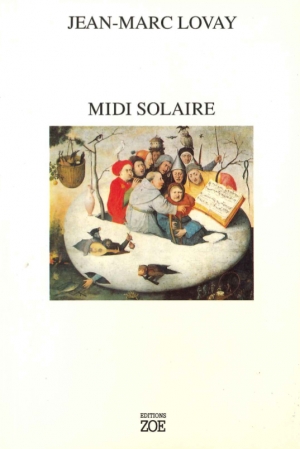parution janvier 2009
ISBN 978-2-88182-653-5
nb de pages 160
format du livre 140 x 210 mm
prix 28.00 CHF
Tout là-bas avec Capolino
résumé
p> L’inventeur Capolino avait enfin réussi à ne plus jamais mourir.
Tout là-bas avec Capolino est le dixième roman de Jean-Marc Lovay, qui a publié en premier Les Régions céréalières chez Gallimard en 1976. Entre montagnes et forêts, c’est parfois la trace d’un blaireau qui emmène son écriture.
Jean-Marc Lovay quitte l’école à 16 ans. Il voyage en Asie, au Proche-Orient, en Australie, en Ecosse, s’arrête longtemps à Madagascar. Il vit dans des villages de montagne, il vit de toute façon résolument à l’écart. La publication chez Gallimard de ses trois premiers romans, des prix littéraires, un succès d’estime à grande échelle, tout cela ne l’écartera pas de sa trajectoire rigoureuse : non pas hors du monde, car il y est peut-être bien plus que nous, mais loin d’une société nécessairement compromise.
Pour autant, l’écriture de Lovay est le contraire de l’austérité, elle est aussi audacieuse que libre. Lovay creuse dans la langue comme dans un matériau, obstinément, de toutes les manières, tout en sachant aussi laisser le souffle faire.
Comme une danseuse à la barre tous les jours, Lovay impose à son imagination déferlante une rigueur et un travail acharné sur les mots. Il sait garder cette liberté d’esprit absolument singulière tout en la précisant, la taillant, l’affûtant grâce au baroque de sa langue.
Citations sur l’œuvre de Jean-Marc Lovay
JEAN-MARC THEYTAZ, Le Nouvelliste, 09 juin 2015
« Jean-Marc Lovay, lauréat du Prix de l’Etat du Valais 2015. Cette récompense cantonale suprême, arrive à point nommé pour saluer l’œuvre d’un écrivain de dimension nationale et internationale.
Jean-Marc Lovay c’est l’imaginaire, la fulgurance verbale, le jaillissement créateur, un auteur qui a su créer au long de décennies de travail un univers hors normes, qui a cassé les codes sociaux, déconstruit les narrations linéaires, dépassé toutes les logiques et rationalités avec une puissance et un souffle onirique extraordinaires. (…) »
JERÔME MEIZOZ
Auteur de Le Toboggan des image. Lecture de Jean-Marc Lovay, Zoé 1994
Que Lovay soit suisse, ou plutôt valaisan, est un fait non négligeable, même s’il est à mille lieues de faire du régionalisme littéraire. Valaisan, c’est-à-dire, pour un Parisien, venu d’une «province qui n’en est pas une», formé dans un canton dont la tradition intellectuelle a été monopolisée jusqu’à il y a peu par l’Eglise catholique. Géographiquement, c’est naître dans le berceau ou la tombe dentelée des Alpes. Cet enfermement intellectuel et géographique, Lovay le refuse absolument. D’où sa fascination pour les cols alpins, surtout promesses d’un autre côté, d’un voyage.
MARIE-LAURE DELORME Journal du dimanche. Magazine littéraire
Jean-Marc Lovay, ce styliste prodige à la vision noire, passe pour un auteur difficile et élitiste. C’est bien sûr le cas. Mais la vue n’est-elle pas d’autant plus belle que le chemin a été ardu ?
DIDER JACOB Le Nouvel Observateur
Le monde de Lovay est, on le voit, à l’envers du nôtre : les objets parlent, pensent, vivent, dans une gigantesque prosopopée qui participe de ce que l’auteur, résumant son entreprise, appelle la «pure dysharmonie du chant».
GERARD MEUDAL Le Monde
Et le paradoxe de ce style incantatoire est de créer un silence assourdissant, de celui qui s’installe au lendemain des grandes catastrophes. Le livre refermé, on se surprend à guetter les bruits d’une nouvelle manière, à tenter de percevoir le chant des oiseaux, et le silence qui suit est encore de Lovay.
Interview de LOVAY par Didier Jacob pour Le Nouvel Observateur extrait (2003).
Vous vivez toujours en ermite, dans la montagne.
Je n’ai plus les bêtes. Je me lève à 6 heures, je relis ce que jai fait la veille et je m’y mets. Parfois je coupe du bois, ou bien je vais marcher sur les crêtes frontalières. Je fais quelquefois 50 kilomètres pour être à un endroit qui me plaît. Les champignons, si j’en vois, je les laisse. Si quelqu’un d’autre les trouve, tant mieux. Par contre, je jardine. A une époque, j’avais mille mètres de potager, je vendais des oignons, j’avais des poules, des lapins, je faisais des tommes, j’échangeais les fromages contre autre chose. Quand je suis allé à Madagacar, en 1986, j’avais ma présure, je me disais que je pouvais toujours gagner de l’argent avec ça.
Comment écrivez-vous ?
J’ai écrit «Polenta» la nuit, à la bougie. Je descendais de temps à autre pour les chèvres. «La Conférence de Stockholm», je l’ai écrite en Australie, chez l’habitant. Du soir jusqu’au matin, avec une bouteille de gnôle. A une époque, j’avais un minuscule alambic que mon frère m’avait fabriqué avec une Cocotte-Minute. Je la mettais sur un poêle à gaz, avec mon pruneau que j’avais mis à fermenter. Avec cet équipement, il me fallait deux heures et demie pour faire une bouteille. J’ai corrigé le «Colonel Fürst» comme ça : je travaillais deux heures et j’avais mon litre de prune. Quand je travaillais bien, j’en faisais trois dans la soirée.
On a l’impression dans vos livres de pénétrer dans un monde à l’envers.
Vous dites ça, mais il m’est arrivé de retourner ma table pour avoir l’impression de travailler après un tremblement de terre. J’ai écrit comme ça, sur ma table retournée comme un plafond qui m’écrase.
Vos livres sont une suite de visions. Comment vous viennent toutes ces images ?
Je les vois. Les gigantesques cuisines, c’est parce que, quand j’étais môme, la famille de mon père avait un hôtel. Il y avait des fourneaux à bois, de l’eau chaude qui fumait à gros bouillons. Ça me fascinait. Je voulais être casserolier, quand j’étais enfant. Les immenses toitures de métal, je les vois. J’entends l’eau qui coule. Je vois tout, je vois les immenses tortues qui avancent, devant moi, comme de gigantesques dolmens.
La Tentation de l'Orient (2023, Zoé poche)
Tenue entre 1968 et 1969, cette correspondance entre Maurice Chappaz, poète d'âge mûr, et Jean-Marc Lovay, écrivain en gestation, saisit en direct les plus fortes étapes de leurs voyages intérieurs.
De Paris de mai 1968, du Valais ou de Laponie qu'il parcourt sac au dos, Chappaz encourage Lovay à suivre son instinct, comme lui-même autrefois.
De Kaboul, New Delhi ou Katmandou, Lovay adresse des lettres inspirées, prélude de l'oeuvre à venir: il rend compte de son cheminement vers l'inconnu et se dépouille de sa carcasse culturelle. Seul demeurera le conseil de son aîné: "garder du primitif en circulation libre".
Préface de Nicolas Bouvier
Postface de Jérôme Meizoz
« Incroyable, abominable, effroyable, épouvantable, tels auraient été les mots que j’aurais lancés dans l’unique rue du village, si j’avais recouvré l’usage de la parole (à ce moment de la journée d’hier), quand je vis un superbe mouton à tête noire piétiner l’avis de décès de la femme du colonel Fürst. Comme je voulais depuis toujours approcher le colonel Fürst, je me rendis immédiatement à sa maison, pour lui présenter mes condoléances en lui apportant cet avis de décès.»
La Cervelle omnibus (2013)
Ces poèmes en prose, écrits par Lovay dans sa jeunesse
et aujourd’hui complétés, sont fulgurants, parfois lapidaires.
Ici résonnent des clameurs violentes que la barbarie du
temps a engendrées.
Le monde des hommes et celui des animaux sont
indissociablement liés, la beauté de la nature, du roc, de
la glace et du ciel rayonnent. Aucune prétention à la
prophétie, comme Rimbaud, souvent évoqué à propos
de son oeuvre, mais la vision tourmentée d’un esprit qui
veut rester lucide.
« Ce texte semble être une formidable et nouvelle
machine à fabriquer de l’énergie » (Didier Jacob à propos
d’une mise en lecture théâtrale de La Cervelle Omnibus).
Chute d'un bourdon (2012)
« Mère Machyne, grande réparatrice et endormeuse des corps, et père Maschain, petit arrangeur et consolateur des âmes, à la seconde où j’arrivais au bout de la traversée d’une heure qui était peut-être déjà mon avant-dernière heure, et grâce à de prétendus expiatoires hurlements inhumains parvenus jusqu’à moi par un tunnel creusé à travers le ciel, j’apprenais que vous ne pourriez plus jamais m’entendre ni me répondre et je recommençais à penser à ce que je vous dirais encore si je vous apercevais pour la véritable dernière de toutes les fausses dernières fois au-delà de ce qui était peut-être déjà le dernier nuage de la vaporeuse et apaisante brume blanche… »
Dans les romans de Lovay, on est emporté par la langue et on suspend toute recherche d’un sens immédiat pour laisser affleurer le plaisir de lire des phrases dont le puissant mouvement vous entraîne irrésistiblement vers un sens ultime même si celui-ci se dérobe au fur et à mesure de la lecture. A propos de cette écriture, Charles Méla écrit : «C’est aussi une forme de sainteté, d’exigence absolue, de ne jamais céder sur son désir de quelque chose qui soit tout autre.»
Aucun de mes os ne sera troué pour servir de flûte enchantée (2009, Zoé poche)
« Et en me retournant vers le ciel dénué de pitié et de cruauté j’entendais finir d’un coup les chants de colère et les chants de joie des oiseaux. »
Réverbération (2008)
L’ancien meilleur apprenti pleureur final Krapotze espérait encore être élu Grand Suicideur, pendant qu’il emmenait son fidèle complice chez Frauline-l’Illuminatrice, là où elle ne pourrait donner naissance à l’unique brodeur de linceul pour oiseaux, le grand Rapetissé, qu’après avoir refusé d’en pleurer la future disparition et rendu sa liberté à l’unique larme encore prisonnière de son âme. Et quand devenus traqueur et poursuiveur de voleurs et de truqueurs de rêves, Krapotze et son complice réussiront à n’être ni grandis ni perdus par leur sublime vanité à vouloir incarner les prodigieuses ombres acharnées à poursuivre l’ombre noire de l’Arracheur de mémoire, personne ne pourra plus les empêcher d’entrevoir encore une fois la Sauveuse, revenue des confins du seul vrai rêve qu’aura été leur vie, pour leur souffler d’oublier que c’était grâce à elle qu’ils étaient nés pour disparaître et qu’ils comprendraient enfin pourquoi elle connaissait toujours tout sans jamais rien reconnaître.
Depuis la publication des Régions céréalières (Gallimard, 1976), «l’écriture de Jean-Marc Lovay fait exister un univers mental hanté par la folie, un monde de machinations fantastiques et d’agressions obsédantes dont l’exploration est conduite avec rigueur, humour et dans une cohérence angoissante» (Charles Méla). Ainsi dans «Berceuse», le premier des deux chapitres de Réverbération, neuvième roman de Lovay, le personnage central est précipité au coeur même d'une campagne électorale pour faire miroiter des «suicides généralisés avec ou sans enrichissement de sommeil».
Midi solaire (2004, Zoé poche)
«Tu parles de guêpes, dit l’Invaincu, comme ma mère parle d’un toit d’où je ne suis pas tombé, mais tu sais autant que moi que pour une mère, dès qu’on est né on commence à tomber. Vers la misère ou vers la richesse, toujours pour une mère on tombe, et le seul filet qui puisse recevoir la divagation de nos acrobaties, c’est la tombe. Trop de mères, trop de tombes, moins de bombes, moins de guerres.»
Seul, dans un monde de dictature et de guerre, sans échappatoire, un narrateur dévide tous les fils de plomb de sa révolte dans un langage puissant et outrancier.
Aveuglé jusqu’à l’excès de clairvoyance, l’homme poursuit dans les six récits l’unique élément qui pourrait le réparer dans son destin d’être humain : la liberté.
EpÎtre aux Martiens (2004)
Asile d'Azur (2002)
Polenta (1998, Zoé poche)
La Tentation de l'Orient (1997, Zoé poche)
La Négresse et le chef des Avalanches et autres récits (1996, Minizoé)
Midi solaire (1993)
«Tu parles de guêpes, dit l’Invaincu, comme ma mère parle d’un toit d’où je ne suis pas tombé, mais tu sais autant que moi que pour une mère, dès qu’on est né on commence à tomber. Vers la misère ou vers la richesse, toujours pour une mère on tombe, et le seul filet qui puisse recevoir la divagation de nos acrobaties, c’est la tombe. Trop de mères, trop de tombes, moins de bombes, moins de guerres.»
Seul, dans un monde de dictature et de guerre, sans échappatoire, un narrateur dévide tous les fils de plomb de sa révolte dans un langage puissant et outrancier.
Aveuglé jusqu’à l’excès de clairvoyance, l’homme poursuit dans les six récits l’unique élément qui pourrait le réparer dans son destin d’être humain : la liberté.
Conférences aux antipodes (1987)
Le Convoi du colonel Fürst (1985)
Tout là-bas avec Capolino: extrait
C’était encore un jour où soudain je reconnaissais le visage souriant au fond de l’image qui avec la mélancolie d’un vieux portrait cloué contre un mur vibrait à la surface d’une anse protégée par un coude du ruisseau, et en chantant les grillons ne se troublaient pas d’avoir déjà oublié le nouveau chant qui ne serait jamais entendu, quand j’entendais le rire chanteur qui montait de derrière ce visage en craquant pour traverser une paroi d’os et se moquer de mon regard encore vivant, et railler les yeux éperdus de voir toute ma vie hésitant à se jeter dans le puits d’une image pour y entraîner mon esprit, parce que je croyais qu’un visage ne vivait déjà plus et ne serait pas mort tant que n’aurait pas fini de se vider le puits au fond duquel se reflétait n’importe quel visage, et tant que ce puits ne serait pas frémissant de la fraîcheur d’un visage enfin vide de toute heureuse et malheureuse expression.
Et alors je pouvais penser que je n’étais jamais descendu en bas vers le visage souriant et riant dont les yeux regardaient en haut pour voir encore plus haut, et c’était désormais pour toujours que le visage remontait à la surface en perdant le rire menteur et le faux sourire, avant de faire sortir le commencement d’un pleur de toute la matière qui était le monde où je pouvais encore survivre, en même temps que le souvenir d’un visage commençait à être chanté par un groupe de grillons ignorant qu’ils chantaient le souvenir de l’unique visage qui se déformait pour épouser une des formes du véritable visage de Capolino revenu vers moi pour me demander de repartir avec lui au loin de nos lointains de toujours, et qui me demandait de le regarder encore comme certains jours merveilleux je l’avais regardé en traversant la couleur de ses yeux tout en lui laissant entrevoir la confuse vision de ce qui bientôt s’illuminerait au-delà des horizons ultimes de son âme, et d’essayer d’arriver très vite et peut-être d’un seul coup à emmener dans l’innocent mouvement dont il devinait que ma conscience essayait de le suivre, tout ce qu’il ne pouvait pas lui-même percevoir et qu’il ne pourrait peut-être plus jamais concevoir au-delà de ce cul-de-sac de l’extrême arrière du fond de sa propre conscience, avant d’accepter de m’en aller en marchant devant mais aussi en courant derrière lui là-bas où ni moi ni lui et encore moins personne ne pourrait imaginer si ce serait pour revivre une vie en ayant oublié qu’elle avait déjà été vécue et surtout ne pas revivre toujours la même vie, ou pour vivre et disparaître encore dans l’esprit de l’immortelle créature qui depuis notre renaissance commune aspirerait à mourir pour connaître notre plaisir de renaître.
***
Et maintenant le ton d’un chant de grillon qui avait passé derrière le chant d’un autre grillon m’incitait à regarder le ventre du nuage qui grandissait sous la terre au-dessous du chemin et je savais qu’il n’y avait pas de plus belle terre sur un plus beau chemin, et en pensant à celui qui était entré dans mon coeur en même temps qu’il s’était à jamais éloigné de moi-même, j’ignorais s’il était le seul à pouvoir penser que le ventru nuage n’était pas une idée ayant été invitée ou s’étant glissée dans la forme d’un nuage, mais représentait tout ce qui n’était pas encore né et qui peut-être naîtrait bientôt dans la fin d’un jour du temps qui tournoyait en avant et en arrière autour de l’esprit de ce petit grand frère, oui, de ce grand petit frère qui vivrait en Capolino tant que lui et moi ne serions pas multipliés par nos innombrables concentrations de regards fatigués de surprendre les passages des savantes âmes boueuses sous la peau de la terre, alors que nous rêvions de contempler la naissance souterraine d’une innocente âme nuageuse.
Et quand Capolino commençait à marcher devant moi en me disant d’oublier lequel de nous deux était le souffleur capable de rappeler à un gonfleur de nuages la forme qu’il serait toujours libre de souffler vers son coeur, je pouvais le voir assis encore devant la fenêtre ouverte d’une chambre de rêve et se souvenant qu’il avait déjà sauté dehors pour s’en aller avec moi sur le chemin de l’absolue non-glorification d’une phénoménale montagne sacrée enfin écrasée et devenue cette traîne incandescente étirée en avant et en arrière vers le passé d’un futur et le futur d’un passé, sur laquelle les monticules d’une nouvelle poussière inconnue recommenceraient encore à finir de resplendir quand chaque nuit une simple pensée secrète de Capolino parviendrait jusqu’à ma conscience en lui rappelant qu’il ne courrait pas jour après jour devant moi pour donner sa vie et la mienne à la mystérieuse âme s’apprêtant à être capable de renaître sous la terre, mais pour m’offrir à moi la plus lumineuse des fleurs en même temps qu’il s’offrirait à lui-même une fleur de lumière.
***
Penché dans l’obscur observatoire qui aujourd’hui semblait vaciller tout au bord de son esprit, Capolino marchait devant moi en projetant l’ombre d’une silhouette courbée sur le ponton d’accès à la balançoire individuelle capable d’amener le voyageur éphémère à l’entrée d’un immense pays encore sans nom, où je pouvais déjà ressentir le jeune crâne de vieillard commençant à craquer et se fendre dans le coffret du vieux crâne d’enfant et où déjà je suivais Capolino sous la voûte d’une salle béante qui s’ouvrait derrière sa tête sans la moindre volonté de faire frémir la vérité d’une image mais en creusant le trou d’un large ciel qui n’arrêtait pas de s’élargir pour essayer de s’enfuir hors de lui-même; et Capolino disait qu’il n’arrivait pas à se souvenir de l’éclair d’expulsion mais qu’il pouvait inexplicablement comprendre pourquoi il avait été expulsé d’une rivière de paroles et tenu en dehors d’une conversation qui ne s’était pas une seconde interrompue pendant des années partout autour de lui, et aussi autour de moi si je me souvenais que j’étais le seul à avoir toujours compris que le pouvoir de parler lui était arraché à lui, et m’était aussi retiré à moi chaque fois qu’une de nos bouches allait prononcer la malencontreuse phrase destinée à prouver que c’était l’essence même d’une joyeuse pluie qui montait en haut à gauche du plafond d’une des plus vastes chambres encore prétendues terrestres de ce monde, pendant qu’en bas à droite tombait la grossière figure d’un triste soleil au-delà de l’horizon faisant corps avec le ciel qui unissait et séparait perpétuellement nos cerveaux entre deux battements de pendule charnelle.
Et Capolino disait que dans certains bons moments de ses plus mauvais jours il était poussé dans le dos par la hargne d’un énorme sanglier mécanique blessé dans un de ses plus subtils rouages et saignant dans une âme de chair dont lui Capolino parvenait à sentir le volume qui bougeait derrière son propre front en changeant de dimension, et qu’à la meilleure heure d’une de ces journées qui aurait pu être la pire journée du morceau de monde où il essayait de pénétrer encore une fois à l’instant même où il réussissait à en sortir, une voix capable de parler comme il se parlait à lui-même l’avertissait de recommencer tout de suite à ne plus jamais croire que le lourd murmure artificiel qui se pressait derrière lui pourrait être le grondement d’une escouade de porte-verbe décidés à interdire l’invention de l’engin capable d’étouffer le sanglot du Grand Tourment lui-même et d’en épanouir infiniment le sourire.
***
Accroupi au pied du vieux saule avec une main posée sur l’embranchement des trois racines distillant un mélange de trois breuvages sous une lèvre d’un bord du ruisseau, Capolino me demandait de l’aider à ne plus essayer de comprendre pourquoi c’était à travers la racine la plus tordue que le saule parvenait à transmettre à des inconnus de notre genre son envie d’être l’arbre nouveau d’une race nouvelle, et engendré seulement pour être l’unique arbre voué à guetter l’intelligent et intelligible reflet qui jaillirait un jour, afin qu’advienne l’heure où un arbre pourrait demander à un reflet s’il désirait continuer à glisser sur l’eau en entraînant un arbre solitaire avec lui vers des hauts-fonds et des bas-fonds entre lesquels la hauteur se confondait avec la profondeur, ou s’il préférait rester immobile en dessous de lui afin de pouvoir sans cesse depuis en bas contempler l’origine de sa propre bassesse; et en posant ma main sur une seule racine en veillant à ne pas toucher sa main dont j’arrivais à mesurer entre les doigts qu’elle serait peut-être un jour la bienfaitrice main étrangleuse plus large que le tronc du saule, je disais à Capolino que j’avais senti passer au-dessus de ma tête mais encore plus proche de sa tête que de la mienne, l’erreur de penser qu’un sentiment profond du saule n’avait été qu’une seule fois perçu à travers la robuste racine devenant malingre une fois invisible sous l’eau, quand moi-même j’avais cru percevoir une complainte du saule se plaignant de ne jamais réussir à convaincre le docile reflet de se figer encore plus qu’un mort mais plus fièrement figé que le plus fier des plus resplendissants reflets morts, et qui chaque jour et chaque nuit de lune l’inviterait à contempler la source éclairée de sa propre hauteur.
Et pendant que je voyais un jeune saule devenir visible en se penchant pour émerger d’une ombre contre le vieux saule, Capolino donnait au vieux saule la flatteuse accolade du vieil amoureux dont une partie alanguie de son esprit s’estimant pourvue d’une légitimité et d’une décrépitude supérieures l’autorisait à pourlécher avec une de ses laborieuses langues le très jeune saule encore confondu avec l’infantilement enfantine image qu’en projetait la convoitise de Capolino, et dont je distinguais l’apparence de jeune arbre contrefait et presque gravement mutilé dans son essence même pour mieux rendre inaccessibles aussi bien qu’enfin accessibles les charmes destinés à réjouir la persévérante curiosité du plus joyeux de tous les plus assidus curieux; et Capolino disait que s’il était à ma place et moi à la sienne il n’aurait aucune honte à m’avouer qu’avant de pouvoir prononcer le premier mot en ayant une conscience absolue de son sens contraire et de ce qu’il ne pourrait jamais justement signifier, il avait compris qu’il n’arriverait peut-être jamais avec son corps et son esprit encore réunis jusqu’au milieu de l’heure où une lumière illuminerait les choses de façon à faire jaillir les milliers de noms secrets permettant d’entrevoir les milliers de significations secrètes de chaque chose, pendant qu’il parviendrait enfin à m’expliquer pourquoi il lui semblait être accroupi depuis des années dans la même posture au pied d’un vieux saule veillant sur la prodigieuse croissance d’un jeune saule à la fois si semblable et si différent de celui au pied duquel je m’accroupirais peut-être moi-même pendant autant d’années qui ne seraient pas de la même longueur que celles passées dans son corps à lui Capolino, quand un jour j’aurais reconnu ce jeune saule comme le seul saule ayant séjourné brièvement dans son coeur en croyant traverser à toute vitesse mon coeur à moi, et comme le seul arbre parmi tous les arbres à m’avoir perçu être frôlé par le bonheur sans en ressentir le plus léger frôlement.
***
Un froissement dans les plus hautes pointes des roseaux indiquait que le vent du nord et le vent du sud venaient d’abandonner leur tentative de souffler l’un contre l’autre à une saison où cette contradiction avait officiellement toujours été interdite mais où elle serait officieusement encouragée voire imposée d’urgence le jour où comme aujourd’hui deux souffles de voix se réuniraient pour entrer dans le tuyau d’un roseau séché étendu sur les pointes docilement accueillantes et oscillantes de quelques authentiques frères de gène toujours suspectés de n’être pas assez promptement serviles à devenir de plus en plus fraternels; et encore mieux que je ne pouvais l’entendre, je voyais commencer de s’écouler le filet d’une voix gracieusement flûtée d’avoir emprunté l’orifice d’une gracieuse flûte, et cette voix se mêlait à une voix durement râpeuse à force d’avoir fait semblant de résister à son envie de franchir le collet d’une industrielle tuyauterie par un cri éraillé plus proche du long couinement que du bref hurlement, quand elle me disait de ne plus accélérer la vitesse de la vie autour de moi en essayant de dépasser ma propre vie qui s’enfuyait devant elle pour ne pas être rattrapée à une autre heure qu’à l’heure juste.
Et en reconnaissant un faux cliquetis dans les jolies saccades reliant tous les timbres de la voix de Capolino je savais que ce n’était pas seulement sa voix qui me disait de m’enfuir d’un lieu aussi absolument réel et aussi irréellement vrai que le coeur gémissant d’un caillou abandonné par la joueuse main de l’unique enfant qui de toute éternité ne l’aurait qu’une seule fois caressé; et la voix disait qu’il n’y avait pas d’autre lieu pour comprendre que je devais précipiter ma fuite de ce lieu, parce que c’était ce lieu lui-même qui constituait l’espace vital et peut-être même le nid caché au creux duquel fourmillait l’insatiable progéniture du parfois enivrant et perpétuellement enivré vice de chercher à se perdre en s’égarant dans la contemplation éperdue d’un visage oublié, dont les expressions se réfléchissaient encore dans le miroir de l’anse d’un ruisseau et se déformaient et se reformaient en un nouveau visage chaque fois que l’esprit de son déjà lointain et peut-être déjà très ancien possesseur était traversé par une nouvelle pensée.
***
Plus chaude que l’anneau détaché d’un rayon solaire la main de Capolino entourait ma main pour m’entraîner à l’écart du ruisseau, quand il disait qu'aujourd'hui était le jour enfin arrivé où certains roseaux ne voulaient pas être ces boyaux constitués eux-même par des milliers d’alvéoles enfermant chacune un petit charme du vide qui sanglotait de n’être point perçu comme une minuscule apparence charmeuse; et ce n’était pas la bouche mais la main de Capolino qui me faisait comprendre combien était encore incalculable le nombre des roseaux refusant de vouloir ressentir ce que ressentaient ces tunnels percés sous la frontière sonore, par où transitaient les serpentants souffles de voix pressées de m’avertir que je ne devais pas me réjouir trop vite en croyant pouvoir partir avec l’aveuglante impatience d’un solitaire déraciné volontaire, vers là-bas où je ne saurais jamais survivre sans accepter de souffrir la constante éventualité d’une absence et sans être forcé de jouir constamment d’une hallucinante et incertaine présence de la fabuleuse machine vivante dont je voyais se reformer et se déformer le visage chaque fois que je me perdais dans la contemplation de l’anse d’un ruisseau à la surface duquel le plongeon d’une autre grenouille dessinait chaque fois un autre clin d’oeil.
Et en moi brûlait encore la vie qui tant de fois au long de tant d’années avait si brutalement empêché ces mêmes années de doucement finir pour être vraiment finies dans la vérité et la douceur de leur propre fin qu’elles en étaient devenues douloureusement infinies; et maintenant je ressentais une des brûlures de cette vie d’avant comme le souvenir d’une future blessure qui serait guérie parce que longtemps avant d’être blessé j’aurais reçu la force de laisser mon visage accueillir les traits d’un visage absolument étranger mais qui serait entré en moi avec l’étrangeté absolue du plus familier de tous les visages, ce visage que je verrais un jour s’élever d’une flaque d’eau après une grande pluie, ou ce visage qui était peut-être celui dont je venais de sentir frémir les paupières dans la voix de Capolino qui me tirait hors de moi-même comme hors d’une cachette en criant de me dépêcher si je ne voulais pas être forcé de subir la condition du servile serviteur de l’image d’un visage.