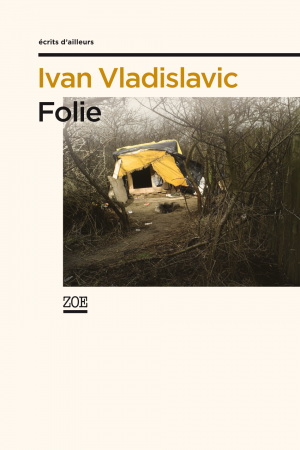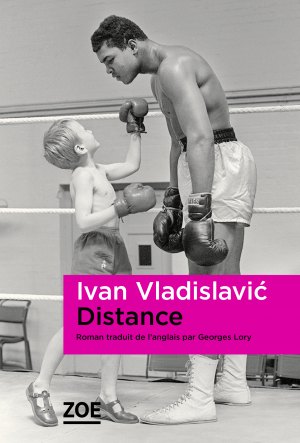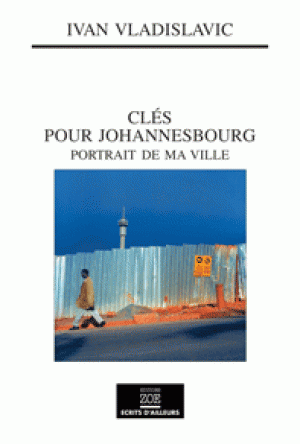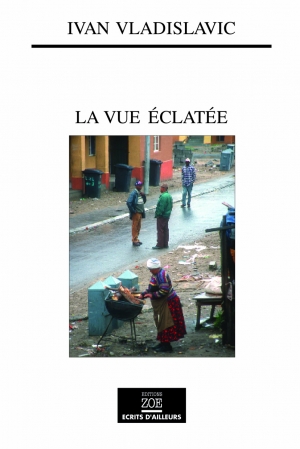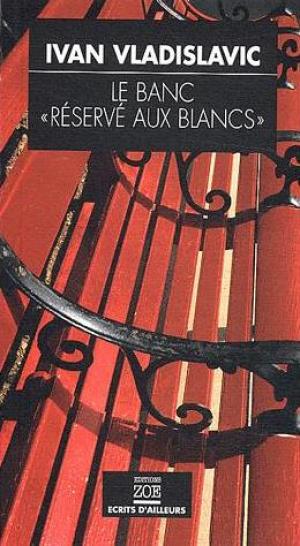parution janvier 2012
ISBN 978-2-88182-847-8
nb de pages 192
format du livre 140 x 210 mm
prix 27.00 CHF
Folie
Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Aurélia Lenoir
résumé
Quelque part dans l’immensité du veld sud-africain, un homme arrive dans un terrain vague et y prend ses quartiers. M. et Mme Malgas, les occupants de la maison voisine, observent avec la plus grande attention cet intrus qui interrompt singulièrement leur routine. Monsieur est quincailler, Madame dépoussière les bibelots, regarde la télévision et attend le retour de son mari.
L’inconnu explique à son voisin, de plus en plus fasciné, son plan : construire la maison idéale. La voisine, quant à elle, est convaincue de la folie de cet homme qu’elle s’obstine à appeler « l’Autre », et qui lui vole son bon mari.
Folie est un huis clos à trois, récit d’une désillusion comique, tissée de clous et de fils, de chimère et de mots.
Ivan Vladislavić vit à Johannesburg, il est l’auteur d’une dizaine de livres dont la plupart sont publiés en français chez Zoé. Son œuvre a été récompensée à plusieurs reprises, notamment par le prestigieux prix américain Windham-Campbell.
La Liberté
"Un roman envoûtant et drôle." (Laurence de Coulon)
La Liberté
"Un roman envoûtant et drôle." (Laurence de Coulon)
Le Temps
"Folie est très drôle et cruel, d'une lecture facile, surprenant de bout en bout, jusqu'à la fin apocalyptique ou pathétique, c'est selon." (Isabelle Rüf)
Le Monde des livres
"On pense à Beckett, par exemple, et Ionesco. Il y a ici une inspiration rare, provocante, originale." (Jean Soublin)
Livres hebdo
"Accueilli dans la collection "Ecrits d'ailleurs" comme le remarqué Clés pour Johannesbourg, paru en 2009, ce roman minutieux, flirtant avec un humour discrètement absurde, édifie un fantaisiste chantier, mirage ou des clous plantés dans le sol dessinent les plans d'une maison imaginaire tandis que les outils, les objets en général, comme animés d'une invisible vie intérieure, assistent ou brouillage progressif de la raison." (Véronique Rossignol)
Distance (2020)
Branko sait comment on embrasse les filles, rêve de gagner le Tour de France et aime fouiller dans les affaires de son petit frère Joe. Qui, lui, joue aux billes, invente des langages farfelus et rassemble dans des albums les coupures de journaux qu’il lit sur son idole, Mohamed Ali. Même si, dans cette famille sud-africaine blanche des années 1970, leur père refuse d’appeler le mythique boxeur autrement que Cassius Clay.
Quarante ans plus tard, Joe décide de s’inspirer de ses albums pour son nouveau roman. À l’aide de Branko, il va réduire la distance qui les sépare de leur passé commun.
La narration, qu’assument tour à tour Joe et Branko, est rythmée par le langage flamboyant des reporters sportifs de l’époque. Elle raconte la relation entre deux frères, faite de tendresse et de cruauté.
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Georges LoryDouble Négatif (2013)
Vous êtes jeune et vos études commencent à vous peser. Vous voulez enfin connaître la vraie vie, mais le moment est mal choisi : nous sommes en Afrique du Sud, au temps de l’apartheid, les tensions raciales sont à leur comble et seul votre statut d’étudiant vous met à l’abri du service militaire. Alors que faire ?
Neville commence par tergiverser, par rechercher de petits boulots en marge de ses études maintenant négligées. Puis il se décide : ce sera l’exil en Angleterre. Avant ce saut dans l’inconnu, Neville vivra toutefois une journée capitale, une journée passée en compagnie d’un photographe prestigieux, auprès duquel il va apprendre à ouvrir les yeux.
En fixant sur la pellicule le moment où tout bascule, l’instant où les événements se précipitent, la fin de l’apartheid aurait-elle une chance de devenir intelligible ? Le sens des scènes éclairées par l’auteur, sur la page qui se substitue à la photographie, nous amène, nous lecteurs, à mieux voir.
Traduit de l'anglais (Sud africain)Nida et Christian SurberClés pour Johannesbourg (2009)
Début du deuxième millénaire, Johannesbourg reste divisée, désormais autant par la pauvreté et la violence que par la race. Vladislavic, fin arpenteur des rues, des quartiers, des parkings, des jardins, circule de scène en scène aussi cocasses que tragiques. Le livre est composé de 138 entrées, comme autant de clés pour comprendre la ville, à la manière Vladisalvic: sorte de regard agile et enregistreur, esprit joueur qui analyse, compare, fait des liens et manie les mots pour dire les impressions les plus fines.
Ce texte est une ode amoureuse à Johannesbourg, industrielle, polluée, dangereuse, belle et injuste.
Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Nida et Christian SurberLa Vue éclatée (2007)
Publié presque au lendemain de la fin de l’apartheid, Les Monuments de la propagande, un recueil de onze nouvelles, prend acte de la fin d’une ère détestable de l’histoire de l’Afrique du Sud et, on peut l’espérer, de la fin de tous les racismes institutionnalisés. L’exubérance, le chatoiement, mais aussi la fragmentation de ce monde renouvelé appellent irrésistiblement la métaphore du kaléidoscope. Ivan Vladislavic en tire un parti inattendu en nous faisant assister à l’invention de l’Omniscope, instrument d’optique indispensable en temps de chambardement. D’une nouvelle à l’autre, les objets prennent alors une valeur emblématique, un tuba, un banc.
Un saisissant raccourci met la Russie post-soviétique en contact avec l’Afrique du Sud post-apartheid dans l’histoire qui donne son titre au recueil. L’abolition des barrières physiques et mentales, que Bessie Head avait prophétiquement annoncée comme inéluctable, se traduit ici par une extraordinaire variété de tons, par la multiplication des points de vue – la voix narrative peut enfin transcender la couleur de la peau –, voire par le caractère parfois ludique d’une littérature qui, sans trahir ni démissionner, peut à nouveau respirer plus librement, la tâche des écrivains témoins de l’insupportable injustice ayant été heureusement accomplie.
Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Christian SurberLe Banc "réservé aux Blancs" (2004)
L’apartheid vient d’être aboli et Mme Coretta King, la veuve de Martin Luther King, s’apprête à inaugurer le musée consacré à cette période sinistre. Les préparatifs vont bon train, mais les employés, bien que très fiers de leur copie parfaite d’un banc WHITES ONLY, l’un des symboles les plus forts de l’époque révolue, sont en conflit avec leur directrice qui ne veut pas de faux dans ses collections. Or les appels au public pour obtenir des pièces authentiques sont restés vains et ont même engendré des situations ahurissantes.
Sous le comique et le rocambolesque s’ouvre un monde de souffrances et d’humiliations restées vives : la blessure n’est pas cicatrisée. L’auteur manie ici l’ironie et la satire avec maestria.
Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Ch. SurberFolie: extrait
Nieuwenhuizen, debout sur le bas-côté, dans l’obscurité, examinait la rue. D’une main, il tenait une grosse valise marron imitation cuir et, de l’autre, les quelques piécettes froides que venait de lui rendre le chauffeur. Au bout de la rue, les feux arrière du taxi s’embrasèrent, puis s’évanouirent.
Nieuwenhuizen se tourna vers la parcelle. Le terrain, d’un demi-hectare à peine, était plus petit qu’on ne le lui avait laissé entendre, envahi par les hautes herbes et le chiendent. Une haie indisciplinée qui se découpait sur le ciel nocturne le bordait sur deux côtés, tandis qu’un mur en ciment, dont les panneaux préfabriqués avaient la forme de roues de chariot, fermait le troisième. Le quatrième côté, où il se trouvait, était autrefois séparé de la rue par une clôture. Les vestiges de cette frontière − portail, rouleaux difformes de barbelés, poteaux de bois au pied-bot de béton − jonchaient le sol. Il serra sa monnaie dans une main, la poignée d’éponge de sa valise dans l’autre, enjamba un enchevêtrement de barbelés et s’enfonça dans la végétation.
Les tiges cassantes qu’il couchait et écrasait sous ses chaussures laissaient échapper une poudre âcre. Respirant la poussière, il saliva, avala et, les yeux rivés sur l’horizon, poursuivit son avancée. Au bout d’un moment, il trébucha sur une fourmilière. Il trouva dommage de ne pas profiter de cette découverte, aussi monta-t-il sur le tertre et, l’air solennel, contempla tour à tour les quatre coins de son domaine. Le visage de l’homme était large, sa bouche ne laissait apparaître qu’une fente, il avait le nez camus, les orbites insondables, les sourcils saillants, le front bombé et bosselé en son centre ; le tout se prêtait aux jeux d’ombre et de lumière du clair de lune. L’étude du terrain révéla la présence d’un arbre isolé dans l’angle de la haie, et il choisit d’y établir son campement.
Nieuwenhuizen suspendit son écharpe à un épineux. Puis, juché sur sa valise, sous l’arbre, il regarda les fenêtres injectées de sang de la maison, derrière le mur orné de roues de chariot, pour voir ce qui allait se passer.
Dans le salon de cette maison, M. et Mme Malgas, les propriétaires, regardaient le journal de vingt heures à la télévision.
« C’est reparti », dit M. Malgas au moment où débutait le reportage sur les émeutes, et il coupa le son avec la télécommande.
Au même moment apparut sur l’écran une cahute en flammes, assemblage de poteaux fendus en deux, de cartons et de chutes d’aggloméré, rafistolé avec du papier journal et des sacs plastique. Elle était cernée par quantité d’autres cahutes strictement identiques, à cette différence près que, pour une raison inconnue, aucune ne brûlait.
« Ça, c’est rien, dit Mme Malgas d’un air lugubre. Attends de voir la suite. Le pire est encore à venir. »
Sur quoi elle bondit de son fauteuil Gomma Gomma, attrapa l’assiette posée sur le plateau-télé de son mari, fit glisser dans la sienne deux vertèbres qui atterrirent dans une flaque de gras, racla les deux couteaux qu’elle posa ensuite ostensiblement, fit grincer les dents des fourchettes qui retenaient grains de riz et reliefs de mouton, jeta les serviettes froissées par-dessus ces décombres, glissa l’assiette vide sous la pleine, posa l’ensemble sur la table basse et revint s’asseoir (le tout d’un seul mouvement théâtral).
« Où est-ce qu’ils sont tous passés ? » s’étonna M. Malgas.
La cabane brûlait encore. Des rideaux déchirés de flammes jaillissaient des fenêtres, et des colonnes de fumée s’élevaient par les trous laissés dans les murs, à l’endroit où les rapiéçages s’étaient consumés. La fumée montait droit au ciel. L’image se brouilla avant de retrouver sa netteté. Puis le toit de tôle ondulée, lesté de pierres, entraîna l’ensemble dans sa chute en une explosion silencieuse d’étincelles et de braises. Au beau milieu des planches calcinées, la caméra montra un châlit de fer, les ressorts ardents d’un matelas et une malle de fer-blanc cadenassée. Puis elle cadra une paire de bottes fumantes.
Mme Malgas regardait les bottes.
M. Malgas, propriétaire d’une quincaillerie, absorbé dans la contemplation d’un morceau de tôle ondulée, s’exclama :
« Ça, c’est du fer !
— Chuut ! »
Tandis qu’il essayait de ramasser du petit bois dans l’obscurité, Nieuwenhuizen trébucha à nouveau sur la fourmilière et s’étala de tout son long. Au moment où il se releva, il posa la main par hasard sur un objet dissimulé dans l’herbe. Fébrile, il l’en dégagea. C’était un vieux baril d’essence, d’une contenance d’environ vingt-cinq litres, au couvercle grossièrement découpé et au fond quelque peu déformé. Il le secoua pour en extraire un peu d’herbe et de sable, le coinça sous son bras et, du poing, tapa sur le fond pour lui redonner sa forme initiale. Il le tourna vers le clair de lune. Malgré tous ses défauts, l’objet semblait riche de promesses. Nieuwenhuizen, ravi, en eut aussitôt un infime avant-goût : en rebroussant chemin vers le campement, il y transporta sa récolte dérisoire de brindilles.
Comme il serait agréable de s’asseoir sur une pierre, songea-t-il, mais il n’en trouva aucune de taille ou de forme satisfaisante ; faute de mieux, il s’assit sur le baril posé droit. Il rassembla un tas de feuilles mortes. Puis il réunit les brindilles en un fagot qu’il brisa ensuite en deux.
L’espace d’un instant, il se vit en train de briser les os de ses doigts transformés en petit bois, et il en eut la nausée. Il agita les mains pour s’assurer de leur bon fonctionnement. Rassuré, il ramassa métacarpes et phalanges épars pour en faire un nid, et y jeta une allumette.