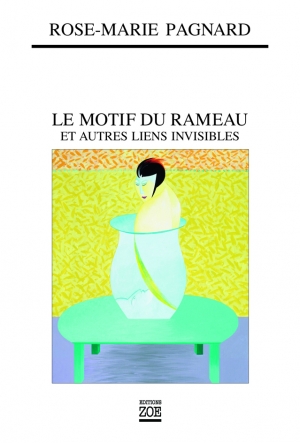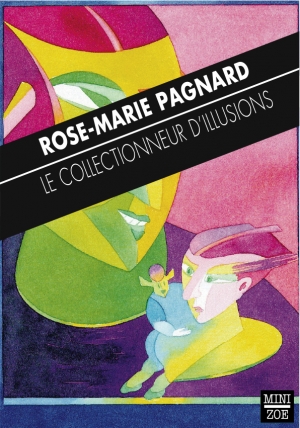parution février 2010
ISBN 978-2-88182-663-4
nb de pages 224
format du livre 210 x 140 mm
prix 29.00 CHF
Le Motif du rameau, et autres liens invisibles
résumé
Maman Reinhold, ex-cascadeuse convertie en protectrice de l’innocent et dangereux Leonard ; Ben Ambauen, écrivain et chasseur de lièvres ; la fille d’un marchand de vaisselle transformée en héroïne de conte ; Ennry Pinkas, juriste dont la petite taille cache une imprévisible folie ; un extravagant éditeur qui se croit « sans imagination » ; la ville de Bergue et Tokyo la mégalopole : le lien entre ces personnages et ces lieux s’appelle Ania.
Ania, fille adoptée, élève forcée du Foyer des enfants spéciaux, est devenue l’épouse d’Ennry. Elle incarne ici l’amour absolu, mais aussi l’incroyable aptitude qu’ont certains êtres à supporter les vicissitudes de leur destin.
Ce roman à l’écriture musicale et ardente est un éloge à la force de l’imagination. « J’essaie de me relever, mais je suis fatiguée d’entendre la réalité et le rêve penchés sur moi à plaider chacun pour son compte, en japonais ! » Mais voici que le hasard saute dans l’histoire…
Rose-Marie Pagnard a notamment publié La Période Fernandez (1988, Actes Sud, prix Dentan), Dans la forêt la mort s’amuse (1999, Actes Sud, prix Schiller), Janice Winter (2003, éditions du Rocher, Points Seuil), J’aime ce qui vacille, 2013, Zoé, Prix suisse de littérature).
Gloria Vynil (2021)
Porter en soi une amnésie comme une petite bombe meurtrière, avoir cinq frères dont un disparu, vivre chez une tante folle de romans : telle est la situation de Gloria, jeune photographe, quand elle tombe amoureuse d’Arthur, peintre hyperréaliste, et d’un Museum d’histoire naturelle abandonné. Dans une course contre le temps, Gloria et Arthur cherchent alors, chacun au moyen de son art, à capter ce qui peut l’être encore de ce monument avant sa démolition. Un défi à l’oubli, que partagent des personnages lumineux, tel le vieux taxidermiste qui confond les cheveux de Gloria et les queues de ses petits singes. Avec le sens du merveilleux et le vertige du premier amour, Gloria traverse comme en marchant sur l’eau cet été particulier.
Rose-Marie Pagnard jongle avec une profonde intelligence entre tragique et drôlerie pour nous parler de notre besoin d’amour.
Dans une petite ville des années 60, Brun, génial garçon de treize ans et sa petite soeur Dobbie ne supportent plus la réputation de voleur qui menace la vie de leur père. Une terrible injustice, d’autant plus que le voleur, le magistral escroc n’est autre que leur oncle Räuben Jakob, directeur d’une fabrique de feux d’artifice et astucieux bienfaiteur... Passant de leur misérable logis à la villa de leur oncle, Brun et Dobbie pourchassent une vérité qui ne cesse de s’esquiver; d’ailleurs, n’y a-t-il pas de multiples vérités?
Inventifs et solaires, ils charment tout une bande de partisans de la justice. Dobbie s’amourache de chacun, Brun tient des propos désabusés d’adulte plein d’expérience, tandis que le comte Mato Graf, le professeur de violon, le marchand de cristal, les frères Jakob et d’autres se laissent aller à des comportements puérils qui provoquent, chez le lecteur, un indéniable sentiment de danger.
Le Conservatoire d'amour (2014, Zoé poche)
Deux sœurs adolescentes, bien que soumises à leur père, lui faussent compagnie et fuguent vers leur amour de la musique. Elles prennent alors leur flûte et disparaissent. Le chemin du Conservatoire est pavé d’épreuves singulières, mais rien n’arrête Gretel et Gretchen qui veulent être admises au paradis de la Musique.
Un roman, un conte, une histoire de passion pour la musique, une enquête-opéra qui revisite la Flûte enchantée. Rose-Marie Pagnard est l’auteur d’une œuvre aux pouvoirs subtils, dix romans et recueils de nouvelles dont Janice Winter et J’aime ce qui vacille.
J'aime ce qui vacille (2013)
Comment les parents de la jeune Sofia retrouveront-ils la force de vivre après sa mort ? Illmar, le père, lance alors le projet d’un bal qui réunira tous les habitants de la tour où il vient d’emménager avec sa femme – comme si les vies apparemment ordinaires de leurs voisins allaient les aider à comprendre le drame de Sofia et peut-être les sauver des eaux noires du chagrin. Mais tel un reflet du monde, la tour se révèle être un empilement de vies vacillantes, de destins tous farouchement tendus vers la douceur et la joie intérieure.
J'aime ce qui vacille a reçu le Prix suisse de littérature 2014
Laudatio de Marion Graf
J’aime ce qui vacille, le onzième roman de Rose-Marie Pagnard, mêle les genres et les tonalités avec une évidence toute musicale. C’est un roman et c’est un conte, ou même une comédie ; une fiction primesautière et ironique, et un poignant livre de deuil personnel; une plongée dans les eaux noires du chagrin et de la culpabilité, et une explosion de couleurs, de matières et de mots chatoyants.
Deux ans après la mort de leur fille, toxicomane, ses parents, Sigui et Ilmar, semblent s’éloigner l’un de l’autre, chacun se retranche dans son deuil, face au vide : elle dans ses errances, en quête d’une vérité impossible, lui dans ses rêves et son travail de costumier de théâtre. Alors s’engage ce roman grave et dansant, sur le tranchant de la solitude et de l’amour, de la douleur et de la fête, entre la vie et la mort, la lucidité et la folie qui guette. Peu à peu, dans les sept étages de la tour vacillante où vivent Sigui et Ilmar, les portes s’ouvrent sur d’autres personnages assez excentriques, naissent des solidarités, autour d’un projet saugrenu et peut-être salvateur.
La perspective est surtout celle de Sigui, le livre est rythmé par ses retours en arrière, somnambuliques ou réalistes, et par les sollicitations et les interactions du présent, par tout ce qui la dérange comme une violence faite à son deuil, et l’arrache à son jardin noir. Exclamations et questions sans réponse, bribes de dialogues, rencontres et tohu-bohu métamorphosent peu à peu son monde intérieur.
A l’heure où domine l’autofiction, Rose-Marie Pagnard recourt avec bonheur aux détours de l’art et de l’imaginaire pour affronter la réalité.
Marion Graf
Ce qu'en dit l'auteur (texte paru dans la revue des belles-lettres, 2012, I):
"Entre elle et lui un contrat moral est signé. Il oublie sa signature. Elle oublie cette histoire. Elle et lui ne se reconnaissent pas dans l'ascenseur. Dans un fatras d'intentions le contrat se perd. Un contrat aux conditions particulièrement rudes pour elle comme pour lui qui préfèrent l'oublier, se sentir libres, libres, libres, et en bonne santé. C'est dans l'air du temps. Cependant. Cependant ici et là des contrats tout aussi rudes sont à la lettre respectés, dans toutes sortes de domaines, entre deux personnes, voire entre une personne et elle-même, mettons, entre un écrivain et lui-même.
Plus je veillis, plus je suis consciente de cette étrange anticipation. Longtemps avant de tracer le premier mot d'un roman, ce symbolique contrat occupe mon esprit (c'est à la fois grave et excitant). D'une part je sais que je m'y mettrai, à ce roman, oui, la chose est entendue au plus profond; d'autre part je ne sais plus rien, je me sens dans mes petits souliers, un peu, comme avant un mariage secret, radical (divorce interdit), aventureux, plein de responsabilités envers moi seule quoi qu'il arrive (ce dernier point surtout me trouble).
Sur cette confidence absolument inutile au lecteur, je me permets une remarque utile à la vérité. J'ai quelquefois l'impression que l'art est considéré comme le sujet unique de mes romans. Or, c'est un sujet parmi les autres, un sujet que j'aime, mais qui ne saurait réduire, dans ces romans, la vie des personnages, la vie prosaïque, ou poétique, l'intrigue, le romanesque..." Rose-Marie Pagnard
Le Collectionneur d'illusions (2006, Minizoé)
Les trois récits de ce livre se répondent par le thème de l’art et grâce à leur personnage principal, Cornelius. Dans «Le collectionneur d’illusions», il raconte comment son père, après sa ruine, suit à la trace, en parfait illusionniste, sa collection d’œuvres d’art perdue dans des hôtels et des restaurants de luxe. «Figures surexposées» est une véritable allégorie surréaliste de l’inspiration et de la création artistiques. «Le violon de ma mère» fait la part belle au pouvoir imprévisible de l’imagination grâce à la mère de Cornelius, une vieille aveugle qui invente un monde invisible.
Postface de Doris Jakubec
Le Motif du rameau, et autres liens invisibles: extrait
En pleine nuit de novembre, dans le château de Bergue, un homme fut déposé comme un bloc de glace sur le lit d’une chambre. Par qui, par quoi, mystère.Dans cette chambre la température baissa, puis remonta si fort que ce qui avait paru inanimé finit par prendre vie.
–Comment t’appelles-tu ? demanda la nuit d’une voix douce, féminine.
–Ben Ambauen, quarante ans, héritier, à votre service.
–Et pourquoi t’efforces-tu d’atteindre le jour ?
–Pour attraper la femme que j’aime.
–Attraper ! Elle court comme dix lièvres, cette femme, s’esclaffa la nuit en jetant un coup d’œil scrutateur aux longues jambes musclées et au visage du rêveur, un visage à l’expression fluctuante, comme affamé par une vision tantôt proche, tantôt disparaissant dans l’inconnu. Je ne voudrais pas avoir l’air de fourrer mes petites pattes dans tes affaires, ajouta-t-elle, mais tu ferais mieux d’entrer au conseil communal, de distribuer ton argent et ton temps aux cas sociaux, à l’exemple de tes parents et ancêtres ou, mieux encore, d’aller tous les après-midis enseigner les deux p, philosophie et poésie, aux habitants de l’hospice.
Ben Ambauen murmura qu’il exerçait en temps utile ce genre d’activités, mais que présentement, à dire juste, immédiatement et de toute urgence, il devait écrire ce qu’il savait et ne savait pas de cette femme ; pourquoi, comment, mystère.
–Dans ce cas, soupira la nuit.
(Elle déplorait un tel projet qui ne manquerait pas d’empiéter sur son délicat territoire des songes et d’y laisser traîner des papiers couverts d’inepties, ça lui donnait des tempêtes d’angoisse et des exaltations érotiques tuantes. Des réactions trop humaines qu’elle préféra refiler à Ben Ambauen, à son corps nu, à son âme nue, tout disposés à ce genre d’expériences…)
–Salut ! dit-elle, avant de se fondre rapidement dans le brouillard glacé.
L’aube encore noire tomba sur Ben Ambauen avec ce que la nuit avait prévu. Il crut écrire d’un jet l’histoire de son Ania bien-aimée et inatteignable (excellent ! génial !), quand un corbeau d’un coup de plume l’effaça: impossible de savoir maintenant ce que cette histoire avait raconté, le dormeur cherchait, cherchait, il s’accrocha aux mots enfants, cirque, petit pont, le lit se pliait sous les efforts. Un enfant minuscule, d’une forme inachevée, se plaqua sur le visage de Ben Ambauen et le remplit d’une grande angoisse : es-tu mon enfant, aurait-il voulu demander, mais le souffle lui manquait. Subitement le cours du rêve ralentit, tout est si calme, mais notre petite ville est très calme, rêvait-il, et ce calme bougea un peu, se transforma en volupté et en désir sans objet précis, désir d’être caressé par n’importe quelles mains, tout cela ensemble excitant en diable. Quoi ? Ce diable de Leonard ! rêva-t-il encore, emporté tout brûlant dans une voiture sans roues, à travers des rues sans nom.
N’oublie pas, cher Ben, avant de te lancer corps et âme dans une reconstitution romanesque et donc non véridique du séjour professionnel de nos amis Ania et Ennry à Tokyo, n’oublie pas, en quelque sortepour garder au moins un pied sur terre, certains de leurs antécédents berguiens incontestables et vérifiables. Par exemple ceux que je vais immédiatement noter ici afin de t’éviter des trous de mémoire, mais aussi une possible sous-estimation du poids, dans l’imagination, de faits réels quelquefois si énormes qu’on finit par les regarder superficiellement. Un peu comme on regarde, dans notre ville, Sunne le manchot, ou Hewa la mystique, ou Ennry l’homme qui n’a pas assez grandi en centimètres.
La petite ville de Bergue dormait encore. Le peu de neige tombée la semaine précédente avait été déporté à la lisière de la forêt, mais le verglas persistant rendait les rues impraticables pendant la première moitié de la journée. La lettre de l’éditeur avait mystérieusement échappé à ces réalités, elle était ouverte sur la table, Ben la lisait pour la deuxième fois, debout sur la frontière entre la nuit et le jour.
Ennry Pinkas. À Tokyo, sa petite taille aux proportions étonnamment parfaites, conviens-en, n’est certainement pas passée inaperçue. On attendait une montagne d’un mètre quatre-vingt-dix, on reçoit un homme finement taillé, grand juriste, un être qu’on pourrait dissimuler dans la plupart des vases ornementaux du Musée national japonais (si j’interprète correctement les reproductions que j’en ai). Cette petite taille – ce léger handicap – joue-t-elle un rôle dans le comportement qu’on pourrait qualifier d’épisodiquement effrayant d’Ennry? Et si oui, le joue-t-elle également à Tokyo? Je te laisse répondre. Pour ma part je crois que non, je retire d’ailleurs le mot handicap, je le pose sur mon propre front, en signe de manque, manque d’invention, de patience dans la fréquentation de personnages littéraires, bref, de ces dons que toi, mon cher Ben, tu possèdes et tiens tout le temps chauffés à blanc, cachés à l’intérieur de ton éternel manteau noir, je ne connais rien aux dons, je te prie de m’excuser.
Voilà pour la petite taille d’Ennry. Ennry Pinkas expédié par ses chefs à treize heures d’avion de Bergue pour l’ouverture d’un cabinet de droit international à Tokyo.
Avec sa femme Ania, que j’aurais juré avoir vue enceinte, un matin, un peu avant leur départ, puis revue le même jour aussi mince que son petit doigt. Un mirage. Je ne m’habituerai jamais à votre exécrable lumière berguienne!
Je te parlais de précédents, mais j’ai tout à coup perdu le fil. Je ferme un instant les yeux pour retrouver Bergue et le jeune Ennry, permets que je suive la rivière (elle aussi beaucoup trop brillante pour mes yeux fatigués), c’est à un tournant de cette rivière que se trouvait la scierie dans laquelle travaillait autrefois le père d’Ennry. Ce père, cher Ben, fut un jour accusé d’avoir volé son patron, ce pourquoi il passa de secrétaire prometteur à coupeur de bois. Plus tard, trop tard, sa femme prouva l’innocence de cet homme, elle était journaliste, elle aurait dû être écrivain et consigner toute l’histoire dans un livre, tu comprends ce que je veux dire: les livres servent la vérité, chacun à sa manière, bien entendu (la manière de tes deux romans exceptée, mais oublie cette parenthèse, je n’ai jamais pu lire un de tes livres en entier, mes yeux sont probablement trop faibles). Le destin du père d’Ennry est un précédent incontestable, tu peux l’utiliser autant de fois que tu le voudras, ces drames de l’injustice sont pour ainsi dire inusables, leur réalité se moque des distances géographiques, de sorte que si tu ressentais le besoin de glisser cette histoire berguienne dans une histoire tokyonaise, le déplacement serait imperceptible au lecteur. Cela dit, je doute qu’une injustice vieille de trente ans tourmente un homme tel qu’Ennry – souviens-toi de l’insouciance assez comique avec laquelle il fait pivoter son violoncelle d’amateur entre ses petites jambes avant de jouer! –, je doute que cet homme aujourd’hui penché sur des cas de justice dont la complexité nous couperait le souffle ait gardé ne serait-ce qu’une écharde de cette histoire en lui.
Quoique.
Ce précédent t’est donc signalé. Y en aurait-il d’autres?
Ben Ambauen posa la lettre de l’éditeur sur sa grande table noire, dans l’angle occupé par une boîte de pastilles Grether, par des chaussons en feutre à bordure de plumes d’eider et par la lourde théière en fer qui avait été le témoin de seize années consacrées à la pensée et à l’écrit. (La bordure de plumes, Ania l’avait créée le jour de son quatorzième anniversaire dans le parc couvert de cendre et d’oiseaux morts du Foyer des enfants spéciaux.) Ces années de travail avaient produit, d’une part, des chroniques littéraires, d’autre part, des romans signés Ben Ambauen.
Les chroniques paraissaient dans le Journal de Bergue, elles étaient inspirées par des romans, tous d’inimitables fictions dont les auteurs, morts, ou vivant à des distances considérables, ne risquaient pas de se pointer en ce lieu pour quelque réclamation, lecture ou conférence publique décevante. Un chroniqueur responsable, selon Ben, se devait d’éprouver, avant de se mettre à écrire, un immense besoin de solitude et d’exploration. Après avoir refermé le livre objet de sa future chronique, il quitte la ville, non sans solennité et courage il quitte une réalité connue puis il s’égare. Doit impérativement s’égarer. Atteindre avec le corps et avec l’esprit de nouveaux points de vue. Par exemple : les ruines du Moulin royal approchées par le sud ne ressemblent pas à ces mêmes ruines attaquées par le nord. De même que prononcer l’âge de ces ruines n’a que peu de rapport avec penser, en les regardant, au processus de la destruction de toutes choses au sens philosophique. Sortir et s’égarer constituaient donc la phase préparatoire des chroniques. Les rédiger ne demandait ensuite pas plus d’effort que s’il s’agissait de dialoguer amicalement avec les personnages du livre élu. Un dialogue qui aurait pu, en certains cas particulièrement riches pour l’imagination de Ben, faire perdre les pédales aux auteurs eux-mêmes, mais aucun auteur ne s’était jamais manifesté.
Les romans de Ben Ambauen, à ce jour deux et l’embryon d’un troisième, racontaient des vies humaines ordinaires, mais rendues étranges et invérifiables par l’irruption de hasards catastrophiques ou féeriques, également par le fait que des certitudes concernant par exemple la folie, le don de l’imagination, ou le sens de l’existence, pouvaient être réduites à néant par le sourire d’un mort! C’était simple mais inexplicable, de sorte qu’un éditeur pouvait ironiser tout son soûl à propos de la fiction en général et de celle d’Ambauen en particulier, il fallait le comprendre et lui pardonner. Ben but une gorgée de thé, de telles pensées lui desséchaient la gorge. Il se tourna vers Italo Calvino, vers Hella Haasse, vers Vladimir Nabokov, il aurait pu se tourner vers bien d’autres écrivains, tous ceux qui avaient été mille fois pris à la gorge par le thème de la fiction, mis en demeure d’expliquer son mystère et qui, grâce à une étincelle surgie du feu même de ce mystère, avaient fini par concocter chacun une réponse merveilleusement accueillante, juste assez large et juste assez intime pour contenir en son brouillard scintillant un cadeau à tous les lecteurs. Puis il revint à l’éditeur : n’avait-il pas confié à ce dernier, dans une imprudente bouffée d’enthousiasme, ses trois histoires tokyonaises ? Alors qu’il en était encore à avancer sans le moindre mot écrit, dans la chambre mi-claire, mi-obscure de l’imagination? Alors que les images d’Ania à Tokyo, de tout ce qu’il savait, se présentaient si nombreuses à son esprit qu’il se sentait repu, devait à tout moment s’allonger sur son lit? Oui, son corps avait énormément grossi à l’intérieur. Pesait. Devait-il voir un lien entre cette sensation de trop-plein et la grossesse supposée d’Ania? Il espérait n’avoir pas soufflé mot de ce dernier point à l’éditeur, un tel point appartenait à Ania, et Ania appartenait en partie à Ennry et en partie à lui, Ben.
Maintenant, il aurait aimé réfléchir au personnage d’Ania, précisément à son éventuelle grossesse. Il s’apprêtait à s’étendre sur son lit quand un long pic de glace se détacha du toit avec un craquement bref et sonore et fut réduit en morceaux sur le rebord de la fenêtre. Tout comme si l’éditeur venait de faire claquer ses grandes dents étincelantes pour lui rappeler une lettre abandonnée sur un coin de table, une lettre perfidement aimable ou aimablement perfide, c’est ce que Ben allait immédiatement vérifier. Il reprit sa lecture:
Y en aurait-il d’autres? La femme d’Ennry, Ania que tu as connue adolescente et prétendument enfant attardée avant que tu l’arraches du Foyer des enfants spéciaux pour la propulser dans les rôles d’étudiante puis de femme mariée, Ania spécialiste des petites boîtes décorées, des cadeaux et des sévères froncements de sourcils au moindre souffle de méchanceté ou seulement d’amical mensonge, oui, notre Ania. Cette femme est positivement nourrie d’antécédents tragiques. Positivement, parce que le fait d’être orpheline et celui d’avoir été placée au Foyer des enfants spéciaux de Bergue durant neuf ans, ces faits gigantesques pour une enfant, elle les a enjambés avec la grâce que tu lui connais, toi qui le premier lui as parlé de poésie. L’ex-cascadeur que je me refuse à nommer dans ce paragraphe féminin ne doit pas être considéré comme son père adoptif (qu’il a été et reste officiellement toujours), mais comme un triste fou adopté par une petite fille ! Dans le fond, je serais heureux que tu t’inspires uniquement de la merveilleuse Ania d’aujourd’hui, ne la trouves-tu pas merveilleuse?
Avant de poster mes modestes conseils, je te confie encore cette image vue quelques semaines avant le départ de nos amis pour Tokyo : Ania couchée à plat ventre dans l’herbe de son jardin, ses cheveux sombres étendus jusqu’au bord du pré voisin où broutent les moutons mérinos du fils Duc. Des cheveux incroyablement longs… je ne sais pas pourquoi ça me revient.
Mon cher Ben, une camionnette pleine de livres neufs attend dans la cour. Comme à chaque arrivage, je suis impatient de les manipuler, mais aussi tristement rétif, triste. Un éditeur a beau se tordre le cou pour essayer d’attraper ce qui se fait de mieux en matière de roman, il sent littéralement avec quelle indifférence des histoires particulièrement destinées à illuminer et à colorer la vie intime des lecteurs lui échappent, soit qu’elles sont inachevées et donc impubliables, soit qu’elles sont achevées mais inexplicablement rebelles à une reproduction massive.
Mes rapports avec toi sont uniques.
«Jette tout ce qui te passe par la tête à propos d’Ania et d’Ennry, n’oublie pas l’emploi du conditionnel, je me charge de donner une réalité indiscutable à chacune de mes phrases. Entre nous, je n’ai besoin d’aucune aide, mais ta bonne volonté et ton esprit terre à terre me tiendront compagnie dans le rêve que j’écris. Il est probable que ce rêve reste accroché pour un temps à Tokyo, une ville que ni toi ni moi ne connaissons. Mais cela aussi je peux l’imaginer.»
Voilà ce que tu m’as confié mot pour mot! Mon cher Ben, je n’aperçois aucun lien entre tes propos et ton manuscrit que j’attends depuis trois ans. Ce fameux manque d’imagination, sans doute!
Il commence à neiger, chutes importantes annoncées pour les prochains jours. Je vais de ce pas rejoindre le chauffeur de la camionnette en prenant soin de bien viser le centre de ma porte (mon corps devient toujours plus large, je publie trop).
Bien que ces derniers mots figurent entre parenthèses, j’espère que tu les retiendras: trop.
En grande perplexité,
ton éditeur
ton éditeur