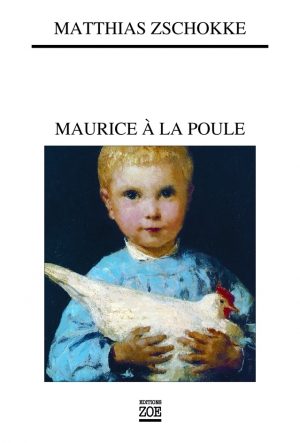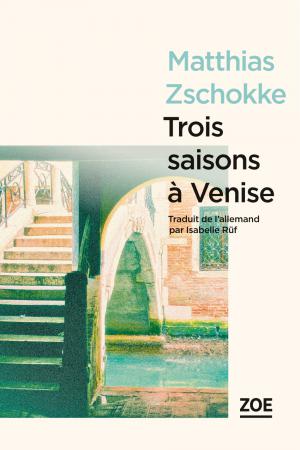parution janvier 2009
ISBN 978-2-88182-640-5
nb de pages 272
format du livre 140 x 210 mm
prix 32.00 CHF
Maurice à la poule
Traduit de l'allemand par Patricia Zurcher
résumé
Maurice passe ses jours dans son bureau du quartier nord de Berlin, là où débarquent les habitants de l’Est, une zone déclarée «sensible». Il écrit à son ami et associé Hamid à Genève, le plus souvent il ne fait rien. De l’autre côté de la cloison, quelqu’un joue du violoncelle, cela l’apaise, mais il ne réussit pas à dénicher le musicien tant le dédale des immeubles est inextricable. Il fréquente souvent le Café Solitaire, la Papeterie de Carole, passe devant le Bar à Films de Jacqueline, des lieux dont les propriétaires changent souvent pour cause de faillite.
Dans ce roman fait de détails, d’esquisses et de lettres, Zschokke met en scène des existences sans gloire, des êtres blessés par la vie, pour qui il nourrit une tendresse sans limites.
Matthias Zschokke, né à Berne en 1954, a d’abord choisi une carrière de comédien. Mais les quelques années qu’il passera au Schauspielhaus de Bochum, dirigé à l'époque par Peter Zadek, le convaincront à tout jamais qu'il n'est pas fait pour cet art-là. En 1980, il part s'installer à Berlin et se lance à corps perdu dans trois autres activités artistiques, écrivain, dramaturge et cinéaste.
Ces trois professions, il les mène de front, "comme on assaille une forteresse, en attaquant de tous les côtés". Jour après jour, il se rend dans une usine désaffectée où il dispose d'un étage entier pour réfléchir au monde qui l'entoure. C’est là qu’il écrit six œuvres en prose, sept pièces de théâtre et trois films. Des œuvres que la critique, immédiatement séduite par son style reconnaissable entre mille, commente et encense abondamment, à commencer par Max, son premier roman, qui lui vaudra le Prix Robert Walser en 1981. Cinq ans plus tard, son talent du cinéaste lui vaut le Prix de la Critique allemande pour son film Edvige Scimitt. Puis en 1989, tandis que la prestigieuse revue théâtrale allemande Theater heute l’élit meilleur jeune auteur de l’année après la création de sa pièce Brut à Bonn, son second film, Der wilde Mann, se voit primé à Berne.
Prix Gerhard Hauptmann en 1992 pour sa pièce Die Alphabeten, et plus récemment, Grand Prix bernois de littérature pour l'ensemble de son œuvre, Matthias Zschokke est l'unique écrivain de langue allemande à avoir reçu le prix Femina étranger, pour Maurice à la poule, en 2009. Il n'a pourtant jamais été un auteur "en vogue". Son nid, c'est en marge des phénomènes de mode en tous genres qu'il a choisi de le faire et c'est de là qu'il observe le monde.
Neue Zürcher Zeitung
« Zschokke nous tient en haleine avec presque rien… Il raconte avec tant d’obstination et de dissimulation que l’on pense tantôt à Beckett, tantôt à Robert Walser. » (Beatrice von Matt)
Retrouvez l'article complet (en allemand) sur le site du NZZ
Français (poche)
Titre: Maurice à la pouleÉditeur: Points Seuil
Année: 1970
Max (2023, Zoé poche)
Petit bourgeois à l'allure léchée, Max déplore d'être comme tout le monde. Il fréquente de jolies femmes, croise à l'occasion le regard affable d'un homme, sans jamais donner suite. Il entame une carrière de comédien pour se sentir libre, mais sa place est ailleurs; Max est spectateur de la société.
Ce premier roman, paru en allemand en 1982, ressemble à un autoportrait. Matthias Zschokke, «le maître de l'espièglerie mélancolique» (Neue Zürcher Zeitung) raconte l'ordinaire avec fulgurance et une inventivité narrative inédite.
Postface de Heinz F.Schafroth
Traduit de l'allemand par Gilbert MusyLe Gros Poète (2021)
Berlin, début des années 1990. Le héros de Matthias Zschokke, un gros poète débonnaire, croit devoir écrire le grand roman de la capitale allemande réunifiée. Mais ce n'est pas son registre. Il préfère quand rien ne se passe, les histoires ordinaires qui révèlent nos failles et celles de la société. Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, pour obéir à un petit elfe insatiable qui le supplie de lui raconter "quelque chose de beau", il convoque des souvenirs d'enfance, décrit son travail vain et quotidien, s'inquiète du temps qui file. Puis, il en meurt, sans faire de bruit. Dans ce roman paru il y a 25 ans perce déjà la profonde mélancolie de Matthias Zschokke. À sa manière incomparable, élégante et allusive, il interroge le roman engagé, la réussite sociale, le couple, la sexualité enfantine, tous thèmes dont l'actualité n'est pas à démontrer.
Traduit par Isabelle RüfMatthias Zschokke ne donne jamais à ses héros des facultés hors normes qui attireraient un regard admiratif ou envieux. Au contraire : il les place au niveau du lecteur et se met lui-même à côté d’eux, il les observe dans leur vie quotidienne, avec le plus grand étonnement.
Dans Quand les nuages poursuivent les corneilles, le héros se repose quand il est rassasié et se relève quand il a faim. Il aime que la femme avec qui il vit soit là à ses côtés. Pourtant, les grandes questions du destin ne lui sont pas épargnées : sa vieille mère et son ami de toujours lui demandent de mettre fin à leurs jours. Pour les aider, il envisage un hold-up improbable puis tente de monter une pièce de théâtre, mais c’est sans compter l’essentiel : boire des cafés, regarder vivre les gens et les canards, manger du fromage. Et surtout, contempler des lambeaux de nuage qui poursuivent des corneilles.
Traduit de l'allemand par Isabelle RüfTrois saisons à Venise (2016)
En 2012, Matthias Zschokke passe trois saisons à Venise, invité par une discrète fondation suisse qui met à sa disposition un appartement au cœur de la ville. De sa résidence, il écrit quotidiennement à son frère, à sa tante de Palerme, à son éditeur, à sa traductrice, à une chanteuse d’opéra, à une directrice de musée, à son fidèle ami de Cologne, parmi d'autres de ses connaissances et relations professionnelles. Ces lettres par mail s’enchaînent comme un roman dense, drôle, désopilant même, qui donne à voir Venise à travers un kaléidoscope malicieux et philosophique.
Zschokke note, raconte, commente avec passion tout ce qu’il voit, entend ou sent. Les touristes ne le dérangent pas, ils sont amusants à observer, avec les murs et les canaux qu’ils longent, les piazzette où ils se serrent, les palazzi, les musées, le Lido, les ponts. Lui, le résident, zigzague à travers eux, relève leurs particularités avec une hilarité joyeuse. La beauté de Venise l’empêche de travailler, la déambulation continuelle devient une drogue d’où surgissent les scènes les plus mélancoliques et les plus humoristiques.
L'Homme qui avait deux yeux (2015)
L’Homme aux deux yeux est à la fois le roman d’aventures d’un héros moderne et la mise en scène d’un monde aussi noir que vide de sens. Dans cette histoire, Matthias Zschokke est acerbe contre la société d’aujourd’hui et sa diatribe est ici brillante.
L’homme qui avait deux yeux se distingue à peine des autres, visage, cheveux, vêtements et mallette couleur sable. Il perd sa femme, son chat, son travail de chroniqueur judiciaire, son appartement dans la capitale. A cinquante-six ans, il s’en va à Harenberg, une petite ville de province dont la femme avec qui il vivait lui a recommandé les bienfaits.
Tout au long de sa lente marche vers la grisaille, le dénuement et la mort possible ou souhaitée, ses souvenirs lui apparaissent, aussi attendrissants que fâcheux, ses révoltes éclatent dans des formulations caustiques, mais son corps a encore besoin de chaleur. A Harenberg Rosaura, qui tient un bar et accepte de longs diaogues, lui offre de curieux plaisirs.
Ce roman raconte en filigrane une histoire d’amour avec «la femme qui préférait se taire», celle qui chantait dans la même chorale au temps de leur jeunesse.
Matthias Zschokke est passé maître dans l’art de raconter de petits riens en les tirant à hue et à dia jusqu’à ce qu’ils apparaissent dans une lumière étrange où ils perdent leur évidence et nous étonnent.
Nous sommes là devant un diamant noir.
Traduit de l'allemand par Patricia ZurcherCourriers de Berlin (2014)
Courriers de Berlin est à la fois une curiosité et une première car il est fait de mille cinq cents mails envoyés par l’auteur à son meilleur ami, d’octobre 2002 à juillet 2009.
Matthias Zschokke est mélancolique, les hauts et les bas de son humeur s’enchaînent à une vitesse vertigineuse. Ses messages laissent deviner un interlocuteur bourru, emporté, plus acerbe encore que lui-même; tous deux aiment la littérature, le théâtre, l’opéra, le cinéma et la télévision, ainsi que les voyages, les restaurants et les parfums. Les livres qu’ils lisent, les spectacles qu’ils voient suscitent des avis féroces, Courriers de Berlin est un essai monumental sur la culture d’aujourd’hui et ses fabricants.
C’est aussi un livre sur l’amitié.
La critique allemande a été unanime à reconnaître dans ce texte une œuvre pleine d’humour au style aérien.
Traduit de l’allemand par Isabelle Rüf
Amman, New York, Berlin et autres... Extraits audios de Circulations lus par Gilles Tschudi (2012, audio)
Ces extraits mènent l’auditeur de Berlin à New York en passant par les Alpes, Budapest et Amman. Journal de voyage ou guide touristique, en tout cas un grand portrait de nos espaces de vie, à la façon des grands auteurs du XIXe siècle qui décrivaient aussi bien paysages, auberges, que les hommes et les femmes y vivant. Sur la route, le lecteur partage avec le promeneur solitaire moderne qu’est Matthias Zschokke des moments de grande jubilation et des instants d’extrême mélancolie.
Gilles Tschudi, comédien à la haute précision, aime le regard candide et philosophe que Matthias Zschokke porte sur le monde. Il nous fait voyager avec l’auteur dans un juste mélange de douceur et d’ironie.
Traduit de l'allemand par Patricia ZurcherCirculations (2011)
Amman, Budapest, Baden-Baden, Saint-Luc, New York, et en entrée, Berlin. De la ville omniprésente dans son œuvre, Matthias Zschokke nous entraîne dans le vaste monde. Avec son sens si aiguisé de l’observation et son regard plein d’humour et d’empathie, il nous guide de mégapoles en coins perdus, saute de l’une à l’autre au fil des mots.
Plus que le voyage, c’est le génie des lieux qui l’intéresse, comme des personnages qui se révèlent peu à peu. Et même si le lecteur peut puiser dans cet ouvrage quelques bonnes adresses, il s’agit avant tout ici de littérature. La subjectivité et la poésie qui habitent cette mosaïque de petits récits ne laissent aucun doute sur la nature de cette invitation au voyage.
Traduit de l'allemand par Patricia Zurcher
Si les personnages du théâtre de Matthias Zschokke sont des adeptes de l’autodérision, si leur esprit est férocement perspicace et lucide, ils restent capables de grandes amours et sont au fond des romantiques. C’est tout l’art de Matthias Zschokke. Il ressort de ses pièces un esprit sombre peut-être, mais aussi tendre, espiègle et brillant. La Commissaire chantante sait raconter des histoires comme personne et sa maladresse est bien plus charmante que désespérante ; L’Ami riche incarne moins un espoir dérisoire que l’espérance réelle d’un changement fondamental ; et les protagonistes de L’Invitation pratiquent l’art de ne pas tricher dans un contexte de convenances sociales qu’ils sont tous incapables d’adopter.
Les trois pièces réunies dans ce livre sont d’une profonde humanité, notre désir d’être aimé y est omniprésent. L’élégance mélancolique de la langue de Zschokke permet à ce théâtre de se lire comme de la littérature de fiction.
Traduit de l'allemand par Patricia Zurcher et Gilbert MusyMax (1988)
Ouvrage disponible en poche : http://editionszoe.ch/livre/max-2
Traduit de l'allemand par G. MusyMaurice à la poule: extrait
«De nouveau rien eu à faire. Voilà des semaines que ça dure à présent. Apparemment, les gens ne peuvent plus s'offrir mes services. Ou alors, ils ne croient plus que ça vaut la peine de s'adresser à moi et de demander mon aide. Jour après jour, je suis assis dans mon bureau, sur ma chaise, devant ma table de travail, et la seule chose qui m'occupe, c'est de ne pas laisser monter la panique et de m'habituer peu à peu à cette façon vaine et molle de ramper d'un jour à l'autre.
Tu te souviens de Popol ? Le comédien dont j'avais fait la connaissance chez vous à l'époque, dans le Grunewald, lors du meeting aérien? Il se fait appeler Flavian Karr à présent. Un nom d'artiste. Il m'a invité à dîner ce soir.
Tandis que j'étais devant la glace de ma salle de bain, juste à l'instant, et que je me rasais, je me suis surpris à souhaiter de tout mon cœur pouvoir rester à la maison. Comme l'air est frais et comme il sent bon quand même dans une salle de bain d'Europe centrale comme celle-ci ! me disais-je. Comme un appartement tel que celui-ci vous attend tranquillement derrière la porte, les bras ouverts ! Comme c'est agréable de ne devoir parler à personne (mon amie est en voyage) ! Ah, toi, ma chère chemise, me disais-je, pourquoi diable dois-je te changer aujourd'hui ? Tu pourrais très bien être portée encore un jour de plus, si seulement je ne devais plus rencontrer personne; et je n'aurais pas eu non plus à me laver, ni à me raser, si j'avais pu rester chez moi aujourd'hui. Pourquoi donc veut-il me voir ? Qu'attend-il de moi ? Nous sommes amis, et alors ? Qu'avons-nous à nous dire ? Nos journées passent, certes, oui, les semaines passent, les années passent, mais elles se ressemblent toutes et ne rapportent rien qui vaille la peine d'être raconté. Mon oncle préféré est mort, tu sais : le vieillard dans la mansarde, celui aux baskets en toile dans lesquelles il a découpé des trous pour ses orteils. Ferait-il un bon sujet pour une conversation du soir digne de ce nom ? Flavian ne le connaissait que par ouï-dire. Sa mort ne l'intéresserait qu'à peine le temps de dire trois phrases.
Il a certainement une raison de m'inviter, un quelconque succès qu'il s'agit de fêter, ne serait-ce que celui d'avoir désormais une année de plus, même ça, il en ferait un événement, et il va falloir que je feigne de l'intérêt.
Comme ce serait reposant de me laisser tomber à présent dans mon fauteuil de lecture et de pouvoir regarder dans le vide tandis qu'en bas passent les trains de banlieue. Ou de retourner à mon bureau et de pouvoir me rasseoir à ma table. Comme c'est réconfortant chaque fois quand j'y vois le soleil disparaître derrière un nuage et que les couleurs s'estompent, quand le papier blanc devient gris, quand ma machine à écrire couleur de boue devient noire, ma trousse verte, bleu pétrole, quand la porte à l'étage supérieur fait des embardées, quand les cloches du soir se mettent à sonner, comme à la campagne, quand le vent sillonne la ville, quand il se met à pleuvoir, quand les voitures qui se trouvent en bas dans la cour fondent jusqu'à n'être plus que des gros blocs incolores, quand le portail en fer de l'entrée se referme bruyamment, quand on peut voir comme la rouille ronge les aiguilles de l'horloge accrochée à la façade dehors, devant ma fenêtre, à droite, quand deviennent gris les prés verts, grises les maisons blanches, gris les toits rouges, quand les prières, les soupirs et les malédictions s'élèvent délicatement au-dessus de tout cela comme la fumée en hiver, toute cette matière première à partir de laquelle est pressé le besoin de changement.
Comme j'aime marcher sur les petits chemins de terre, me dis-je au même moment, entre les champs labourés, tandis que le ciel commence à rougir, comme j'aime contempler le jaune des champs de colza qui s'affaisse au crépuscule, les cailloux gris encore réchauffés du soleil de la journée, comme j'aime le corps nu de mon amie qui a l'impassibilité des flancs des très hautes montagnes – ça, ce n'est pas vrai, j'ai dû le lire quelque part, c'est tout simplement un corps, son corps, mais quand elle n'est pas là, la mélancolie me gagne.
Devant ma fenêtre de bureau, en bas dans la cour, les trois femmes turques dont je t'ai parlé dans ma lettre de la semaine dernière sont toujours assises derrière leur stand provisoire. Pour se protéger de la pluie, elles ont tendu une bâche. Elles ont l'air d'avoir gonflé leurs plumes. Sous leurs jupes qui vont jusqu'au sol, elles portent une quantité de couches. Leurs têtes sont enveloppées dans des foulards, leurs yeux cachés derrière des lunettes. Elles sont assises en rang d'oignons, tranquillement, vêtues de couleurs délavées. De loin, on dirait trois sacs remplis à ras bord ; celui de gauche a la couleur d'un sable moutarde, celui du milieu, la couleur de la farine devenue grise ou du lait dans un pot, à la cuisine, après le coucher du soleil, et celui de droite la couleur d'un cadavre gelé. Elles sont assises là en silence et regardent devant elles les spécialités maison dans les plats et les pâtisseries maison sur les plaques. Quand quelqu'un vient vers elles et leur achète quelque chose, un sourire leur monte au visage, un souffle, leurs yeux s'éclaircissent, c'est comme un rougissement qui fait éclore délicatement ces visages pâles et bouffis, le soleil sort de derrière le nuage, les couleurs s'illuminent, les flaques scintillent.
Devrais-je reparler peut-être une fois à Flavian du violoncelle dont on joue depuis quelque temps de l'autre côté du mur de mon bureau ? Rien que d'y penser, les mots retombent dans ma bouche comme du blanc d'œuf battu en neige et gratiné qui se retrouve trop vite à l'air frais. Il y a longtemps qu'il le connaît par cœur, le violoncelle.
Peut-être devrais-je aborder le sujet du Nord de la ville, là où se trouve mon bureau, de la "ceinture de gras" de Berlin en général, des banlieues ? Mais ça non plus, il ne veut pas en entendre parler. Il regarderait à travers moi, si je me mettais à parler de ça. Après tout, il connaît tout cela ; nous l'avons tout de même fondé et ouvert ensemble, ce bureau, à l'époque. Certes, il n'a pas tardé à se retirer et s'est empressé d'oublier comment ça se passe ici, dans les hauts. Tout le monde s'efforce de l'oublier. Personne n'aime qu'on lui rappelle comme les fleurs sont fanées ici, dans les boutiques, et comme les médecins et les pharmaciens sont pâles ; ou encore, qu'il n'y a nulle part ici où acheter de la marchandise convenable, pas de fruits dignes de ce nom, rien ; que tout le monde ici laisse tomber tôt ou tard. Même le salon de thé au coin de ma rue a déjà changé plusieurs fois de gérant depuis que je purge ma peine ici. Bien qu'il bénéficie sans aucun doute d'une situation privilégiée – à proximité immédiate de la chapelle du crématoire, donc avec, comme clientèle fixe, tous les gens qui viennent aux enterrements –, il semble que même avec ça, on ne peut réaliser aucun profit.
Les chaussures dans les devantures ici font une impression douteuse du point de vue police sanitaire, les boutiques de papiers peints décorent leurs vitrines de façon totalement absurde, les animaux dans les magasins zoologiques font pitié à voir, les cabinets de dentiste, après quelques mois seulement, éveillent la méfiance, et les studios de physiothérapie font carrément peur. Dans tous les commerces, un mois après qu'ils aient été ouverts, les odeurs sont disparates. Si les habitants étaient des chiens, ils lèveraient la patte aux caisses et s'oublieraient. Les drogueries rappellent les kiosques de prisons où les détenus peuvent s'acheter le strict nécessaire, et les supermarchés, les hangars de distribution de denrées alimentaires dans les camps de réfugiés. Les caissières souffrent d'éruptions cutanées pour lesquelles il existe des remèdes, certes, mais elles ne se les font pas prescrire, parce que leurs médecins ne se voient attribuer par la caisse maladie qu'un contingent limité du médicament en question et qu'ils le gardent pour les meilleures patientes qu'ils espèrent avoir un jour et qui ne se présentent jamais chez eux. Voilà comment sont les gens que l'on rencontre ici en haut, généralement malades, souffrant de troubles du métabolisme, mal nourris. Et il n'y a pas de fuite possible.
Est-ce un sujet approprié pour une conversation du soir ? Un divertissement avec lequel je pourrais me présenter devant Flavian ? Je crains que non. Quelque part dans la Bible, il est écrit "honte à toi de te dérober à ton ami", je sais, je sais. Peut-être devrais-je lui lire le brouillon de lettre annexé de mon défunt oncle préféré que j'ai trouvé en débarrassant la mansarde ? C'est tout de même intéressant, non, que les sauterelles nous poussaient à écrire il y a quatre-vingts ans tout comme elles le faisaient il y a deux mille ans et comme elles le font aujourd'hui encore ? Peut-être y aurait-il quelque chose d'intéressant à faire avec ça ?
Cher Hamid, si ma lettre sent l'after-shave, tu comprendras donc pourquoi : je suis assis à ma table, fraîchement lavé et rasé, et je regarde sur ma montre l'aiguille des minutes, tandis qu'elle approche du six. Le moment venu, je mettrai en soupirant des salutations au bas de la lettre, je fermerai l'enveloppe, je l'affranchirai et je me mettrai en route.
Juste un mot encore au sujet de nos affaires : en ce qui concerne notre commerce de spiritueux, je n'ai aucun mouvement à signaler. Les stocks de champagne n'ont pas été touchés ces dernières semaines. En langage boursier : "Nous stagnons" toujours. Cordialement. Maurice»