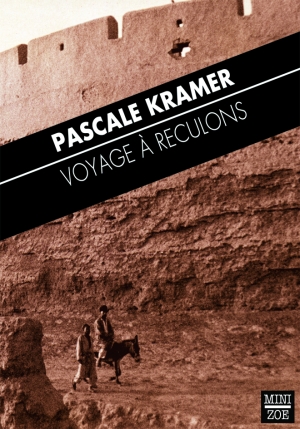parution mars 2011
ISBN 978-2-88182-695-5
nb de pages 48
format du livre 105 x 150 mm
prix 5.00 CHF
Voyage à reculons
résumé
« Ses traits qu’un œdème a noyés paraissent enfin lavés de la souffrance. Mais la violence, apaisée chez lui, commence à infuser en nous. »
Bejin, Urumqi, Kashgar. A la faveur d’un voyage sur les traces d’Ella Maillart, la narratrice ne peut échapper au ressassement. De son monde à elle, et de la mort de Gaston, dix ans plus tôt à l’Asie brutalement modernisée, elle passe sans reprendre souffle. La violence sourde qui couve dans les rues de Kashgar lui fait revivre sans compassion celle qui existait dans son couple.
Pascale Kramer est née en 1961 à Genève, elle vit à Paris. Elle est notamment l’auteur de L'Implacable brutalité du réveil (Prix Schiller, Prix Rambert et Prix du roman de la Société des Gens de Lettres). Son dernier livre, Un homme ébranlé, est paru au Mercure de France en janvier 2011.
Postface de Florence Heiniger
Pascale Kramer est née en 1961 à Genève, elle vit à Paris. Elle est notamment l’auteur de L'Implacable brutalité du réveil (Prix Schiller, Prix Rambert et Prix du roman de la Société des Gens de Lettres). Son dernier livre, Un homme ébranlé, est paru au Mercure de France en janvier 2011.
Neue Zürcher Zeitung
« La perception des mondes intérieur comme extérieur, les reflets de l’un dans l’autre, les subtils jeux d’emboîtement du connu et de l’inconnu s’intensifient avec une élégance audacieuse, jamais vaniteuse ».
Retrouvez l'article complet (en allemand) sur le site du NZZ
Helvétique équilibre. Dialogues avec le Point de vue suisse du prix Nobel de littérature 1919 (2019, autres traductions)
En 1919, Carl Spitteler (1845-1924) devient le premier Suisse à recevoir le prix Nobel de littérature. Notre point de vue suisse, son discours prononcé au début de la Première Guerre mondiale en faveur de la paix et de la neutralité, avait marqué l’esprit de Romain Rolland ou Blaise Cendrars. Le voici dans une nouvelle traduction. Cent ans plus tard, huit écrivains, alémaniques, romands et tessinois, entrent en dialogue avec l’écrivain. Quel rapport la Suisse et ses habitants entretiennent-ils avec leurs voisins européens ? Avec la question des migrants ? Les frontières sont-elles toujours aussi définies qu’il y a un siècle ? Quelles valeurs rattache-t-on aujourd’hui à cette fameuse neutralité helvétique ? Neuf textes et autant de points de vue sur des questions brûlantes.
Né à Liestal, Carl Spitteler est un observateur critique des dogmes dominants au début du XXe siècle. Huit écrivains, de langues et de générations diverses, proposent en écho leur « point de vue suisse » : Adolf Muschg, Pascale Kramer, Fabio Pusterla, Daniel de Roulet, Dorothee Elmiger, Catherine Lovey, Tommaso Soldini et Monique Schwitter
Édité par Camille Luscher
Traduit de l’allemand et de l’italien par Étienne Barilier, Anita Rochedy, Marina Skalova, Mathilde Vischer, Lionel Felchlin, Camille Luscher,L'Implacable Brutalité du réveil (2017, Zoé poche)
Dans la nouvelle résidence où elle vient de s’installer avec Richard et leur petite Una, Alissa se sent chaque jour plus angoissée : le nourrisson ne suscite pas en elle l’amour tant attendu, seulement une accablante responsabilité. Les climatiseurs brassent la chaleur de l’été californien, mais ne dissipent pas le sentiment d’abandon croissant d’Alissa.
Voyage à reculons: extrait
Nous sommes une dizaine, photographes et écrivains, venus au Xinjiang mettre nos pas dans ceux d’Ella Maillart, en vain. Plus de 70 ans nous séparent de son voyage. De ce qu’elle et son compagnon virent et vécurent, dans l’inconfort de plusieurs semaines d’expédition hasardeuse à travers le piémont et le sable d’un monde à découvrir, il ne nous reste que la démesure des paysages traversés, le soleil asséchant dont nous ne ressentirons jamais la soif, les regards profonds qui se retournent sur notre passage, et bien sûr ses photos à elle, que nous transportons de Bejin à Kashgar, puisque c’est ce que nous sommes venus faire.
De Bejin, nous avons pris l’avion pour Urumqi. Un minibus nous attend à l’aéroport. Sitôt franchi les hauts buildings qui signalent la ville au milieu du désert, nous entrons enfin dans un ailleurs dont je n’ai aucune idée. Les enseignes en caractères chinois, arabes et cyrilliques se devinent à travers les feuillages des acacias enchevêtrés d’inextricables nœuds de câbles. Le bus avance à peine au milieu du trafic mélangé de piétons. Toutes les rues sont faites des mêmes immeubles en carrelage blanc suintant de noir auxquels se greffent des vérandas entassées de fourbis. La ville n’a pas dix ans, elle est déjà bonne à détruire. De sa décrépitude si follement, si intensément habitée, naît une impression d’incroyable effronterie. Ce n’est pas ce que nous sommes venus voir, j’ose à peine dire que ça me plaît.
Nous avons rendez-vous l’après-midi à l’Institut d’archéologie. C’est Corinne qui mène la visite. Nous sommes dans son monde et nous y sommes en paix. L’électricité a sauté, c’est à la lueur blafarde de grosses torches électriques que nous scrutons des objets millénaires à travers la poussière des vitrines, jusqu’à cette momie de jeune femme, allongée à nos pieds.
Elle a été déshabillée par endroits de son cocon de tissus qu’on sent fragiles comme de la cendre. La sécheresse du désert l’a conservée presque intacte. La peau à peine craquelée est tendue sur l’ossature fine du visage. Au fond des orbites, demeure l’empreinte d’un regard auquel ne manque pas un cil. C’est obsédant, ces yeux vides où s’est inscrite la mémoire d’une vie d’il y a 3000 ans. J’ai soudain l’étrange appréhension de ce que cela signifie de laisser partir un corps en fumée. C’était sa volonté à lui, Gaston. Je me le répète comme on bredouille, tellement surprise d’être à nouveau ébranlée dans mes convictions, et avec la même paniquante défiance qu’au jour de sa crémation, il y a plus de dix ans, à Lens, où ses sœurs se détournent de moi, muettes de rancœur et d’effroi, elles qui croient savoir qu’on va bientôt voir le corps se tordre et les os craquer. Nous avions été copines, nous avions ri, je les emmenais faire les magasins à Boulogne-sur-Mer. Il aura fallu moins de trois jours pour en arriver à cette violence qui me chauffe encore les joues après dix ans dans la pénombre de l’Institut d’Urumqi, trois jours passés à veiller le corps de Gaston étendu en kimono blanc sur une sorte de civière réfrigérée. Au début pourtant, la présence de sa dépouille parmi nous, dans la maison, m’a semblé rassurante, comme cette momie d’Urumqi qui nous impose silence. J’ai même pensé que la veillée funèbre donne une sorte de décence au deuil. Obèse de cortisone et le crâne brûlé par les rayons, Gaston mort a la prestance d’un Bouddha. Ses traits que l’œdème a noyés paraissent enfin lavés de la souffrance. Mais la violence, apaisée chez lui, commence à infuser en nous.
Nous avons atteint le dernier étage de l’Institut où s’entasse en vrac le butin des dernières fouilles. Il y a une pleine table de menues offrandes retrouvées dans les tombes et, pudiquement recouvertes de grandes feuilles de papier blanc, des têtes momifiées à la tignasse mitée et encroûtée comme un pelage malade. On dirait des naufragés incrédules d’être arrivés jusqu’à nous, autant que nous le sommes de nous trouver face à eux. Et ce qui me frappe soudain, c’est notre peu de foi. Dans le cercueil de Gaston ne se trouvaient qu’un dessin de sa petite Fanny, remis à une des sœurs par sa mère, et un bouquet des derniers dahlias de l’automne que Serge et moi avions cueillis dans le jardin. Le corps a été apprêté à l’hôpital. Ça ne risque plus rien, m’assure avec déférence l’employé des pompes funèbres. Je commence péniblement à comprendre à quoi sert la large bande de scotch transparent qui scelle les lèvres. Une vis en plastique, apprendrai-je bien plus tard grâce à l’humour macabre d’une série télévisée américaine, nous épargne la déliquescence des entrailles. Ce viol des embaumeurs, au moins y aurai-je consenti par ignorance, et par obéissance à la tradition des veillées, qui est tout ce qui nous reste de piété, à nous qui ne croyons pas.
Lorsque nous sortons de l’Institut, le décor a été comme passé au calque jaune d’un vent de sable dont l’éblouissement nous agresse, après cette déambulation recueillie à la torche électrique. On sent le picotement des bourrasques griffues contre la carrosserie du bus. Nous oscillons tous entre fatigue et morosité. Il faudrait pouvoir se reposer des autres et de soi-même, mais nous sommes attendus pour le dîner. Corinne a remarqué que j’avais les yeux mouillés et tout son visage me sourit amicalement. Je sens que l’apitoiement me gagne, que notre prise en charge complète, pendant toute la durée du voyage, ne me permettra pas d’échapper au ressassement qui commence.
Jour suivant.
Notre train pour Kashgar part en fin de matinée. Nous avons un peu de temps libre dont nous profitons, chacun de son côté, pour flâner dans le petit marché ouïghour qui fait face à notre hôtel d’un kitch tout neuf de faux or oriental. C’est une ruelle étroite bordée d’immeubles insalubres promis à une très prochaine destruction. Les étals masquent un peu la noirceur des murs et y font résonner la vie. Dans une charrette à bras bâchée de plastique, des carpes expirent dans une eau qui chauffe au soleil et peu à peu les cuit. Le marché est hanté par une odeur de charbon qui couvre celle des fraises et de ces pains chauds, denses et durs comme des œufs cuits. Sur du papier de journal étalé à même le sol, un homme vend un serpent emprisonné dans une sorte de filet à pois chiche et un autre desséché, enroulé sur lui-même, devant une rangée de bouteilles de venin rouge.
En repartant en direction de l’hôtel, je suis poussée sur le côté par une Buick noire rutilante qui a surgi au milieu de toutes ces odeurs, ces gamins aux joues mâchurées, ces échoppes noires de fumée. Le visage du jeune conducteur chinois est impassible, comme sont impassibles ceux des piétons et cyclistes ouïghours qu’il oblige à s’écarter devant lui. Cette pesante indifférence met mal à l’aise. Peu après notre retour en France, en entendant parler des attentats qui frappent Kashgar, je me dis qu’il ne faudrait pas grand-chose pour qu’éclate la charge de violence qui couvait ce jour-là. À nous, il avait suffi que Gaston meure, lui qui faisait le lien entre nos milieux si dissemblables, pour que nos différences nous aveuglent et nous agressent au point qu’il n’y ait plus aucune possibilité d’entente. Ce n’est rien d’autre que beaucoup d’incompréhension et de peur qui se résout par la haine. À l’époque, je m’en suis découverte capable tout autant que les autres, avec la même vulgarité de sentiment, et cela m’a hantée des années. Il me semble avoir alors compris de façon très intime avec quelle dangereuse facilité s’enclenchent les guerres entre des peuples qui se sont mélangés longtemps, et même avec quelle affolante jubilation.
Train à destination de Kashgar.
Le groupe est enfin au complet. Li Xueliang et Shen Wei nous ont rejoints à la gare. Ils ne parlent ni français ni anglais. Nous échangeons nos cartes et quelques mots par l'intermédiaire de Shu Chai et Zhao Si, Shen Wei montre son carnet de voyage au Xinjiang récemment publié. Puis la fatigue et l’hypnose du voyage nous renvoient à nos rêveries.
Cela fait une demi-journée que le train parcourt à petite allure un infini de piémont. Nous avons perdu de vue depuis longtemps la route encombrée de camions qui filaient comme une longue chenille sur l’horizon. Les quelques traces de vie ou d’habitation se sont raréfiées peu à peu jusqu’à cette désolation montagneuse où plus rien ne pousse. Comment habiter une telle immensité ? Quelle foi en un ailleurs au-delà a-t-il fallu pour franchir cette chaîne montagneuse la première fois ? D’où est née l’ambition de placer des voies bout à bout sur des milliers de kilomètres d’une aridité si parfaitement hostile, de planter des poteaux que relieront des fils électriques à travers toute l’étendue de ce désert ? J’ai l’impression d’être issue d’un monde où une telle volonté n’est même pas concevable. Et cette impression se confirme au spectacle, qui nous saute aux yeux à la sortie d’un tunnel, d’un très fin et beau jeune homme au garde-à-vous. Il est posté sur une avancée en demi-cercle taillée dans la montagne. Il porte un uniforme sombre, sa casquette s’enfonce très bas sur ses yeux. Le frôlement du train doit le gifler, mais il reste irréprochablement immobile. Aussi longtemps que je peux le voir, il se tient figé, parfaitement seul dans ce chaos de roches à perte de vue, sorti d’on ne sait où pour être ponctuel à notre arrivée, dévoué à sa mission de faire belle impression à ce train rempli de gens paressant sur leurs couchettes ou bavardant en buvant du thé.
Difficile de savoir quoi, du sens du devoir, de l’ambition ou de la crainte, motive son zèle, mais on n’imagine ni doute ni révolte. Peut-être se sent-il sous le regard d’un Dieu, ou de quelque chose de plus grand que lui auquel il croit. Gaston ne croyait qu’en la vie et sa mort n’en a été que plus désolée. Je le revois, obèse et souffrant, un des tout derniers beaux jours de l’automne. J’ai poussé son fauteuil jusqu’à la plage. Sa mort est imminente et nous y aspirons autant l’un que l’autre. Entre deux somnolences, sans raison, il me parle du restaurant qu’il s’était juré d’ouvrir. C’est vers ce rêve que tendaient ses efforts et il ne le réalisera pas. Gaston n’a jamais cessé de travailler depuis qu’il a quatorze ans. Des enfants de son premier mariage, il n’a plus de nouvelles, mes efforts pour les réconcilier ont été aussi vaniteux que vains. Quant à sa petite Fanny, elle aussi, il sait qu’il va la perdre, rattrapée qu’elle est par la rancune de sa mère. Il est mort quelques jours plus tard avec la conviction extrêmement lucide de ne rien laisser qui valait la peine d’être vécu. Quel sera le bilan que le jeune homme au garde-à-vous fera de sa vie au dernier jour ? Est-ce que cette question a même un sens pour lui ?
Nous en verrons d’autres, de ces sentinelles postées le long des voies. Pendant des heures, je tente de les capter avec mon appareil tout en dégustant le sel des larmes que je verse avec complaisance sur je ne sais quoi au juste. Mais je manque de réflexe et ne photographie que la roche frôlée par la ferraille du train. Je finis par me lasser de faire le guet et rejoins le compartiment où bavardent Sabine, Corinne, Christine et Charlotte, pendant que les autres somnolent ou lisent. Christine avait fait provision de fruits et de pain qui s’abîment dans un seau bleu. Il règne une odeur de vieux pique-nique qui rappelle les fonds de sacs collants de miettes et de sirop renversé, les soirs de course d’école. Corinne m’accueille de son beau regard vert affectueux. Elle constate, avec un soupçon de reproche me semble-t-il, que j’ai les yeux un peu rouges. En fait elle a deviné que Sabine est sur le point, pour la seule et unique fois de ce voyage, de se laisser submerger par un chagrin qu’elle conjure avec une fantastique drôlerie. Sabine, c’est toute une vie de bonheur à deux dont elle porte le deuil tout récent. Moi j’ai enterré un père et un mari et pourtant, je ne pense pas savoir ce que c’est que pleurer quelqu’un.