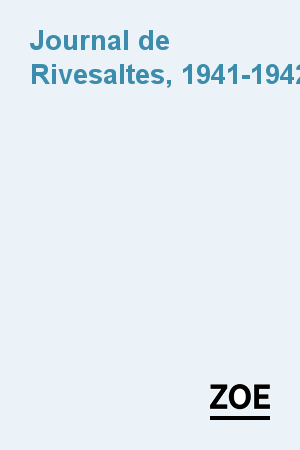parution juin 2010
ISBN 978-2-88907-006-0
nb de pages 192
format du livre 105 x 165 mm
Journal de Rivesaltes, 1941-1942
résumé
Entre 1941 et 1942, Friedel Bohny-Reiter (1912-2001) a travaillé au camp de Rivesaltes pour le Secours suisse aux enfants. Elle se donne corps et âme pour aider les jeunes internés, convainc l'administration de laisser sortir plusieurs prisonniers, lutte pour améliorer les invraisemblables conditions de vie du camp – quitte à enfreindre les règles. Le journal quotidien qu'elle y tient est une source historique rare et précieuse.
Friedel Bohny-Reiter, née à Vienne en 1912, est morte à Bâle en 2001, peu après la parution de son Journal. Elle n’a que de 2 ans lorsque la Première Guerre mondiale éclate, et son père qu’elle connaissait à peine est tué au front. A la fin de la guerre, alors que misère et famine accablent Vienne, la Croix-Rouge organise des « trains d’enfants » pour la Suisse. Elle y sera alors accueillie, et après ses études décide de devenir infirmière. Elle s’engage au « Secours suisse aux enfants » qui l’envoie au camp de Rivesaltes.
Revue Choisir
"Ce livre est poignant de malheur et d’humanité mêlés où la moindre petite fleur ou germination printanière ouvre un espace de vie et d’espérance. Avec tact, compassion, amour."
Une chronique de Marie-Thérèse Bouchardy à lire ici
Marie Claire édition suisse
"Réédité dans un petit format intimiste qui lui va bien, ce bref et intense récit colle hélas toujours à l'actualité... La jeune Suissesse, infirmière de la Croix-Rouge dans un camp d'internement pour enfants juifs ou tsiganes, y déploya des trésors de ténacité et de courage pour assurer la survie (et parfois le sauvetage) de ces petites victimes: sa guerre, elle la mène contre la faim, la maladie et l'indifférence. Écrit avec plus de bonté et d'audace que de pathos, son Journal, un document historique essentiel, parvient pourtant à être une ode à la vie et à l'espoir."
Daily Passions
"Vous avez commencé à lire l’introduction de Michèle Fleury-Seenmüller et vous savez déjà un peu tout cela, mais le Journal vous dit en même temps l’émotion, la douleur de Madame Bohny-Reiter. Une douleur triple : j’ai mal de ne faire que le peu que je peux faire, j’ai mal de leur souffrance, j’ai mal pour eux d’avoir autre chose que des souvenirs et des espoirs auxquels me raccrocher.
L’introduction présente ce journal comme un nécessaire témoignage historique, mais il me semble que le lecteur saura dépasser le cadre historique qui lui permet de se dédouaner comme l’on dit pour replacer sa lecture dans notre monde actuel."
Une chronique de Noé Gaillard à lire ici
Journal de Rivesaltes, 1941-1942 (1993, domaine français)
Journal de Rivesaltes, 1941-1942: extrait
Journal
Elne, 11 novembre 1941
Heureusement que le voyage s’est bien passé ; ce n’était pas une mince affaire par les temps qui courent. Pour mon petit Espagnol, malade du cœur, tout s’est également bien passé jusqu’ici. A la Maternité nous avons eu droit à une joyeuse réception, et on a été très content des habits d’enfants que nous avons apportés — sans oublier le chocolat suisse !
Demain : départ pour le camp, vers mon nouveau travail.
Rivesaltes, 12 novembre 1941
Le vent souffle violemment autour des baraques. Il passe sans pitié par-dessus le village qui se dresse, baraque après baraque, dans une monotone étendue de pierres. C’est ici, dans cette désolation, que vivent des gens pendant des semaines, des mois, dans les conditions les plus primitives. Sans parler de l’inquiétude pour leur famille. Yeux ouverts ou fermés — je ne vois rien que d’immenses yeux d’enfants affamés dans des visages marqués par la souffrance et l’amertume. Et encore des yeux d’enfants qui défilent devant moi comme dans un film. Il n’y a qu’un jour que je suis ici, il me semble que c’est une semaine.
Si on m’avait attribué une telle chambre la semaine dernière — cela m’aurait coûté de l’accepter. Aujourd’hui cette turne, proche d’une cellule, me semble presque confortable : quatre murs blancs passés à la chaux, quelques rayons de bois, une table de toilette construite avec le bois d’une caisse — mon lit : un châssis de bois sur quatre pieds, tendu par des fils de fer — sol en pierre, natte colorée, la fenêtre où il manque une vitre obscurcie par une vieille couverture de laine, et pourtant je m’y sens comme chez moi après les événements d’aujourd’hui.
La baraque suisse se compose de cinq chambres et ses peintures murales font qu’on s’y sent un peu chez soi.
13 novembre 1941
J’ai fait un rêve merveilleux cette nuit. Il y avait ma mère qui avait peur pour moi, elle me cherchait et j’ai senti son amour au plus profond de moi-même. Je ne demande qu’une chose, de l’amour et le regard qui permet d’en faire bon usage.
Je me suis souvent réveillée à cause du sifflement du vent et de la dureté de mon lit de fer, pourtant je me sentais au chaud et protégée dans ma cellule. J’entendais de la musique quelque part — cela m’a semblé de la musique céleste — et maintenant je vais au travail.
14 novembre 1941
Petit à petit je me familiarise avec mon travail — ce n’est pas facile de faire quelque chose dans cette immense misère. Je fais peu à peu connaissance avec les mères et les enfants, elles viennent avec leurs demandes — l’une après l’autre.
Le matin ma première tâche consiste à distribuer le riz. Nos bonnes Espagnoles et les garçons le cuisent avant 8 h. Nous le mettons encore fumant dans des seaux et allons de baraque en baraque. Aujourd’hui le vent soufflait tellement fort dans le camp qu’il a presque renversé le chariot. Ce sont les baraques des malades qui m’attristent le plus. Nous avons si peu de moyens d’aider, à part les distributions, et la misère est tellement grande. Les gens sont couchés sur leur lit en robe, pullover, chemise raidie par la saleté, souvent sans draps, sur des matelas souillés. Pendant que nous remplissons les boîtes de conserve de riz, ils nous fixent de leurs regards avides. Je pense à tous les moyens dont je disposerais en Suisse, qui nous seraient tellement utiles ici. Ne serait-ce que quelques cigarettes. Ainsi beaucoup de désirs — parfois non exprimés — restent irréalisables.
Le plus affligeant reste l’infirmerie des tout-petits. Ils sont là, avec leurs visages pâles de vieillards, couchés dans leurs petits lits de bois, sans draps, sans couches, le dos, les petites jambes souvent couverts de plaies, d’abcès. Je me casse la tête, comment aider ? Quand on donne des petits habits, des couches, ils sont volés. On ne peut rien dire, car ce sont des infirmières françaises qui s’en occupent. Je ne vois qu’une seule solution : pouvoir envoyer l’un ou l’autre dans notre Maternité à Elne. Il faut toutefois constamment lutter avec le médecin-chef pour les enfants. A chaque fois je suis abattue en quittant la baraque.
15 novembre 1941
Je ne renonce pas à l’infirmerie des tout-petits. Au moins l’infirmière y met un peu plus d’ordre à présent. Quand je suis venue aujourd’hui il y avait même des rideaux, et les couches ne se trouvaient plus par terre, dans tous les coins. Mais seulement, quand je regarde dans les petits lits en bois et qu’un de ces petits squelettes me fixe de ses grands yeux fatigués, il me semble déjà fatigué de vivre, couché sur un matelas sale et couvert d’une couverture également sale, alors le cœur me fait mal. Je cherche à faire prendre un bain aux enfants, au moins une fois par semaine. J’ai trouvé baignoire, linge de bain, savon, il me manque encore du bois pour chauffer la chambre. Je n’en démords pas.
Cet après-midi, c’est-à-dire de 3 à 5 h, j’ai distribué des habits. C’est une des plus belles tâches. Ils sont tous là quand un heureux bénéficiaire revient, ils l’admirent et le jalousent.
Aujourd’hui j’ai vu un arbre au camp — il jetait des ombres qui semblaient vivantes sur le mur nu d’une baraque — cela m’a fait plaisir dans toute cette tristesse.
19 novembre 1941
Il y a longtemps que je voulais écrire — il me faut le faire maintenant — bien qu’il y ait plein d’agitation autour de moi. Je suis assise dans notre bureau et ça défile dans ma tête.
Certains jours je suis encore triste, oui, presque impuissante face à tout — mais alors on rencontre un misérable qui vous regarde d’un air heureux parce qu’on lui a dit un mot gentil.
Et je constate qu’au fond, il ne faut pas grand-chose pour rendre quelqu’un heureux. Hier quand j’ai traversé la grande place de l’Îlot J, deux infirmières internées en pleurs sont venues à ma rencontre. Depuis deux jours elles n’avaient guère eu à manger tout en ayant des nuits de garde. « Sœur, m’a dit l’une, donnez-nous un peu de votre riz. » Que dois-je faire, je ne peux pas, car nous nous occupons exclusivement des enfants — il n’y a pas assez de nourriture pour les adultes. Il me reste encore un peu de pain aux poires séchées, je leur donne cela et deux pommes — elles me remercient avec des larmes dans les yeux.
18 novembre, 10 h du soir
La dernière chanson s’est envolée. Ils sont tous retournés dans leurs baraques grises. Pendant quelques heures ils ont sûrement tout oublié — camp, vie de baraque, îlot.
Pour nos invitées nous avons rassemblé trois tables dans notre coin suisse. La soupe bouillait dans la casserole. Elsi remuait avec application la fondue, moi, je faisais les toasts. Puis nos vingt-cinq aides sont arrivés et se sont entretenus gaiement en allemand, en français et en espagnol. On en était à la dernière bouchée de fondue quand quelqu’un s’est mis à chanter une chanson de son pays — c’était un Allemand, suivi par les Espagnols, puis par nous les Suisses — puis une chanson après l’autre a défilé, les unes joyeuses, les autres nostalgiques. Plus d’un se croyait revenu en arrière dans une vie heureuse, à présent terminée. Il n’y a qu’une chose qui les maintient : l’espoir d’une nouvelle lumière, et chacun se cramponne aux paroles de la chanson que nous venons de chanter : « Hinter jenen fernen Höhen wartet unser noch ein Glück ». (Par-delà ces lointaines collines nous attend un nouveau bonheur).
Il est à nouveau très tard, et je suis franchement fatiguée bien qu’heureuse. Même s’il est parfois incroyablement difficile de faire quelque chose et d’aider vraiment, il y a beaucoup de choses qui nous touchent. Aujourd’hui je suis allée à l’école maternelle avec un sac plein de petits tabliers colorés. Quand les enfants avaient fini de dévorer leur portion de riz, je leur en ai mis un à chacun. Que d’yeux brillants devant cette « grande toilette » — ils se sont regardés furtivement de haut en bas.
Quand j’ai apporté baignoire, linge de bain, savon à l’infirmerie, on a pu donner le premier bain. Nous avons même trouvé du bois pour chauffer, tout près dans un champ où nous avons arraché de vieux sarments de vigne avec Francisco et Luis. L’hygiène manque partout. Les enfants sont couverts de furoncles, d’abcès, d’éruptions, souvent ils ne sont vêtus que d’une ou deux chemisettes, couchés sur un petit matelas sale, sans draps, dans un lit grossier. Les regards muets de ces tout-petits me vont droit au cœur — eux, si innocents, qui doivent supporter cette misère et en souffrir. — Les plus grands acceptent la situation telle qu’elle est. Leur intérêt se porte là où il y a quelque chose à manger, qu’ils s’y rendent en chaussures d’où les doigts de pied dépassent ou sans chaussures, ça leur est égal. Ils sont contents quand nous leur remplissons leur assiette en fer-blanc ou leur boîte de conserve de riz.
Mes yeux vont se fermer de fatigue. Bonne nuit, tout le monde à la maison.
22 novembre 1941
Des petits chiens sont nés à la baraque suisse. Six chiots noirs. Nous aurions aimé tous les garder, mais comment faire, quand il n’y a même pas assez à manger pour les gens.
Le matin à 7 h. Tout est gris, les baraques, le ciel, les gens en guenilles, sans chaussures ni bas, les visages gris, tirés, et quand on fait un bout de chemin avec eux, chacun se plaint de la même chose. Cette grisaille s’éclaircit seulement, quand de temps en temps, on obtient une libération. C’est ainsi qu’une mère, heureuse, est partie aujourd’hui à Elne avec son enfant. Elle sera obligée de revenir, mais elle le fait avec joie, si c’est pour le bien de son enfant.
23 novembre 1941. Dimanche.
Le vent balaie le camp, il secoue rageusement portes et fenêtres, la pluie tape contre les vitres — un véritable lac a pénétré à travers le trou de ma fenêtre.
Dimanche — je pense à tous les miens et une douce chaleur m’envahit — que la patrie, tout puisse prendre tellement de valeur, uniquement à travers les pensées.
Une mère, les jambes nues, des chiffons autour des pieds, découragée, vient me voir à la baraque — elle n’a pas obtenu l’autorisation d’amener son enfant dans un de nos homes. Inconsolable, elle me parle du refus impitoyable du chef d’îlot. Résolue, j’y vais. Je laisse la mère devant la porte de celui qui inspire tant de crainte. Le visage froid, les yeux perçants, il me dévisage. Je le regarde poliment et je lui expose ma demande. Il se radoucit et m’accorde sans autre sa signature. La mère est partie, heureuse. Si nous agissions, même envers nos ennemis, avec plus de cordialité, n’obtiendrions-nous pas beaucoup plus ?
J’ai eu beaucoup de tracas inutiles ces derniers jours parce que je n’y ai pas assez pensé.
Midi — aujourd’hui j’ai eu du temps pour mes femmes malades — le dimanche est un jour triste pour elles, me disent-elles souvent — en plus nous ne distribuons pas de riz ce jour-là.
Alors j’y suis allée les mains nues, j’ai bavardé avec chacune pendant un petit moment, et j’ai eu droit à leur gratitude contre un peu de temps et un cœur ouvert. Une chose seulement m’a à nouveau fait prendre conscience de la détresse et de la misère. C’était une vieille aux joues creuses, aux bras maigres qui n’avaient plus que la peau. Dans ses yeux se lisait tant de chagrin — des yeux qui ont brillé autrefois de bonté et d’idéalisme, maintenant on y voit le désespoir. Sa bouche a dit la même chose que ses yeux : « Sœur, je crois que pour nous il n’y a plus de printemps, plus d’espoir. Autrefois j’ai travaillé, créé, aidé les autres — et maintenant, qu’est-ce que je suis devenue — vieille, faible, malade — sans patrie ! » Comment la consoler ? Je n’avais pas d’autre consolation que celle d’un ailleurs. Elle a hoché la tête, son regard s’est porté loin, très loin, et j’ai senti mon cœur se serrer.
24 novembre 1941
Je sens profondément en moi ton amour qui me rend heureuse. En rêve je marche avec toi sur le sommet des montagnes.
26 novembre 1941
Hier la journée a été bonne. Je ne me souviens plus comment ça s’est passé, comment nous avons pu sortir cinq enfants et huit femmes du camp. Samedi, en l’espace d’une heure j’ai choisi les gens et aujourd’hui, cinq jours plus tard, ils quittent le camp. Que de mines réjouies à nouveau !
Je ne sais plus comment j’ai obtenu l’autorisation (de sortie) du médecin-chef, pourtant très strict, pour le petit de l’infirmerie. Au fond je ne croyais plus à son consentement, mais bravement, je me suis rendue dans sa « grotte » et, miracle, il a dit « oui ». Je suis sortie à toute vitesse, par peur qu’il ne revienne sur sa décision. La mère de l’enfant était rayonnante !
On pourrait croire que ce ne sont que des petites choses, pourtant elles sont d’une grande valeur pour nous. Elles donnent un but et un sens à notre travail. Après on y retourne avec plus de plaisir.
26 novembre 1941
La voiture vient de disparaître derrière les dernières baraques en vue. Je sens encore la poignée de main de tant de mères qui nous remerciaient. Seules deux d’entre elles étaient tristes. L’une a dû laisser ses deux garçons adolescents sans surveillance ici. L’autre a dû laisser partir son enfant seul. Quand on leur prend l’unique bien qu’elles avaient au camp, comment ne pas comprendre leurs larmes ? Malgré tout elles savent que c’est pour le bien de l’enfant.
Si seulement ils pouvaient trouver un foyer définitif.
29 novembre 1941
Il pleut et pleut encore, le camp se transforme en une ville sur l’eau. Pour atteindre notre baraque, il est préférable de mettre des bottes. L’eau y pénètre à plusieurs endroits. Terrible temps pour nos gens. Leurs chaussures, déjà en mauvais état, sont complètement détrempées. C’est ainsi que la plupart des enfants sont arrivés avec les pieds bleus de froid, enveloppés dans des chiffons. C’est dur de ne pas pouvoir aider, mais nous n’avons pas de chaussures. Est-ce que notre Conseil fédéral donnera suite à notre demande pour des habits ? Si seulement beaucoup de ces gens pouvaient jeter un coup d’œil dans notre camp !
Hier j’ai trouvé dans la baraque des garçons un jeune de quinze ans aux cavités orbitales enfoncées, sans globes oculaires, les mains mutilées — « une bombe », m’a-t-on dit. J’ai senti mon cœur se serrer — je n’ai rien pu faire pour lui que d’échanger sa chemise contre un maillot de corps chaud et lui mettre notre dernière paire de chaussettes.
1er dimanche de l’Avent.
La tempête a fait rage pendant toute la nuit et a fouetté la pluie contre nos vitres. Quand j’ai voulu sortir du lit ce matin, j’ai d’abord dû mettre mes chaussures de montagne ; ma chambre s’était transformée en lac. Tout le camp ressemble à une ville sur l’eau. Ça va être commode pour faire la distribution de riz !
L’Avent — puisse-t-il y avoir un peu de l’esprit de l’Avent au camp malgré pluie, tempête et misère.
Je suis partie distribuer le riz avec Francisco et Raffaela malgré pluie et tempête. Dans notre baraque, il fait encore bon, ailleurs les lits sont dans l’eau et les mères n’osaient plus espérer que nous amènerions le riz malgré tout. La joie a été d’autant plus grande lorsque nous sommes arrivés. La pluie continue à tomber ; le camp est ravagé. De l’eau partout dans les baraques. Nous aussi, dans notre baraque, nous remplissons toutes les quelques heures des seaux d’eau avec une pelle — une porte a été clouée — seul notre petit coin à manger est resté sec.
La situation est grave pour nos aides. Mon petit « chauffeur » n’a plus de chaussures, c’est-à-dire que l’eau y pénètre par tous les trous, et le pauvre garçon avait affreusement froid aux pieds. Je lui ai donné une paire de mes chaussettes en laine et mes chaussures basses — il rayonnait de joie.
Les poêles brûlent mal par ce temps, et le riz a été prêt avec une heure de retard. Quand nous sommes arrivés à l’école de tels cris de joie ont été poussés à la vue du riz chaud, que j’ai énergiquement dû demander le silence. Combien de petits corps glacés, combien de petits pieds nus, bleuis, ai-je à nouveau vus. Le pire est que nous ne pouvons pas aider, que notre réserve diminue ; nous n’avons plus de chaussures du tout. En plus le froid est arrivé. Espérons que notre lettre au Président de la Confédération sera exaucée, car l’hiver promet d’être terrible.
A la baraque des malades, mes femmes étaient couchées avec leurs manteaux (si elles en possédaient) et à l’infirmerie des enfants on a tenté de faire du feu, mais il y avait tellement de fumée que très vite, on ne voyait plus les enfants.
5 décembre 1941
Aujourd’hui c’est à nouveau jour de voyage pour de petits réfugiés. Ils sont arrivés très tôt pour le petit déjeuner dans notre baraque. Une fois encore on entend des rires d’enfants qui viennent du cœur. Puis ils sont partis vers la liberté.
Ces derniers jours m’ont apporté beaucoup de joie. Albert [frère de Friedel Bohny-Reiter] m’a écrit — quel plaisir de recevoir des lettres de chez soi — souvenirs du passé qui resteront toujours.
Le vent est glacial, la nuit, le ciel est d’un bleu cristallin, des nuits de lune — et beaucoup ont froid, très froid. Parfois je suis submergée par une rage impuissante qu’on ait provoqué une telle misère. Toutes ces injustices, ces grossièretés qui rendent la situation, déjà terrible, encore plus insupportable. Des gardiens qui oppriment et tourmentent des gens qui ont droit à la liberté. Quand je vois des gens jeunes, couchés sans force à l’infirmerie, eux qui devraient être dans l’éclat de la jeunesse. De vieilles personnes qui livrent seules leur dernier combat. Et il y a des assistants sociaux qui trouvent que tout est en ordre, bien organisé. Tous les jours le garçon de quatorze ans, aux mains mutilées, m’apparaît comme une terrible accusation.
5 décembre 1941
Cris de joie quand aujourd’hui nos écoliers ont reçu chacun une salade. C’est les Tsiganes qui étaient les plus heureux — la plupart l’ont mangée comme ça, sans la laver, jusqu’au trognon. Ils étaient drôles à voir, ceux qui partaient avec leur salade sous le bras. Les gardiens étaient moins contents car le sol de l’Îlot J était couvert de déchets.
Demain deux bébés ont l’autorisation d’aller à Elne. Nous étions presque à genoux devant le médecin-chef pour l’obtenir — des lueurs surviennent toujours — surtout avec les enfants. Quand je passe vers la baraque 41, quand ils m’aperçoivent de loin, ils crient — ola, la Suiza, la Suiza.
6 décembre 1941
Journée agitée aujourd’hui.
A 7 h ½ je suis vite allée à vélo à l’infirmerie pour voir comment se passait le départ des deux enfants pour Elne. Pas de soignante à l’infirmerie. Personne ne savait si le petit avait eu son biberon ! J’ai été ferme. Le petit José n’avait rien à se mettre à part deux chemisettes et une couche. Je suis allée à toute vitesse vers notre baraque pour y prendre chemisettes, couches et une couverture de laine. J’ai moi-même habillé le petit, et je me suis dirigée vers le camion qui attendait, dans un bras le misérable petit être, de l’autre guidant mon vélo. La mère nous suivait en pleurant, impuissante. En arrivant on s’est aperçu que la femme qui devait l’accompagner ne partait pas — qui allait, dans ce cas, accompagner le petit José ? Sans hésiter j’ai poussé l’autre femme avec le bébé de deux ans dans la voiture, moi-même j’ai pris le petit José, et nous sommes partis à Elne. Les autres se débrouilleront sans moi et Elsi est habituée à l’imprévu. A Elne j’ai retrouvé toutes nos bonnes collaboratrices en plein travail. J’ai vu nos enfants du camp dans des petits lits propres sur la terrasse au soleil, les joues rondes et rouges.
Non, notre travail n’est pas inutile ! — même si j’ai pu n’en sortir que deux. En fin de compte, cela forme malgré tout un petit groupe. J’ai déshabillé mon protégé pour lequel j’ai tellement lutté — un petit squelette est apparu, rouge, enflammé, depuis les jambes jusqu’au dos. On en pleurerait ! J’étais infiniment heureuse de le voir confortablement installé dans son lit après son bain. Après avoir reçu du précieux lait maternel.
Une petite heure de bavardage avec Bethli [Elisabeth Eidenbenz], Gret et Bettina. Puis j’ai pris congé de plusieurs femmes que j’ai connues comme mères malheureuses au camp et qui se sont mises à revivre ici.
Depuis la gare de Rivesaltes il a fallu rentrer à pied, 1 h ½ à travers champs — la soirée était extraordinairement belle, les étoiles, la lune — j’étais si reconnaissante.
8 décembre 1941. Lundi.
En principe je n’écris pas sur un jour déjà passé, à chaque jour suffit sa peine — mais hier nous avons été privés de lumière, comme si souvent.
Hier après midi j’ai fait encore quelques petites visites chez les femmes, ensuite j’ai voulu rentrer pour terminer une esquisse que j’avais en tête. La femme du garde-malade de la baraque des hommes m’attendait. Elle demandait de l’aide. Les hommes gelaient. Il y avait un mourant. — Vite du feu — chauffer les bouillottes — quelques restes de riz, et nous nous sommes mises en chemin. Dans la baraque il n’y avait que désolation. Ils tremblaient de froid dans leurs lits — « Sœur, une bouillotte pour moi ! Sœur, je suis en train de geler. » Affamés, ils se sont rués sur le riz encore fumant. Il y avait deux jeunes hommes couchés, maigres, avec des bras minces comme des enfants — on les a amenés ici à cause de leur état de faiblesse. Quelle misère, une nouvelle génération qui dépérit.
8 décembre 1941
Travail, travail — nous avons plein de projets. Nous pouvons envoyer deux enfants dans un de nos homes.
En outre nous aurons à côté de la baraque suisse un atelier de couture pour les femmes du camp. Elles pourront y coudre avec l’aide de Mme Darcau des robes et du linge pour elles. Dans la même baraque il y aura encore une menuiserie — c’est bien. Il est important d’avoir du travail et de la distraction au camp — quelque chose qui donne de l’énergie aux corps et aux âmes. A part ça, nous avons beaucoup à préparer pour Noël. Espérons que les jouets arriveront à temps.
Elsbeth aussi travaille bien. Hier elle est partie marcher, sac au dos, avec une trentaine de garçons. Ça fait du bien à nos enfants de se trouver de nouveau hors d’atteinte des gardiens — libres — dans la nature. Hélas, toute vie est étouffée au camp — celle des hommes, des âmes, des plantes, pas de pré, pas de jardin, pas d’arbre.
Bonne nuit, mes mains sont raides de froid — j’ai écrit au lit, mais j’ai la tête échauffée par les pensées et projets — demain il faut que je me mette à nos peintures murales que notre « peintre » n’a pas pu finir.
Il ne me reste presque pas de temps pour penser — chez moi, montagnes, Noël, amis. Mais quand je peux, j’y pense intensément.
9 décembre 1941
Le silence règne — un silence inquiétant. Elsi est partie pour quelques jours à Toulouse et m’a laissée seule avec un tas de travail. Je ne me souviens plus de ce qui s’est passé aujourd’hui sauf qu’à part les distributions, j’ai couru tout le temps chez le médecin, au bureau d’émigration, aux baraques, et ma tête est fatiguée — je veux aller au lit et me lever tôt demain matin.
Je feuillette mon Journal. Qu’est-ce qui s’est passé il y a un an — ne pas se rafraîchir la mémoire — ne pas penser — travailler — aider — tout, tout pour les autres. Mes chers, la maison, c’est bon de vous savoir là et que vous m’attendez.
10 décembre 1941
Je me mettais juste à écrire mon rapport de l’Îlot J, et voilà que viennent déjà pour le petit déjeuner mes petits hôtes qui partiront pour Banyuls.
12 décembre 1941
Elle était bien remplie, la journée d’aujourd’hui — maintenant il est minuit ½. Mais il est bon de travailler et de ne pas vouloir faire tout toute seule — à chaque fois que je prends cette attitude, et seulement à cette condition, je réussis. Les travaux à l’atelier de couture et la cordonnerie dans la baraque d’à côté avancent. J’ai couru aujourd’hui pour trouver tables et bancs. Jusqu’au retour d’Elsi, lundi, j’espère qu’on y travaillera. Dans toute cette agitation, une lettre d’Emmy est arrivée aujourd’hui, avec des lettres d’Italie — est-ce possible ! Que je suis heureuse !
Il faut que je dise merci pour une infinité de choses — et que j’en demande beaucoup, beaucoup — pour tous ceux qui sont faibles, tristes et malades.
12 décembre 1941
A nouveau douze bienheureux sont assis dans notre baraque et attendent (de partir). Qu’est-ce qui les attend donc ? Espérons un meilleur sort qu’ici. Quand je vois tout ces petits enfants avec leurs petits baluchons, je pense à mon propre voyage en Suisse. Ici c’est encore bien plus nécessaire de les mettre dans d’autres conditions.
13 décembre 1941
Je parle toujours de l’extérieur, et pourtant il se passe beaucoup de choses dans notre baraque suisse. Nos chiens sont de plus en plus rigolos — C’est seulement maintenant qu’ils commencent à marcher et cette nuit ils ont aboyé pour la première fois. Je me réjouis de les voir courir partout dans la baraque.
Hier Annette à écrit de l’Inselhof [hôpital de Zurich]. Tout ce qui vient de ce monde-là me semble étrange — en ai-je une fois fait partie, de cette vie de luxe ?
13 décembre 1941
Je suis fatiguée, fatiguée — malgré cela des choses ont été accomplies aujourd’hui — le travail avance dans la baraque 13, notre atelier de couture et de cordonnerie — le poêle a été installé — tables et bancs posés. Entre-temps j’ai couru du chef du matériel à notre baraque et de notre baraque au chef du matériel. Il faut quémander une chose après l’autre. Ensuite j’ai terminé les peintures de l’atelier de menuiserie, avec toujours un tas de petits spectateurs à mes pieds. Les petits Espagnols sont toujours là quand quelque chose d’extraordinaire se passe. C’était sûrement comique de voir l’infirmière suisse au voile blanc sur une échelle avec un pinceau et un pot de couleur.
De 4 à 5 h j’ai eu un moment de libre, et j’ai fait une aquarelle d’après une petite photo du val Verzasca. Y suis-je vraiment allée une fois ? Deux planches ont été peintes, l’aquarelle collée dessus et suspendue. En plus j’ai labouré notre « jardin » devant la baraque, c’est-à-dire les deux minuscules plates-bandes d’œillets. Ça fait du bien, un morceau de terre, un morceau de vie au camp.
Il reste vingt minutes jusqu’à 1 h du matin — à nouveau une journée de travail, une journée de peines, une journée riche. Je ne peux rien faire d’autre que de dire merci de pouvoir travailler ici. Bonne nuit.
15 décembre 1941
Un nouveau cahier, une nouvelle page. Le dernier, je l’avais commencé à Florence. Que de joie, que de bonheur j’y ai connus et notés. Que me réserve celui-ci ? Ici où il y a tant de choses à accueillir. Jour après jour. Ils étaient beaux les jours où j’étais seule, plongée dans le travail. La baraque 13 est installée, les femmes travaillent. On y fait des chaussures et du linge. Aujourd’hui nouvel approvisionnement. Olives, choucroute, bois, lait en poudre. Il faut connaître le travail au camp pour savoir ce que c’est, c’est-à-dire, être partout, avoir l’œil à tout — pour le moindre détail, ne pas hésiter à aller soi-même voir les différents chefs.
Hier c’était dimanche. Le matin distribution de riz dans les pouponnières. A 10 h je suis allée chanter avec vingt-deux enfants espagnols dans la baraque des malades. J’ai eu autant de plaisir qu’eux à entendre ces voix claires. Ils ne sont pas gâtés en la matière, mes malades.
Entre 1 et 4 h j’étais assise au soleil devant la baraque, et j’avais pour une fois le temps de laisser mes pensées rejoindre tous ceux qui me sont chers. Cela m’a fait un bien ! C’était une douce journée ensoleillée. A côté de moi, notre chien Guigoz avec ses deux petits, entourés par un essaim de petits Espagnols. De temps en temps une femme s’asseyait près de moi pour me parler ou pour obtenir un peu de réconfort. Un vrai dimanche.
Pour finir nous avons allumé les bougies de l’Avent et avons bu un thé qui accompagnait notre souper. Nous sommes si heureuses le soir dans notre petite chambre chauffée. Si seulement cela était possible pour tout le monde ici.
Aujourd’hui j’ai ramené un petit garçon chez nous et lui ai offert notre dernière paire de vieilles chaussures. L’éclair de ses yeux quand s’y ajoutèrent quelques bas. Ce sont ces yeux d’enfants qui me font rester ici. Si je devais uniquement m’occuper des adultes, je tomberais malade.
Le garde-malade de la baraque des hommes est venu me chercher pour un malade gravement atteint. J’ai de suite vu que c’était un mourant. Il avait été en prison — Dieu sait pour quelle faute — et cette période de faim a donné le coup de grâce à ce vieux déjà affaibli. Ses yeux étaient sans vie, son front glacé. Aucune âme aimante auprès de lui. Je lui ai demandé son nom, celui de sa femme — il ne pouvait plus me répondre et sinon personne ne savait rien de lui. Je lui ai parlé, j’ai pris ses mains froides dans les miennes, chaudes, pour qu’il sente au moins la présence de quelqu’un qui s’occupe de lui, mais il ne réagissait plus à rien. Quand je suis revenue deux heures plus tard, il était mort. Dieu merci !
Je suis seule dans notre baraque. A 11 h 30 Elsi sera à Rivesaltes. Je ferai les deux heures de bicyclette jusqu’à la gare. Je suis morte de fatigue, et pourtant je me réjouis infiniment qu’Elsi soit de retour. Je sens que seule, je serais vite submergée par le travail. Pour la première fois je pleure, tellement je suis fatiguée. J’ai hâte de pouvoir m’allonger sur mon cher grabat, mais il ne faut pas qu’Elsi fasse le trajet seule en pleine nuit.
16 décembre 1941
Donc j’ai enfourché mon vélo à 10 h 30 et en avant ! Nuit noire. Je reconnais avec peine le chemin raboteux — je dévie quelques fois dans les vignes — jusqu’à ce que j’atteigne la grande route, en dehors du territoire du camp. Tout à coup, une voix dans le noir : « Halte, vous allez où ? » C’est un garde. Je mets pied à terre, lui donne mon laissez-passer, il s’enquiert en détail des raisons de mon voyage nocturne. Soudain il perd son ton de commandement et me donne quelques indications sur le chemin à suivre. Je ris — ils sont tous les mêmes. Au plus profond de chaque cœur d’homme existe une possibilité d’ouverture — Il faut seulement savoir la trouver.
La nuit m’accueille à nouveau. Kilomètre après kilomètre. Pas âme qui vive, nulle maison, nulle lumière. Au-dessus de moi les étoiles et dans la lueur de la petite lampe de poche fixée à l’avant du vélo danse notre croix blanche sur fond rouge. Un profond sentiment d’être protégée descend sur moi — rien ne peut arriver sans Celui qui nous tient tous dans sa main. Où ai-je ressenti la même impression ? J’y suis : c’était en descendant de l’Oberalpstock, dans ce labyrinthe de crevasses. C’est quand la détresse, la solitude et le danger sont les plus grands que Dieu est le plus proche.
Les lumières éparses de Rivesaltes se rapprochent. Voilà la gare, le train est déjà là, Elsi apparaît. Notre retour interrompu par trois policiers — c’est presque gai. A la maison nous bavardons tard dans la nuit, assises dans notre coin, et nous faisons des plans pour notre nouveau travail.
16 décembre 1941
Nous avons de la visite. Deux Suissesses qui travaillent dans un de nos homes. En traversant avec elles l’Îlot J, je prends conscience à nouveau de la misère de la vie de camp. Quelles impressions cela laissera-t-il à nos visites de l’extérieur ? Elles étaient de plus en plus silencieuses — je me suis rappelé mon premier jour au camp.
19 décembre 1941. 1 h ½ du matin.
Je suis rentrée tard d’une fête chez les Juifs de l’Îlot B. Ils fêtent Hanoucca en souvenir d’une victoire, il y a 2000 ans, des Macchabées sur les païens, victoire à laquelle Dieu aurait miraculeusement contribué. Étrange — ils vivent ici, persécutés, sans patrie, espérant toujours retrouver leur ancienne patrie, la Palestine, espérant la venue du Messie. (…)
La nuit dernière la mère de deux de nos enfants qui nous ont causé beaucoup de soucis s’est enfuie avec eux. Où peut-elle être en ce moment, par ce froid, par ce vent glacial avec ses deux jumeaux affamés ? Il est question d’autres fuyards, parmi eux ma vieille Gitane qui parle le suisse allemand. On parle d’envoyer les Gitans dans un autre camp la semaine prochaine. Sincèrement cela me ferait de la peine, car si quelqu’un a de la sympathie pour eux, c’est bien moi. Ce sont des voyous et ils sont très sales, mais ils ont le cœur au bon endroit — et souvent j’ai découvert chez eux une âme très belle, merveilleuse. Ils savent qu’ils ne sont que des « Gitans », mais pourtant ces gens, grands et de belle stature, portent la tête haute, et leur démarche élastique a quelque chose de particulier, étranger à toute peur, qui me plaît. Ils adorent leurs enfants, les défendant comme des lionnes le font pour leurs petits, et la petite bande noiraude du jardin d’enfants se serre comme des chatons. Au camp ces gens habitués à la liberté sont très malheureux. Ce sont des êtres qui ont besoin de la nature, de la terre, du large. Pourtant nous espérons avec tous les autres que par-delà les hauteurs lointaines, le bonheur existe.
Aujourd’hui à l’infirmerie une femme a voulu se suicider. Mon cœur se serre. Cette tragédie me submerge. Quel désespoir chez cette pauvre femme, pour qu’elle absorbe une bouteille entière d’un liquide mortel ! La voilà allongée dans son lit, les yeux brûlants. Je n’ai pas pu la regarder longuement — c’était une accusation. Est-ce qu’elle aura fini de souffrir quand je reviendrai demain ?