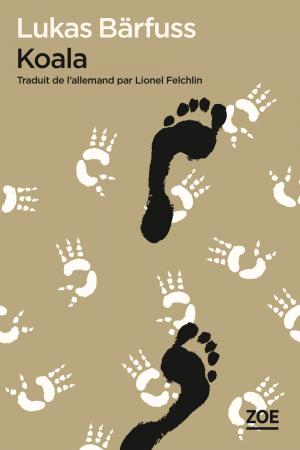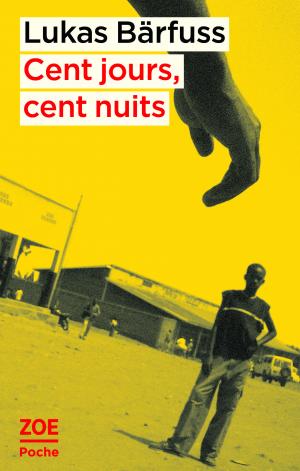parution février 2017
ISBN 978-2-88927-386-7
nb de pages 176
format du livre 140 x 210 mm
Koala
Traduit de l'allemand par Lionel Felchlin
résumé
Voici le récit d’un destin, celui d’un homme qui a choisi de se suicider. Et d’une enquête, celle du narrateur qui cherche à savoir pour quelles raisons son frère, sur lequel il sait si peu de choses, a décidé d’arrêter de vivre. Il se retrouve confronté à un important silence, à un sujet qui semble comme dissimulé derrière une immense paroi. Pour contourner cette muraille, l’enquêteur dévide l’un des rares fils qui le rattachaient au défunt : pourquoi son frère était-il surnommé Koala ? Armé d’une implacable volonté de savoir, il suit jusqu’au bout cette piste. En rapprochant l’histoire personnelle de son frère et celle, tragique et haletante, de l’animal australien voué à l’extinction, Bärfuss livre une histoire naturelle sur les rapports de l’homme à ses congénères et à son environnement. Un roman de la violence, envers soi-même ou autrui.
Né en 1971, Lukas Bärfuss vit à Zurich. Aujourd’hui, il est l’un des auteurs germanophones les plus connus. Politique, combatif, dans la tradition des grands intellectuels allemands, il se bat pour un monde où les valeurs de l’esprit l’emporteraient sur celles de l’économie. Avant de vivre de sa plume, il a été ferrailleur et jardinier, puis a repris une librairie. Bärfuss se confronte aux questions de société, en particulier celles qui concernent les plus faibles. Ses textes, Lukas Bärfuss les imprègne d’une force rythmique qui vient de son expérience de dramaturge. Il en ressort un puissant effet de réalisme.
« Lukas Bärfuss s’inscrit résolument dans la lignée des Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt ou Adolf Muschg, celle des écrivains citoyens ». Catherine Bellini, L’Hebdo
Arc Hebdo
"En rapprochant l'histoire personnelle de son frère et celle, tragique et haletante, de l'animal australien voué à l'extinction, Bärfuss livre une histoire naturelle sur les rapports de l'homme à ses congénères et à son environnement. Un roman de la violence, envers soi-même ou autrui."
RTS – Versus Lire
Ré-couter l'émission du 26 mai 2017 avec Lukas Bärfuss ici
En attendant Nadeau
"...Quand ce serait « une mort ordinaire, répandue comme la myopie », le suicide constitue aujourd’hui encore un véritable tabou, un interdit qui sous-tend le roman de Lukas Bärfuss. (...) Dans les livres d’Histoire, dans les musées, le narrateur creuse les diverses approches et représentations du suicide, toujours liées à l’organisation sociale en vigueur, à la place que l’individu est censé y prendre. (...)" Jean-Luc Tiesset
L'article en entier ici
La Gruyère
"Journal intime, roman d'aventures, documentaire animalier, Koala tient de l'espèce hybride, pour traiter un sujet difficile, le suicide. (...) [ce] récit est passionnant. (...)" LDC
La Liberté
"... Lukas Bärfuss (...) sait très bien jouer sur les contrastes, baladant son lecteur du nord au sud; de l'atmosphère maussade d'un bistrot thounois à celle luxuriante de la végétation et de la faune australienne, croisant au passage destin individuel et destin collectif. Raison du cœur et raison d'Etat. (...)" Ghania Adamo
Le Temps des livres
"...[un] roman atypique, sans doute le plus personnel de l’auteur, qui débute comme un récit intime au bord du lac de Thoune et se déploie en roman d’aventure à la Joseph Conrad. Car c’est bien à une plongée au cœur des ténèbres que nous convie l’auteur, les siennes propres, celles de sa famille mais aussi, et c’est tout l’art de l’écrivain d’y parvenir, celles d’une société, la nôtre. Pour y arriver, il va faire ce qui lui a donné le statut d’écrivain et d’auteur de théâtre le plus en vue de la scène littéraire helvétique: gratter jusqu’au sang une bonne conscience cousue, ici comme ailleurs, de mythes historiques, de contentement de soi et d’un sentiment tenace de supériorité. Un roman poignant et dérangeant, comme toujours avec Bärfuss. (...)" Lisbeth Koutchoumoff Arman
L'article en entier ici
Le Courrier
"...A partir d'une histoire éminemment intime, Lukas Bärfuss remet (...) en question un mode de vie et d'être, la figure du koala lui permettant de donner à ce qui s'est passé [le suicide du frère] un sens qui dépasse le destin individuel de son frère pour s'inscrire dans elui de l'humanité tout entière. Son histoire de la violence, envers soi, les autres et l'environnement, pointe l'absudrité des rapports prédateurs et d'un fuite en avant délétère. Une réflexion aussi lucide que désabusée, dans une écriture au rythme infaillible." Anne Pitteloud
Blog, Tribune de Genève
"Très beau livre, rythmé – la pratique théâtrale de l'auteur – Koala intéresse par le mystère de ce suicide, par la personnalité du frère, évoquée plus que décrite, mais qu'on découvre peu à peu, et par l'opposition constante entre deux êtres aux fonctionnements antithétique. L'apathie contre désir. L'inertie contre l'énergie. La résignation contre le talent."
Alain Bagnoud
Le carton de mon père (2024)
À la mort de son père, il y a vingt-cinq ans, Lukas Bärfuss refuse l'héritage, constitué essentiellement de dettes. Il ne garde qu'un carton, rempli d'une triste paperasse. Quand, à la faveur d'un grand rangement, il l'ouvre et passe en revue ce qu'il contient, c'est toute son enfance précaire qui défile.
À la lumière de la Bible, Darwin, Claude Lévi-Strauss ou Martine Segalen, l'écrivain décortique les notions de famille et d'origine, ces obsessions dangereuses de notre civilisation. Il en profite pour évoquer les "biens jacents", ces biens sans propriétaires que sont les océans, les animaux sauvages, et surtout les déchets. Dans cet essai qui est sans doute son livre le plus personnel, Lukas Bärfuss démontre une fois encore son esprit critique acéré.
Cent jours, cent nuits (2024, Zoé poche)
Rwanda, début des années 1990. Le Suisse David Hohl étouffe dans son quotidien morne à l’aide au développement. C’est dans sa liaison avec Agathe, fille d'un fonctionnaire hutu, et l’instabilité politique causée par le soulèvement des Tutsis qu’il trouvera l’excitation inquiète nécessaire pour sortir de sa léthargie. Jusqu’à ce que survienne l’horreur, en 1994: le génocide des Tutsis par les Hutus.
Plutôt que de fuir, David se tapit dans sa maison de Kigali durant les cent jours du massacre. La culpabilité, l’effroi, la faim et la solitude se mêleront dans ce huis clos environné de pure violence.
Hagard (2018, domaine français)
Hagard raconte une perte de contrôle subite et totale. Philip, promoteur immobilier, la quarantaine, se met à suivre une femme inconnue qui porte des ballerines bleu prune. En trente-six heures, il sacrifie à sa poursuite ses rendez-vous, ses voyages, son assistante, sa voiture et son enfant. Philip emporte à sa suite le narrateur, omniscient mais incapable de percer l’intime motivation de son personnage : la curiosité ou le désir suffisent-ils pour couper un homme du monde réel ?
Cette fuite en avant donne l’occasion à Bärfuss de poser son regard acéré sur les travers de notre société contemporaine. Quant au lecteur, il est happé par le rythme insufflé à ce roman haletant.
Lionel Felchlin
Koala: extrait
On m’avait invité dans ma ville natale pour donner une conférence sur un poète allemand qui, par un jour de novembre deux siècles plus tôt, s’était mis à la recherche d’un coin reculé près du lac de Wannsee à Berlin avant d’abattre son amie Henriette Vogel en plein cœur et de se tirer une balle dans la gorge. Dans la grande salle de l’Hôtel de Ville, un imposant édifice du XVIe siècle situé sur la place centrale, je devais livrer quelques réflexions sur cet homme et son œuvre, et comme c’est une petite ville où les bistrots ferment de bonne heure, qu’il serait donc trop tard pour y prendre un bon repas après la conférence, on s’attabla dès dix-huit heures dans un restaurant au bord de la rivière qui traverse la ville en formant deux bras.
À part les organisateurs de la soirée, il y eut mon frère, qui arriva une demi-heure après qu’on eut passé la commande et s’assit à notre table. Je lui avais téléphoné quelques semaines auparavant et l’avais informé de ma visite dans mon ancienne patrie, même si j’étais certain que l’objet de ma conférence, l’œuvre sombre et en partie absconse d’un poète allemand de la fin du XVIIIe siècle, l’intéresserait peu. Nous avions rarement l’occasion de nous voir ; mon frère ne sortait guère de cette ville que je n’avais pas tout à fait quittée de mon plein gré vingt-trois ans plus tôt et que j’évitais depuis. Nous menions des vies différentes, partagions peu de choses à l’exception de notre mère et de quelques souvenirs d’enfance et de jeunesse pas seulement agréables, et deux heures nous suffisaient d’ordinaire pour satisfaire au devoir implicite de ne pas tout à fait perdre de vue notre lien fraternel.
Je le vois encore, en ce jour de la fin mai, entrer dans le restaurant aux saveurs asiatiques et à la clientèle essentiellement jeune, nous chercher du regard avec, en toile de fond, une baie vitrée qui donnait sur quelques saules, la rivière et la première rangée de maisons, un homme svelte dans la quarantaine, soigné, aimable, réservé, un célibataire, cela sautait aux yeux. Il s’assit à côté de moi, renonça au repas et commanda une bière. Mon frère ne se mêla pas à la discussion sur la littérature et la structure des phrases hypotactiques, pour lesquelles ce poète suicidé est célèbre. Il sirota son verre en silence. Je me souvins comment il avait prévu cette situation en disant au téléphone qu’il n’avait aucune envie de se trouver en compagnie de mes admirateurs, qu’il avait une sainte horreur des lèche-bottes. Ma réponse (nous aurons sûrement l’occasion de discuter) fut contredite et je me sentis de plus en plus mal à l’aise au fil des minutes. Comme on était installés sur de longues banquettes dans ce restaurant, nos corps se touchaient, ce qui semblait être pour lui un désagrément de plus. Il se tortilla sur la banquette et voulut prendre ses distances, je sentis que seule la courtoisie le retenait de partir et, comme je viens de le dire, si la situation ne me faisait pas plaisir, j’avais l’habitude de cette ambiance, le silence ne me surprenait pas, sa bouderie ne m’était que trop familière.
De loin en loin, on échangea quelques phrases, lorsque le serveur apporta les boissons ou le repas et qu’il y eut une pause. J’appris qu’il n’allait pas bien, qu’il avait des problèmes avec une femme rencontrée quelques années auparavant et dont l’amour, il le craignait, touchait à sa fin. La situation ne permettait pas d’entrer dans les détails, mais nous ne l’aurions pas non plus fait si nous avions été seuls, tranquilles. S’il y avait une intimité entre nous, elle se bornait à un silence complice, à une parole allusive qui n’allait jamais au fond des choses.
Peu avant huit heures, l’addition était réglée, on se leva pour gagner l’Hôtel de Ville de l’autre côté de la rue, lui en revanche, qui était attendu au centre d’hébergement d’urgence pour le service de nuit, où il attribuait aux mendiants et aux toxicomanes sans abri une couverture et un lit, prit congé et enfourcha son vélo bleu ciel, un véhicule singulier qui s’inspirait d’une moto, avec un guidon haut, une selle basse et des pneus larges. Le vélo ne cadrait ni avec son âge, ni avec sa personne, un fait dont il avait conscience et qui lui procurait une joie malicieuse. Il s’éloigna dans le crépuscule et disparut parmi les promeneurs qui profitaient de la douce soirée printanière.
La conférence eut lieu, je fis renaître l’image d’un homme, selon ses mots, qu’on ne pouvait pas aider sur terre, un ancien soldat qui avait erré à travers l’Europe et s’était aussi échoué pendant quelques mois dans cette ville, sur une île de l’Aar, à l’aube d’une guerre civile, pour se faire à une simple et modeste existence de paysan, une chimère qu’il avait poursuivie dans le seul but de s’y perdre. Était-ce l’évocation de cette existence, de la violence qu’il avait vue et engendrée, comme enfant soldat lors du siège de Mayence par exemple, un carnage indescriptible comme l’affirment tous les témoins, tous à l’exception de ce poète, qui de chaque canonnade ne perpétuait que les plus doux souvenirs, ne songeait pas aux sept mille cadavres dispersés dans la ville mais aux premiers éveils du sentiment – quoi qu’il ait pu vouloir dire par là –, cela tenait-il à ma gêne de célébrer un double suicide, ou plus exactement un meurtre et un suicide, ou juste à cette douce soirée de printemps qui m’égayait, je ne puis le dire. La seule certitude, c’est qu’à la fin de la conférence, j’étais pressé de me rendre au bistrot le plus proche. Deux anciens copains d’école m’accompagnèrent. Le restaurant n’était qu’à quelques pas de l’Hôtel de Ville, de l’autre côté de la place, et je ne sais pas s’il y avait une signification au fait qu’elle portait le nom de « Zu Metzgern », la guilde des bouchers, qu’un lion d’or ornait sa façade, un lion arborant une énorme hache de boucher, quoi qu’il en soit, je descendis aussitôt deux ou trois bières avec une eau-de-vie claire à chaque fois. Or les restaurants ferment de bonne heure dans cette ville, nous allâmes donc quelques maisons plus loin après la fermeture, un peu ivres déjà, dans un café peu éclairé qui était accessible par un escalier étroit et où nous fûmes les seuls clients, à l’exception de deux dames séduisantes, reines de la nuit installées au bar. L’une d’elles était une beauté asiatique nommée Daisy, dont je fis la connaissance au cours des heures suivantes, à chaque verre plus amusé par ses connaissances linguistiques lacunaires qui donnèrent lieu à de ravissants malentendus. Elle trouvait excitant de divertir un écrivain, et j’étais surpris par l’attention avec laquelle elle suivait mes explications, par l’intérêt sincère dont elle fit preuve pour mes interprétations difficilement intelligibles de certains passages obscurs de l’œuvre de ce poète. Elle semblait être la première personne à manifester de la compréhension pour la monstrueuse virgule qui, dans l’une de ses nouvelles, transforme une phrase tout à fait banale pendant une scène de réconciliation entre un père et sa fille en description de la mère qui se masturbe tandis qu’elle assiste à ce moment à leur insu. Toujours est-il que Daisy était suspendue à mes lèvres et se moquait de mon intérêt pour les mères onanistes, et quand je me retrouvai dans la ruelle déserte à quatre heures du matin, je regrettai moins les honoraires de la conférence gaspillés en quelques heures que cette Daisy qui, à l’annonce de la dernière tournée, avait rapidement mis les voiles et m’avait laissé avec mes questions littéraires et l’addition à régler.