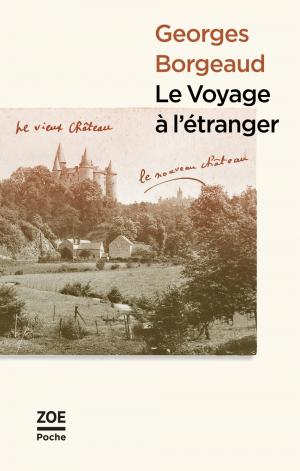parution mai 2018
ISBN 978-2-88927-537-3
nb de pages 544
format du livre 105x165 mm
Le Voyage à l'étranger
résumé
Le Voyage à l'étranger (Grasset, 1974) est un roman de formation dont le héros est pris dans l’engrenage de l’échec. En 1937, le jeune Jean Noverraz quitte la Suisse pour la Belgique. Après une expérience malheureuse au monastère, il devient le précepteur de l’indiscipliné comte Christian de Moressée, au château de Soye. C’est alors qu’il fait son éducation sentimentale auprès d’une femme mariée plus âgée que lui, Madeleine Cédrat. Surpris dans sa liaison, il est chassé du château : «A partir de là, les épisodes de mon voyage à l'étranger passèrent irrévocablement du côté de ces choses que la vie – ou moi-même – laissa inachevées.»
Préface d’Anne-Lise Delacrétaz
Georges Borgeaud est né en 1914 à Lausanne, de « père inconnu ». Il fait ses classes à Aubonne, sur la Côte vaudoise, et au Collège catholique de Saint-Maurice, en Valais, qu’il quitte avant le baccalauréat, en 1933. Ce départ forcé marque le début de cinq années difficiles durant lesquelles Borgeaud exerce différents métiers, dont le préceptorat en Suisse et en Belgique. Il se croit même une vocation religieuse, mais un séjour dans un couvent bénédictin en Belgique le dissuade d’entrer dans les ordres.
En 1938, il commence un apprentissage de libraire à Bâle, puis à Fribourg. Pendant la guerre, ses projets littéraires sont retardés par le service militaire, mais il reprend ses activités de libraire pendant les permissions, notamment à la Librairie Universitaire de Fribourg, qui joue alors un rôle important pour la France occupée.
Décidé à vivre de sa plume, Borgeaud quitte définitivement la Suisse en 1946 pour s’établir à Paris. Grâce à l’appui de Dominique Aury, proche des milieux littéraires romands, Le Préau paraît en 1952 chez Gallimard. Le succès est immédiat pour le romancier débutant, qui reçoit le Prix de la Critique la même année : il se lie avec Marcel Arland, Jean Tardieu et François Nourissier, collaborant bientôt à La Nouvelle Revue française, à La Parisienne, à la revue Preuves, à l’hebdomadaire Le Point – la plupart de ses chroniques et articles, notamment sur les peintres, sont rassemblés dans les quatre volumes des Mille feuilles (1997-1999). Si La Vaisselle des Evêques, publié en 1959 par Gallimard, rencontre un moindre retentissement, Le Voyage à l’étranger (1974) et Le Soleil sur Aubiac (1986), qui marquent le passage de Borgeaud chez Grasset (en coédition avec Bertil Galland), sont distingués respectivement par le Prix Renaudot et le Prix Médicis de l’essai.
C’est à Paris, qu’il ne devait guère quitter si ce n'est pour des voyages en Italie, recensés dans Italiques (1969), et des séjours dans son pigeonnier du Quercy, que Borgeaud est mort en 1998. Le Jour de printemps a paru, à titre posthume, en 1999.
Anne-Lise Delacrétaz
Le Soleil sur Aubiac (2012)
Chaque été pendant plus de vingt ans, Georges Borgeaud a abandonné Paris pour retrouver, avec sa chatte, ses livres et ses manuscrits, la quiétude d'un vieux colombier loin de l’effervescence urbaine. Comme une sorte de toile d’araignée, l’ouvrage relie d’un même fil le Paris littéraire, la Suisse des années vingt et le Quercy de la fin du vingtième siècle, capte les paysages et les personnages du Sud-ouest dans de superbes descriptions, s’attache aux scènes de genre et aux modes de l’époque.
Borgeaud livre ici son ars vivendi, forgé au creuset de la solitude.
Le Voyage à l'étranger: extrait
Aurais-je pu imaginer que je m'attacherais à cette chambre intimidante, ouvrant ses fenêtres sur deux horizons différents? Au nord-est, sur la forêt des Ardennes et sur les pelouses du château, plantées d'arbres-sentinelles dont l'un avait été malmené par la foudre, au sud sur une grosse ferme et ses dépendances, sises au creux du vallon, au bord de la Lesse, rivière rapide ou paresseuse selon les jours. Le soleil couchant tombait derrière la falaise d'en face, en rosissant notre façade, le donjon et la chapelle, tandis que sous nos murs le château-vieux, premier berceau des Moressée, entrait dans la nuit prompte des lieux encaissés.
J'ai bercé dans cette chambre toutes sortes de réflexions, proches de celles que je me faisais sur moi-même dans la cellule monastique, sauf qu'il me paraissait y avoir laissé Dieu. Tout était comme les frondaisons que je voyais de ma fenêtre, immobile sous le soleil de l'été, assoiffé, en état de suspens. Les innombrables gargouilles, gouttières et larmiers du château attendaient l'orage et le ruissellement des pluies.
J'oubliai au château le mesquin confort que j'avais connu à la maison, la propreté obsessionnelle de ma mère qui cherchait à maintenir neuf ce qui est destiné à périr. Non pas que le luxe de Soye fût négligé mais il s'était quelque peu fatigué avec le temps et j'en aimais l'usure que l'on continuait à frotter, sans réussir à effacer des meubles les cernes d'eau, les brûlures d'un plat trop chaud, les taches d'encre du secrétaire, les encoches faites par une âme désoeuvrée. Le soleil avait mangé les couleurs de la moquette, pâli les tapis. La porcelaine de la baignoire était rongée par le calcaire, les becs de cuivre à col de cygne de la robinetterie étaient attaqués par le vert-de-gris. Tout cela ne m'attristait pas. J'y trouvais de quoi rêver aux vies qui m'avaient précédé. On a la famille que l'on peut.
Il y avait là une expression visible de la continuité du temps, qui me changeait de ma piaule d'étudiant dont je combattais la banalité avec ce que ma mère appelait des saletés, qu'elle jetait à la corbeille à papiers, et qui provenaient de la nature, une feuille de platane, une fleur de terrain vague, une rose, la capsule d'un pavot dont je mangeais les graines, un insecte que je regardais à la loupe et remerciais d'être entré par la fenêtre pour me distraire de la laideur de la tapisserie, des meubles et des reproductions accrochées aux murs. A Soye, j'étais en relation avec mes prédécesseurs. D'autres que moi eussent trouvé triste mon décor. Au contraire, il me sembla avoir retrouvé un lieu qui m'avait déjà accueilli, on ne sait trop quand. J'ai toujours imaginé des maisons que je reconnais au cours de voyages, persuadé de les avoir habitées dans une vie précédente.
Pour ma vanité, j'avais à ma disposition du papier à lettres armorié et gravé à l'adresse de Soye. Le téléphone était le 2 à Dinant, la ville la plus proche. J'étais bien enfant d'être flatté par de tels détails, mais n'importe qui à ma place se fût laissé aller à croire que sa condition était montée de quelques crans. Et si cela n'eût pas suffi à le convaincre, j'aurais ouvert mes deux fenêtres sur l'espace. Qui, en effet, n'eût pas été impressionné par la situation de mon observatoire? Quand l'architecture s'accorde avec le lieu où elle s'est implantée, il n'y a pas de plus beau mariage entre l'invention de l'homme et la permanence de la nature.
Soudain, ma vie à Soye me laissa espérer que ma différence de condition allait peu à peu se résorber, du fait de vivre loin des miens, sans passé et sans témoins. Les attentions exceptionnelles dont j'étais l'objet me persuadaient que j'étais délivré à tout jamais de la servitude.
On frappa à la porte de ma chambre avec une discrétion qui appartenait aux rêves. Je m'asseyais alternativement devant mes fenêtres d'où je ne voyais que le ciel, au point de me donner l'illusion que le château n'avait plus ses fondations mais qu'il se tenait comme un ballon au-dessus des frondaisons. On tambourina à nouveau à la porte.
Robert, le maître d'hôtel, poussa devant lui un chariot sur lequel, par ordre de la comtesse, il avait disposé un déjeuner. Ce chariot roulait sur de petites roues silencieuses. Les plats reposaient sur des napperons de dentelle. Trois timbales d'argent coiffées de couvercles à coupoles, terminées par un gland évoquaient les chapelles du Mont-Athos.
Robert déplia une nappe sur la table ronde, au centre de la pièce, y disposa le couvert. Sur le rebord des assiettes étaient peintes la couronne comtale et la décevante devise des Moressée : « Ni plus, ni moins ». La lumière de l'après-midi, tamisée par des voilages et des rideaux à demi tirés, flattait tout ce qui composait ce repas inattendu comme s'il m'était servi au moment le plus délicieux d'un rêve. Enfin le maître d'hôtel ouvrit toute grande la double porte pour repasser avec son chariot, découvrant la longue, obscure perspective du couloir. Hormis le tapis rouge, la disposition des appartements, des chambres à gauche, à droite, était assez semblable à la succession des cellules dans un cloître. Je ne changeais guère de décor, mais celui-ci n'appartenait plus à l'esprit monastique. Je le ressentis comme une parodie.
Dès qu'eut disparu le maître d'hôtel, je me mis à , me réjouir d'avoir été servi, enfin! non pas comme au restaurant où il est normal de l'être, mais en privé. Mes raisons de trouver soudainement la vie si belle tenaient à des détails, au rince-doigts, aux couverts d'argent, à l'eau fraîche et au vin dans des carafes, aux toasts enveloppés d'une serviette repliée, deux moitiés d'un melon reposant sur un lit de glaçons, coquilles de beurre, pêches dans un compotier sur des feuilles de vigne vierge, au mânche de nacre du couteau à dessert...
Cela demandait de ma part une soumission à un petit rituel distingué afin de calmer l'impatience de ma faim, m'interdire de soulever les couvercles sous lesquels étaient au chaud des mets inconnus. Je libérai sans hâte des fumets délicieux. Une de mes coupoles grecques abritait un chou-fleur sur lequel avait neigé du persil, l'autre du civet de lièvre dans sa noire préparation. La fraîcheur tendre de la salade, la verdeur de ses feuilles et l'or pâle de son coeur ne m'avaient jamais paru si beaux. Ce qui chez ma mère n'eût été que commun, à Soye devenait merveille. Il fallut que je brime ma gourmandise pour ne pas essuyer avec du pain le creux de mon assiette, et laisser revenir aux cuisines un peu de chaque mets.
Robert, disparu dans les méandres du château, dans le sommeil général, avait oublié de desservir.
Le temps me parut d'autant plus long que j'ignorais de quelle façon les gens de Soye le passaient, qu'aucune surprise ne pouvait plus me distraire, qu'il était difficile de sortir d'un lieu où l'on m'avait dit de me tenir jusqu'à quatre heures de l'après-midi. Visiter une maison inconnue m'eût paru indiscret, d'autant que je me voyais mal descendre seul l'escalier d'honneur, sortir dans le parc à la vue de tous.
Ma montre marquait trois heures. Dans mon pays, j'aurais dormi sur le sable de la plage de Préve-renges. Que faisais-je donc si loin de chez moi? La moindre grève du lac m'eût apporté un bonheur simple. Je commençais à craindre de souffrir de l'exil. Aussi, pour mieux évoquer mon pays, je fermai les lourds rideaux de la chambre, et m'appliquai à penser exclusivement à un peuplier d'Italie, au bord de la Dranse, que j'avais un jour enlacé de mes bras.
Je fus distrait par un portrait d'homme suspend au-dessus du secrétaire, l'épée au Banc sur un habit de velours noir et portant jabot de dentelles. J'en avais remarqué l'ancienneté mais l'ennui me le fit regarder dans les détails. Je lui trouvai, soudain, de l'intérêt, puis décelai dans son expression de la sévérité, comme s'il avait voulu pénétrer mes intentions, censurer mes pensées. Il me suivait sans sourire, partout où j'allais, si bien qu'il restreignait l'espace de mon domaine. Son nom était gravé sur une plaque de cuivre : Charles-Florent-Auguste de Gavre d'Hubermont, né le 17 janvier 1802, mort à Soye le 7 juin 1874. Soixante-douze ans d'existence, pensai-je, à imposer aux autres son mauvais caractère. Cela avait dû paraître bien long à ses contemporains. Aussi, je lui fis un pied de nez et m'en trouvai audacieux.
Peu importait mon audace puisqu'elle n'avait pas de témoins, mais je me mis à rire, de ce rire insolent qui me rendit plus tard insupportable à tant d'amis, quand au plus grave d'une conversation il me prend sans que je puisse l'arrêter. C'est que tout me paraît alors comique, et encore davantage les peines, les soucis, les inquiétudes. L'incongru est de retourner les notions habituelles comme un gant.
Le silence de l'été s'épaississait encore à travers les murs du château. C'était pour me plaire, et me faire peur, car si je ne touche pas à ce silence au moins une fois dans la journée j'ai le sentiment de me perdre. J'en tire force et faiblesse, résolution et sommeil. Il menace mon bonheur, parfois, mais il l'amplifie aussi. Il donne de l'intensité à ma vie, mais il me rapproche de la mort. Ainsi m'a-t-il peu à peu persuadé que je finirai à cette heure de la nuit où il est à son point culminant.
L'un de mes éducateurs m'avait expliqué que là était le signe distinctif des mélancoliques dont j'avais le bonheur et le malheur d'être. Cet éducateur fut un des rares «pères » que j'aurais pu avoir, car, naturellement, je lui échappai dès qu'il voulut prendre la place de l'inconnu. Je l'ai aimé pour son coeur, son intelligence, pour le fait de m'avoir révélé Dieu d'abord, la vie ensuite. C'est lui qui décela chez moi une nature contemplative et qui me dirigea vers le monastère. Je le respectais aussi pour la difficulté qu'il avait à concilier sa foi religieuse et sa passion de la vie. Il était insaisissable; il était ce que je suis. Il avait pénétré quelques-uns de mes secrets, jeté des lumières sur mes obscurités, peut-être parce qu'il y reconnaissait de chères et détestables faiblesses qui avaient été les siennes.
Un jour, donc, il me dit ceci que je n'ai jamais oublié, et presque mot à mot: «Jean, je vois la joie éclairer ton visage et presque aussitôt après le chagrin l'assombrir. Tu as la vulnérabilité de l'eau. » C'était un langage métaphorique, mais je venais du pays du lac et j'en connaissais les humeurs brusques et changeantes. Enfin, quelqu'un me donnait une surface, un beau présent auquel mon milieu n'aurait pas songé.
En attendant l'heure d'entrer dans ma fonction, j'ouvris les tiroirs de la commode dont le vide n'allait guère être rempli par mon trousseau. Je délaçai les sangles de ma panière japonaise qui en respira d'aise. Ne parlons pas de la rudesse de mes chemises de coton, ni des chaussettes de laine noire que ma mère avait tricotées pour se plier aux exigences monastiques, encore moins des six mouchoirs bariolés achetés pour leur solidité et leur ampleur. Il était urgent de destiner mon premier salaire à l'achat d'une garde-robe nouvelle, plus à mon goût, d'un costume sur mesure, car pourquoi ne donnerais-je pas à l'habit civil la dignité de celui que j'avais eu au couvent? C'est un lieu commun de croire que l'habit ne fait pas le moine. Le peu de temps durant lequel je l'ai portée m'a suffi pour comprendre que certaines paroles, certains actes n'étaient plus possibles sous la bure. Pourquoi la vie laïque n'aurait-elle pas un habit adéquat à sa dignité?
Si je n'avais rien de remarquable dans mon habillement, j'étais fier d'une montre en or offerte pour mes vingt ans, du, stylo de ma première communion. J'avais voulu donner au préceptorat des accessoires convenables en achetant dans une librairie-papeterie-de Bruxelles une grammaire française, celle de l'Académie, très discutée, et qui venait de paraître, une' boîte de compas, des cahiers, gommes et crayons. Bien sûr, une Bible m'accompagnait, moins par piété que parce que j'en avais presque trouvé un exemL plaire dans mon berceau. J'ai pris très tôt l'habitude de la lire au hasard et j'y ai découvert rigueur et pitié, cruauté et douceur, passion et détachement, aventures et sagesse, enfin et surtout, beaucoup moins de morale que l'on croit.
Je tirai d'une serviette de cuir le carnet de toile cirée sur lequel, je l'ai dit, j'avais l'intention de déposer les alevins, si possible les brochets, du marais intérieur, mais la manie de la perfection était un bien mauvais hameçon au bout de mes lignes.
J'avais retiré d'entre mes affaires une photographie de ma mère à trente ans, qu'elle avait elle-même encadrée, croyant que ma cellule de novice pouvait recevoir l'image d'une jeune et belle femme, portant canotier, tailleur d'amazone. J'étais ému par sa grâce, navré qu'elle n'eût pas d'équivalent dans l'esprit ni dans la sensibilité. Il est des femmes qui n'ont pas le langage de leur beauté. Le Père prieur avait emporté le portrait en même temps que les vêtements de ma laïcité, dans cette réserve où l'on garde les frusques, les hochets du monde à la disposition de ceux que l'on oblige à y retourner. De toute façon je ne l'aurais pas accroché au mur, car je n'ai jamais pu afficher une dévotion filiale. Ma mère, tout en étant une présence obsédante, m'a toujours paru absente de ce que je suis, de ce qui est ma personnalité. Quand je la rencontre sur mon chemin, j'ai toujours envie de lui demander : «Que fais-tu là? »
Dès que je tombai sur cette photographie, je la sortis de son cadre et la déchirai en petits morceaux, effrayé et dégoûté par mon geste. Ce souvenir me tourmente encore, mais est-ce le remords qui l'entretient? Plutôt mon propre étonnement devant un tel acte. Mais, dira-t-on, c'est ça le remords. Il m'arrive, parfois, de sortir de mes dossiers un portrait de ma mère jeune fille. Avec le temps, tout souvenir acquiert du charme, et davantage encore ces photographies très composées prises dans un studio. Ma mère rêvait aux palmiers et aux minarets d'Afrique du Nord. « Mais elle est très belle, ta mère! » insiste-t-on.
Je rédigeai une lettre à son adresse sur une feuille à en-tête de Soye, en l'assurant que le comte et la comtesse de Moressée étaient venus m'attendre en gare de Namur. Mon mensonge réparait ce que j'avais ressenti comme une sorte d'indélicatesse. Mais je voulais aussi lui laisser croire que d'autres avaient à mon égard des attentions que je ne lui connaissais pas.