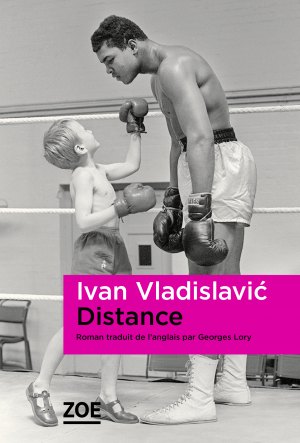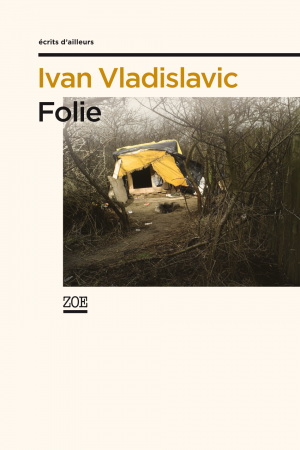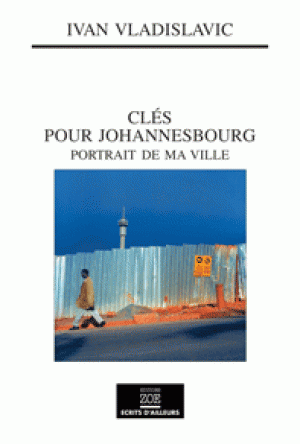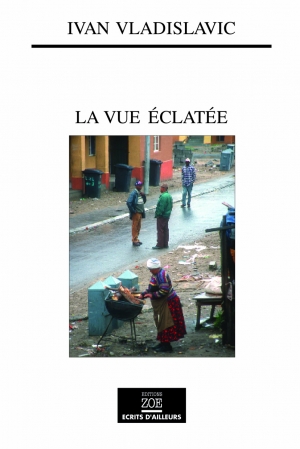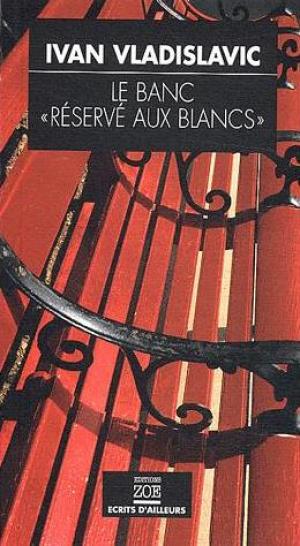parution août 2013
ISBN 978-2-88182-898-0
nb de pages 240
format du livre 140 x 210 mm
prix 30.00 CHF
Double Négatif
Traduit de l'anglais (Sud africain)Nida et Christian Surber
résumé
Vous êtes jeune et vos études commencent à vous peser. Vous voulez enfin connaître la vraie vie, mais le moment est mal choisi : nous sommes en Afrique du Sud, au temps de l’apartheid, les tensions raciales sont à leur comble et seul votre statut d’étudiant vous met à l’abri du service militaire. Alors que faire ?
Neville commence par tergiverser, par rechercher de petits boulots en marge de ses études maintenant négligées. Puis il se décide : ce sera l’exil en Angleterre. Avant ce saut dans l’inconnu, Neville vivra toutefois une journée capitale, une journée passée en compagnie d’un photographe prestigieux, auprès duquel il va apprendre à ouvrir les yeux.
En fixant sur la pellicule le moment où tout bascule, l’instant où les événements se précipitent, la fin de l’apartheid aurait-elle une chance de devenir intelligible ? Le sens des scènes éclairées par l’auteur, sur la page qui se substitue à la photographie, nous amène, nous lecteurs, à mieux voir.
Ivan Vladislavić vit à Johannesburg, il est l’auteur d’une dizaine de livres dont la plupart sont publiés en français chez Zoé. Son œuvre a été récompensée à plusieurs reprises, notamment par le prestigieux prix américain Windham-Campbell.
Edelweiss
« (…) Sans dogmatisme ni morale, Ivan Vladislavic suggère dans un style alerte, incisif et élégant une réflexion sur la lutte de la surface contre la profondeur, mais aussi sur le désir de faire et, à travers les images décrites, sur l’esthétisme comme arme – et comme recours. » Joëlle Brack
Le Nouvelliste, L'Express
« (…) Et c’est là une des grandes richesses d’Ivan Vladislavic : il montre et fait comprendre sans dire. (…) Dans « La vue éclatée » déjà, des objets, des bâtiments en l’occurrence, permettaient à Ivan Vladislavic de décrire une situation sociale dans une fiction prenante. (…) « Double négatif » est une réponse subtile, complexe et contrastée à cette question, à celles de l’apartheid, de l’exil et du retour. » Laurence de Coulon
Le Courrier
"(...) En quelques deux cents pages, Ivan Vladislavic donne substance avec brio à une fiction qui, au-delà du comique apparent de telle ou telle rencontre, aborde des sujets loin d'être anodins: l'insertion, la capacité à se trouver un rôle dans la société des adultes quand on est un jeune sans idéal ni solide vocation au départ; la mémoire; le sens ou le non-sens de la vie humaine; enfin, l'aptitude à ouvrir les yeux et, au besoin, à effectuer un saut dans l'inconnu." Marc-Olivier Palatano
L'Hebdo
« (…) Des rencontres, de l’humour, une société apparaît en négatif, vue par les détails, par ses façades et ses marges. Plus profond qu’une approche frontale. Une fiction délicate sur le temps, la mémoire, et notre place parmi nos semblables. » Julien Burri
Jeune Afrique
Le roman-photo de Jo’burg
« (…) Elégamment écrit, vivifié par un humour discret et des images fortes, le roman raconte l’évolution de Neville Lister, jeune étudiant vaguement déconnecté du réel, qu’une journée passée avec un photographe célèbre, un certain Saül Auerbach, va lentement mais radicalement transformer. (…) Devenu artiste, il est le « double négatif » d’Auerbach-Goldblatt, se déplaçant – en voiture – pour aller photographier des personnes devant le mur de leur maison, sans jamais entrer chez eux… Une correspondance parmi d’autres dans cet exaltant jeu littéraire qui n’est pas sans rappeler les expérimentations de l’Oulipo. »
Nicolas Michel
Le Temps
"(...) Double Négatif joue finement sur la polysémie : les mots, doubles des images ; le négatif redoublé dont peut-être naîtra un sens positif. L’ironie légère du narrateur, la distance qu’il maintient sans arrogance crée une complicité affectueuse avec le lecteur. Il y a des scènes magnifiques, visuelles, mais aussi sonores, de beaux personnages. Jamais il n’est question de la couleur des peaux, mais les accents jouent leur rôle de marqueur social, des finesses qui échappent au lecteur occidental mais qui semblent jouer un rôle essentiel, et qui confirme que Vladislavic est un grand peintre du détail." Isabelle Rüf
LivresHebdo
Prises de vue
Double négatif, le dernier roman d'Ivan Vladislavic, né à Prétoria en 1957 et l'un des meilleurs représentants de la littérature sud-africaine actuelle, peut se lire sous de nombreux angles comme une image composée de différents plans et de quantité de détails bord cadre. Un premier coup d'oeil renvoie à une fiction d'inspiration autobiographique: les vingt ans d'un garçon de la classe moyenne blanche dans le Johannesburg sous le joug de l'apartheid du début des années 1980. Neville, le jeune narrateur, se cherche: il a abandonné des études de sociologie et de philosophie politique pour se confronter au monde du travail, et est retourné vivre chez ses parents. Flottant, indéterminé, il juge ses "opinions chancelantes" quand il les compare aux engagements des étudiants politisés qu'il a croisés. Pour échapper au service militaire, il décide de s'exiler en Angleterre, y passe dix ans, devient photographe publicitaire avant de rentrer dans son pays et sa ville métamorphosés. Jusque-là, on pourrait penser à J.M. Coetzee et son Vers l'âge d'homme transposé vingt ans plus tard. Mais la comparaisn est trop réductrice. Car Double négatif, qui est à l'origine la partie romancée d'un livre écrit avec l'artiste photographe sud-africain David Goldblatt, est aussi une réflexion perçante et intemporelle sur les liens entre art et politique, entre formation du regard et construction de soi. La narration en trois époques s'organise autour d'une journée décisive que le jeune homme passe à suivre un ami de la famille, le photographe Saül Auerbach, arpenteur des quartiers noirs de Johannesburg, double fictionnel de Goldblatt. Journée de travail qui part d'un jeu, le "jeu des maisons", dont la règle consiste à choisir d'un promontoire surplombant la ville trois maisons dont Auerbach essaiera de photographier les habitants. Comme Clés pour Johannesburg ( Zoé, 2009), où l'écrivain redessinait le plan de la ville par un récit à multiples perspectives, Double négatif ne s'intéresse pas non plus aux vues d'ensemble, mais isole des clichés dont la valeur est aussi métaphorique qu'explicitement documentaire. De cette journée de prises de vue, le narrateur ne tirera ainsi aucune thèse démonstrative mais des leçons instables et plutôt amères.
Véronique Rossignol
Ivan Vladislavic est un écrivain d’une rare intelligence, au style teinté d’un humour subtil. En une succession de scènes magnifiques, à la fois documentaires et allégoriques, jouant des doubles, des reflets, de la polysémie, Double négatif est un grand roman.
Le Boulevard
Distance (2020)
Branko sait comment on embrasse les filles, rêve de gagner le Tour de France et aime fouiller dans les affaires de son petit frère Joe. Qui, lui, joue aux billes, invente des langages farfelus et rassemble dans des albums les coupures de journaux qu’il lit sur son idole, Mohamed Ali. Même si, dans cette famille sud-africaine blanche des années 1970, leur père refuse d’appeler le mythique boxeur autrement que Cassius Clay.
Quarante ans plus tard, Joe décide de s’inspirer de ses albums pour son nouveau roman. À l’aide de Branko, il va réduire la distance qui les sépare de leur passé commun.
La narration, qu’assument tour à tour Joe et Branko, est rythmée par le langage flamboyant des reporters sportifs de l’époque. Elle raconte la relation entre deux frères, faite de tendresse et de cruauté.
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Georges LoryFolie (2012)
Quelque part dans l’immensité du veld sud-africain, un homme arrive dans un terrain vague et y prend ses quartiers. M. et Mme Malgas, les occupants de la maison voisine, observent avec la plus grande attention cet intrus qui interrompt singulièrement leur routine. Monsieur est quincailler, Madame dépoussière les bibelots, regarde la télévision et attend le retour de son mari.
L’inconnu explique à son voisin, de plus en plus fasciné, son plan : construire la maison idéale. La voisine, quant à elle, est convaincue de la folie de cet homme qu’elle s’obstine à appeler « l’Autre », et qui lui vole son bon mari.
Folie est un huis clos à trois, récit d’une désillusion comique, tissée de clous et de fils, de chimère et de mots.
Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Aurélia LenoirClés pour Johannesbourg (2009)
Début du deuxième millénaire, Johannesbourg reste divisée, désormais autant par la pauvreté et la violence que par la race. Vladislavic, fin arpenteur des rues, des quartiers, des parkings, des jardins, circule de scène en scène aussi cocasses que tragiques. Le livre est composé de 138 entrées, comme autant de clés pour comprendre la ville, à la manière Vladisalvic: sorte de regard agile et enregistreur, esprit joueur qui analyse, compare, fait des liens et manie les mots pour dire les impressions les plus fines.
Ce texte est une ode amoureuse à Johannesbourg, industrielle, polluée, dangereuse, belle et injuste.
Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Nida et Christian SurberLa Vue éclatée (2007)
Publié presque au lendemain de la fin de l’apartheid, Les Monuments de la propagande, un recueil de onze nouvelles, prend acte de la fin d’une ère détestable de l’histoire de l’Afrique du Sud et, on peut l’espérer, de la fin de tous les racismes institutionnalisés. L’exubérance, le chatoiement, mais aussi la fragmentation de ce monde renouvelé appellent irrésistiblement la métaphore du kaléidoscope. Ivan Vladislavic en tire un parti inattendu en nous faisant assister à l’invention de l’Omniscope, instrument d’optique indispensable en temps de chambardement. D’une nouvelle à l’autre, les objets prennent alors une valeur emblématique, un tuba, un banc.
Un saisissant raccourci met la Russie post-soviétique en contact avec l’Afrique du Sud post-apartheid dans l’histoire qui donne son titre au recueil. L’abolition des barrières physiques et mentales, que Bessie Head avait prophétiquement annoncée comme inéluctable, se traduit ici par une extraordinaire variété de tons, par la multiplication des points de vue – la voix narrative peut enfin transcender la couleur de la peau –, voire par le caractère parfois ludique d’une littérature qui, sans trahir ni démissionner, peut à nouveau respirer plus librement, la tâche des écrivains témoins de l’insupportable injustice ayant été heureusement accomplie.
Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Christian SurberLe Banc "réservé aux Blancs" (2004)
L’apartheid vient d’être aboli et Mme Coretta King, la veuve de Martin Luther King, s’apprête à inaugurer le musée consacré à cette période sinistre. Les préparatifs vont bon train, mais les employés, bien que très fiers de leur copie parfaite d’un banc WHITES ONLY, l’un des symboles les plus forts de l’époque révolue, sont en conflit avec leur directrice qui ne veut pas de faux dans ses collections. Or les appels au public pour obtenir des pièces authentiques sont restés vains et ont même engendré des situations ahurissantes.
Sous le comique et le rocambolesque s’ouvre un monde de souffrances et d’humiliations restées vives : la blessure n’est pas cicatrisée. L’auteur manie ici l’ironie et la satire avec maestria.
Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Ch. SurberDouble Négatif: extrait
À un moment donné, Louis s’est mis à débiter les mêmes rengaines que je devais supporter tous les jours en roulant à travers Joburg avec Jaco Els. La transition s’était faite imperceptiblement, comme si quelqu’un avait mis un disque et tourné le volume au minimum. Avant même que vous ayez pris conscience de la musique, votre état d’esprit n’est plus le même. Louis laissait échapper un poison inodore. Les souvenirs préférés de son enfance étaient ceux des farces qu’il avait faites aux domestiques. Tendre des cordes pour les faire trébucher, lâcher des pétards sous leur lit, dévisser le siège des latrines. On aurait dit que sa vocation venait de là. Son métier, qui l’amenait à jeter des gens en prison pour des délits mineurs, se résumait à une suite de blagues malveillantes. À voir la façon dont il en parlait, ces expulsions, ces détentions sans jugement, ces troupes envoyées dans les townships, n’étaient que la manifestation à plus grande échelle de ses espiègleries de gamin.
Le caractère viscéral de son obsession m’a frappé. Ses préjugés raciaux confinaient à la passion. Ils lui causaient une sorte de douleur exquise, comme le fait d’agacer du bout de la langue une dent qui branle ou de gratter une piqûre de moustique jusqu’au sang.
Dans le miroir de ses récits, toutefois, la perspective se renversait. Alors qu’il passait son temps à blesser autrui, à faire du mal et à créer des problèmes, il se voyait lui-même comme une victime. Tous ces gens qu’il n’aimait pas, ces créatures inférieures parmi lesquelles il était forcé de vivre, le rendaient malheureux. C’était lui qui souffrait. Aujourd’hui, je comprends tout ça bien mieux qu’alors. À l’époque, je m’efforçais de saisir la part que je jouais moi-même dans la machinerie du pouvoir et je me méprenais souvent sur son mécanisme.
— Seid Sand, nicht das Öl im Getreibe der Welt, disait mon amie Sabine. Seid unbequem.
Soyez incommodant. Soyez le grain de sable dans les rouages du monde, pas la goutte d’huile. Un grain de sable ? Fallait-il me laisser réduire à néant ? Me laisser moudre ? C’était abject. On pouvait sûrement être le bâton proverbial mis dans les roues de l’oppression, plutôt qu’une poignée de poussière, non ? Mieux vaut être le marteau que l’enclume.
Le visage torturé de Louis, sa moue dégoûtée, ses yeux plissés, ont dévié le cours de mes pensées. Même sa chevelure impeccable avait l’air de souffrir. Je la voyais se tortiller sous le peigne, le matin, pendant qu’il s’observait mélancoliquement dans le miroir de la salle de bains.
J’aurais pu lui crier :
— Regardez autour de vous ! Voyez comme nous sommes privilégiés. Nous venons de manger à nous en rendre malades, il n’y a qu’à voir les déchets, les assiettes de carton remplies d’os et de pelures, de serviettes froissées et de boules de papier alu, de jus sanguinolent. Et malgré ça, nous n’avons même pas entamé nos réserves.
La plaque posée au coin du feu était encore pleine de viande, de côtelettes épaisses et de rouleaux de saucisse, soudés à l’acier inoxydable par la graisse. Le veau gras rissolait encore sur les barres noircies du gril. On aurait dit que la fête était sur le point de commencer.
Je savais ce qui avait déclenché en moi cette bouffée de révolte. Au travers des feuilles de la haie luisait le capot de la nouvelle Corolla de Louis, campée dans l’allée comme une énorme pièce à conviction.
J’aurais dû le défier au jeu du Chasseur de bières. Nous étions assez ivres pour ça, et il avait bien la tête de l’emploi. J’ai préféré engager une discussion avec lui, comme si nous étions en train de débattre certains points de Marx sur la pelouse devant la bibliothèque, à la sortie d’un séminaire du professeur Sherman. Les détails m’échappent, à présent ; ils sont sans importance. Le capital à dominante raciale, les moyens de production, le fonctionnement du complexe militaro-industriel, je n’avais que ça en tête. Je me rappelle avoir dit :
— Imaginez seulement que vous ayez travaillé toute votre vie au fond d’une putain de mine d’or et que vous n’ayez toujours pas de quoi nourrir votre famille. Vous pouvez vous l’imaginer ? Non, vous ne pouvez pas. C’est ça, le problème.
— Le laïus des cocos de Wits t’est monté à la tête, m’a-t-il répondu en gros. Qu’est-ce que tu y connais, à la vraie vie ? Quand tu auras un peu vécu, vu des choses, tu feras moins le malin. Si tes camarades blacks s’emparaient du pays, ils le mèneraient droit à la faillite. C’est ce qui est arrivé dans tout le reste de l’Afrique.
Mon père a risqué quelques plaisanteries et tenté de changer de sujet. Quand il a vu que ça ne prenait pas, il m’a fixé d’un regard pénétrant, accompagné d’une grimace qui a paru lui tirer les traits et lui faire un long nez effilé. C’était le regard qu’il me lançait quand j’étais petit et que je refusais de l’écouter. Ça voulait dire : « Va dans ta chambre. Tout de suite. Sinon je me fâche. »
Nous avons commencé par nous invectiver, puis nous en sommes venus à échanger des bourrades comme des écoliers cachés derrière l’abri à vélos. Du coin de l’œil, j’ai vu Netta se lever et ma mère se retourner dans son fauteuil pour chercher à comprendre la raison de cette agitation.
Louis faisait une tête que Jaco aurait appelée un donner my gesig, une gueule condescendante qui appelait les coups. Je suppose que je l’aurais effectivement frappé. Il paraît que j’ai levé ma bouteille comme une matraque. Mais avant que j’aie pu aller plus loin, mon père m’a envoyé une grande gifle en travers de la figure. Un seul coup a suffi à ramener l’ordre dans le monde. Louis a rajusté sa chemise et sa bouche. J’ai été sommé de présenter mes excuses, ce que j’ai fait. Nous avons échangé une poignée de main.
Après ça, je n’ai rien fait de plus séditieux que de regagner ma chambre.
En passant, je me suis arrêté à la salle de bains pour m’asperger le visage d’eau froide. J’avais une marque rouge à la mâchoire. En matière de discipline, mon père s’était toujours contenté de paroles. Il détachait sa ceinture et disait :
— Tu veux que je te tanne les fesses ?
Quelle blague ! Il n’avait jamais levé la main sur moi. Qu’il ait passé à l’acte m’avait encore plus choqué que le coup lui-même. J’ai exploré la marque de ses doigts sur ma joue comme la carte d’un nouveau territoire.
Les Van Huysteen sont restés pour le café, ne voulant pas donner l’impression que la journée avait tourné à la catastrophe. Plus tard, je les ai entendus reprendre leurs enfants endormis – « Ag, quel dommage de les réveiller ! » et « Comme ils sont mignons ! » – avant de redescendre l’allée. C’est la dernière fois qu’ils ont mis les pieds chez mes parents.
Un bourdonnement de voix dans la cuisine. Puis mon père est entré dans ma chambre.
J’étais encore un peu ivre, ou alors je l’étais redevenu. La pièce chavirait, ce qui fait que je suis resté là, sur mon lit, les mains derrière la nuque, insolent. J’étais prêt à piquer une colère, mais le visage que faisait mon père m’en a empêché.
— Désolé, mon grand, a-t-il dit.
— Oh, ça va.
— Tu comprends que j’aie dû faire ce que j’ai fait ? Je ne pouvais pas te laisser frapper un invité chez moi.
— Ja.
— Tu cherchais la bagarre. (Je cherchais la bagarre ? Et puis quoi encore !) Il a bien fallu que j’intervienne.
— Oui, mais alors c’est lui que tu aurais dû frapper, ai-je dit. Il l’aurait mérité, cet enculé de fasciste.
J’imagine que mon père a été plus surpris par mon gros mot que par mes convictions politiques, que j’affichais depuis peu.
— Peut-être. Mais je ne veux pas que tu règles tes différends à coups de poing. Pas sous mon toit.
Nous avons parlé encore un peu. Mon père a fait une plaisanterie sur les juristes afrikaners. Pour finir, il a étendu le bras pour me montrer quelque chose dans la paume de sa main. J’ai pris un moment avant de comprendre le sens de son geste. Lorsque je me suis levé pour lui serrer la main, j’ai vu qu’il avait des larmes dans les yeux.
Les remords de mon père ont duré une semaine. Puis un beau soir il m’a convoqué dans son bureau et m’a fait asseoir sur la chaise face à sa table de travail, comme si j’avais été un représentant de commerce qui aurait démoli la voiture de fonction de l’entreprise, et m’a débité un sermon.
Mon escarmouche avec Louis l’avait rendu nerveux. Le mot d’ordre de la famille avait toujours été : « Ne pas faire de vagues ». Mon père craignait, sans le dire expressément, que je m’engage politiquement et que j’aie de mauvaises fréquentations. Il y avait peu de risques, en fait. La politique me déconcertait. Les étudiants politisés que j’avais croisés faisaient preuve d’une certitude inquiétante. Par comparaison, je n’avais que des opinions chancelantes. J’étais trop facilement séduit par les idées d’autrui. La moitié du temps, je cherchais à me convaincre moi-même, en faisant comme si je savais de quoi je parlais, comme si j’étais dans le coup.