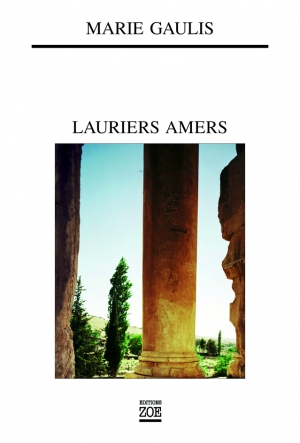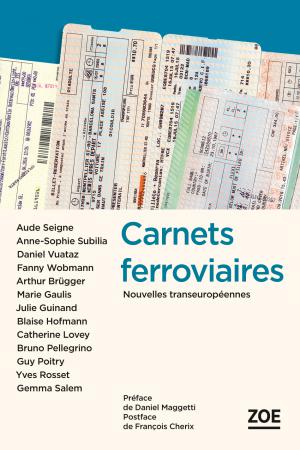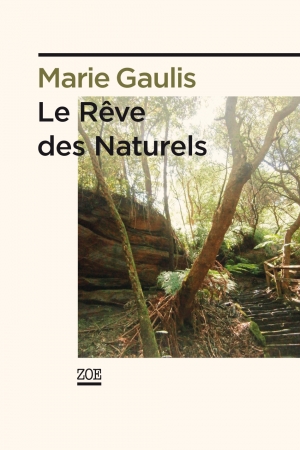parution avril 2009
ISBN 978-2-88182-644-3
nb de pages 144
format du livre 140 x 210 mm
prix 27.00 CHF
Lauriers amers
résumé
Ce récit est une quête et une enquête, un retour personnel et historique sur le passé. Marie Gaulis est née en 1965 d’une mère française et d’un père genevois. Son père, Louis Gaulis, écrivain, est mort en 1978 à Tyr, au Liban, lors d’une mission qu’il effectuait pour le Comité international de la Croix-Rouge, dans des circonstances qui n’ont jamais été élucidées.
Qui, sur l’ordre de qui, a tiré sur la voiture du CICR au crépuscule alors que Louis Gaulis rejoignait sa base ? Trente ans après, Marie Gaulis est retournée au Liban, s’est rendue sur le lieu exact de l’accident, a cherché minutieusement des témoins, les a interrogés. Non pas pour construire un tombeau à son père, mais pour le retrouver au-delà des communiqués officiels et des rapports d’experts. Et pour renouer les liens avec une histoire, un pays et une décennie qui continuent de peser sur le présent. Sans oublier que morts et vivants cohabitent dans les ruines de Tyr, entre les bouquets de lauriers-roses.
Spécialiste de la Grèce moderne, traductrice de Karaghiozis, Marie Gaulis (1965-2019) est l'auteure de plusieurs romans. Son écriture est ample et précise, souvent empreinte de mélancolie mais aussi d’audace.
Le Royaume des oiseaux (2022)
En quatre portraits, Marie Gaulis esquisse le destin de deux couples qui se succèdent dans un vieux château savoyard, aussi superbe que décati, aussi coûteux qu’empreint d’une grâce surannée. Sur un siècle, elle raconte, fine et douce observatrice, la fin d’un mode de vie et l’acceptation réjouie d’une renaissance dans un monde contemporain, plus compliqué, mais plus vivant.
Que ce soit de Lausanne à Paris, de Vienne à Genève ou de Glasgow à Londres, chacun des treize auteurs de ce recueil situe son histoire à bord d’un train qui parcourt l’Europe. À l’occasion d’un long trajet en chemin de fer, l’une se souvient de son voyage dix ans plus tôt, elle traque la différence entre son être d’hier et d’aujourd’hui. Un autre se remémore la géniale arnaque dont il a été l’auteur, un troisième retrace l’incroyable hold-up ferroviaire du South West Gang dans l’Angleterre de 1963.
Ces nouvelles donnent une vue d’ensemble inédite sur la manière de concevoir l’Europe comme espace physique et symbolique. Les auteurs étant de générations très diverses, le lecteur appréciera les différentes manières d’appréhender notre monde proche et de s’y situer.
Nouvelles de Aude Seigne, Blaise Hofmann, Anne-Sophie Subilia, Gemma Salem, Bruno Pellegrino, Arthur Brügger, Daniel Vuataz, Marie Gaulis, Fanny Wobmann, Catherine Lovey, Julie Guinand, Guy Poitry, Yves Rosset.
Préface de Daniel Maggetti, postface de François Cherix
Le Royaume des oiseaux (2016)
En faisant parler Max le patriarche débonnaire et Mary sa femme américaine, puis Joson le grand-père voyageur et Dora la bien-aimée grand-mère, Marie Gaulis raconte le lieu aimé de l’enfance, une terre savoyarde à la fois réelle et rêvée. Dans le château familial, la peinture s’écaille, les canalisations gèlent, les cheminées fument, les guerres passent. Tandis que les aïeux, désormais âmes légères comme des oiseaux, se confient, honnêtes, la narratrice se souvient, réfléchit et se console. Dans Le Royaume des oiseaux, Marie Gaulis saisit la place que prennent parfois malgré nous les légendes et les rituels ancestraux et les confronte à la nature si sensuelle et à la vie d’aujourd’hui.
Laudatio pour le prix des Charmettes 2016 :
« Le Royaume des oiseaux de Marie Gaulis ne se raconte pas. Il se vit, écrit Sabine Faulmeyer sur le site littérature-romande.net. Elle a raison. A travers l’évocation d’un lieu bien précis et au gré de ce que lui en livrent les différents personnages de ce roman, ce sont autant d’horizons spatio-temporels et socio-culturels qui s’ouvrent au lecteur. Or c’est de l’au-delà que proviennent les voix des personnages. Ainsi suspendues hors de temps, elles livrent leurs considérations, leurs sentiments ou autres impressions que leur inspire la vie menée dans ce château savoyard, épicentre du livre. Par la qualité de son style, par la richesse de son vocabulaire, par le rythme de son phrasé, Marie Gaulis invite son lecteur à la suivre dans cet univers dont la géométrie varie selon celle de tous les autres qui s’y côtoient, s’y rencontrent sinon s’y confrontent. »
Hélène Richard-Favre
Ecrivain, membre du jury du Prix des Charmettes-J.-J. Rousseau
Le Rêve des Naturels (2012)
Après la belle enquête sur la mort de son père au Liban, sur le fil entre fiction et reportage (Lauriers amers, Zoé 2010), Marie Gaulis nous livre un nouveau texte au statut troublant. Rêverie, méditation, réflexion ou fiction, il s’agit en tout cas de l’exposé d’une tristesse anthropologique, du constat d’un paradis perdu, du rêve d’un état encore sauvage. Rousseau n’est pas loin, mais la narratrice est bien une femme du XXIe siècle, lucide, curieuse et joueuse, vivant dans le monde hybride d’aujourd’hui. A travers marches, rencontres et lectures, elle évoque les Aborigènes d’Australie, ces Naturels dont le mode de vie millénaire a basculé au moment de leur rencontre avec les Européens.
Attentive à tout, au paysage qui l’entoure, à la brutalité de la nature comme à l’agitation de la ville, aux pulsations de son corps comme aux échappées de son imagination, la narratrice développe un état de réceptivité qui se creuse et s’affine, permettant à la fois d’exprimer ses propres rêves d’une sauvagerie perdue et d’accepter l’imperfection du monde dans lequel elle vit.
Marie Gaulis vit à la Chaux-de-Fonds et à Sydney. Ecrivain, elle a publié plusieurs recueils de prose et de poèmes (Editions de l’Aire et Métropolis). Traductrice, elle a adapté Karaghiozis et le château des fantômes, théâtre d’ombres grec, pour Les Classiques du Monde (Zoé). Le Rêve des Naturels est son deuxième livre chez Zoé après Lauriers amers.
Lauriers amers: extrait
Prologue – Ēté de 2003
J’entends à la radio qu’une voiture piégée a explosé à Beyrouth – sans doute un attentat du Hezbollah, dit la voix dans la cuisine fraîche où flottent des odeurs de basilic et de melon. Je me précipite pour augmenter le volume, mais je n’apprendrai rien de plus. Les nouvelles déroulent leur litanie, et rien ne semble pouvoir fixer le cours des mots ni celui des malheurs. Je n’en saurai pas plus sur cet attentat, on n’en reparlera pas : que suis-je censée faire de cette information ? L’écouter, sentir un instant mon cœur s’arrêter, puis s’accélérer, interrompre mes activités domestiques, suspendre mes gestes, avoir une pensée rapide pour cette partie du monde, pour Beyrouth, ville étrangère où je suis passée, hirondelle d’un printemps lointain, le temps de faire connaissance avec le désastre, ville transfigurée par la guerre et la reconstruction, et la vie inconnue qui s’y mène, tandis que sur le petit village provençal chauffé à blanc descend la paix de midi.
Mais la voix à la radio ne m’en dira pas davantage, et Beyrouth et ses convulsions épileptiques retournent à leur obscurité. Pendant les quinze années de guerre, Beyrouth était toujours présente, étoile noircie, éventrée, mutilée, résistant en même temps à la destruction, vivante, excitante. Les voitures explosaient comme de gros pétards de fête votive, la liste des otages s’allongeait, les miliciens massacraient un clan entier, avec bébés et gardes du corps (leurs voisins, leurs cousins, leurs coreligionnaires), les riches Libanais continuaient à faire du ski sur les pentes dénudées de leurs cèdres depuis des millénaires.
Est-ce que Beyrouth n’a pas été alors la ville la plus photographiée, la plus filmée, la plus regardée de ces décennies, tournoyant dans sa robe de fête en haillons, narcissique et sanguinaire comme une reine de légende ? Est-ce qu’elle ne se trouvait pas affreusement belle en ce miroir, est-ce qu’on ne frémissait pas à la voir se détruire avec un tel entrain sous les yeux fascinés du monde, qui ainsi s’occupait, sortait de son ennui pour admirer les jeux de la guerre et s’en effrayer de loin, avec de petits cris effarouchés ?
Pendant la guerre, on ne comptait plus les voitures piégées, elles faisaient partie de la mort quotidienne, vilains cafards ventrus remplis de boulons qui explosaient près d’une école en plein midi, ou en face d’un cinéma le vendredi soir (ce qui bien sûr évoque d’autres images, d’autres faits récents et la répétition d’une méthode à laquelle l’amateurisme même semble assurer un avenir durable, avec quelque chose de lassant dans cette ronde meurtrière). Elles pouvaient exploser aussi dans une ruelle déserte, hasardeuses détonations qui envoyaient dans les jardins avoisinants tout un bouquet de ferraille qu’ensuite des gamins dégourdis récupéraient et revendaient.
Mais cette voiture piégée, bien des années après la guerre, solitaire, qui éclate dans le calme d’un été studieux, qu’annonce-t-elle ? Ou que réveille-t-elle ? Un feu jamais tout à fait éteint, des tireurs embusqués derrière les façades rutilantes des centres commerciaux, des milices s’entraînant dans quelque sous-sol tapissé de liège et de photos de filles nues, des jeunes gens exaltés prêts à reprendre le jeu, le grand jeu absurde et grisant qui fait pâlir le pauvre monde et rougir les fronts d’un sang plus vif ? Ou bien ne serait-ce plutôt qu’une explosion isolée pour exhaler un peu de colère et beaucoup d’ennui ? Je ne le saurai pas, puisque déjà la voix radiophonique est passée à autre chose, les flux de la Bourse et la hausse des températures, qui eux aussi se répètent, inlassablement. J’interromps le flot des mots et retourne au silence de la table de travail – et dehors, même les cigales se sont tues, on n’entend plus que le vigoureux chant de la fontaine, qui est à lui seul un miracle au milieu de la fournaise.
Je dois pourtant revenir à Beyrouth, ville non résolue, mystère sans beauté, laideur banale sous le ciel mauve, plaie, blessure, balles au vent comme des graines, portes des bars et portières de voitures qui claquent (à moins que ce ne soit des tirs), barattage du beurre fondu de la guerre et de nos vies. Ville liquéfiée comme sous le souffle d’un feu divin, ville tordue, déformée par la chaleur et le chagrin, ville excessive et monotone, ville que je voudrais cesser de regarder, que je voudrais ignorer comme je ferme les yeux devant trop de laideur ou de peur, comme je recule et détourne la tête devant l’avancée du métal et les coulées de boue, les explosions et les commentaires qui tuent une seconde fois, qui annulent tant de vies d’un seul mot ; et nous tous qui poursuivons malgré tout nos boitillantes pérégrinations.
Je dois pourtant la regarder ; à moins que ce ne soit la ville qui me fixe de ses yeux de poisson crevé flottant dans les eaux moirées du port, Gorgone, monstre très ancien et ultra moderne, notre modernité de destruction et de régénération, festive et oublieuse, tueuse dans la joie, et surprise, au petit matin, de se retrouver sans rien pour la vêtir que quelques affiches déchirées où flottent les visages de Fayrouz et de Yasser Arafat, de Béchir Gemayel et de Che Guevara : je dois affronter ce monde en lambeaux, alors que c’est vers la lumière à travers le bouquet dense des arbres que j’aime me tourner, dans le monde friable et minuscule du sable et des trous d’eau que j’aime à me perdre.
Beyrouth, ville blessée, couronne d’épines, ceinture de figuiers de Barbarie, ville barbare, ville joyau, ville poubelle, ville qui s’est détruite dans l’euphorie et qui se reconstruit dans la hâte, aveugle et sourde et bruyante de tous ses haut-parleurs, ses juke-box jouant des mélodies de miel et de sirop, la voix enregistrée du muezzin appelant à la prière ou à la guerre sainte, comment savoir ?
Peut-être faudrait-il danser sur la destruction de Beyrouth, peut-être faudrait-il la chanter, comme celle de Sodome et de Gomorrhe, comme celle d’Ur. Comme celle de Troie, plusieurs fois détruite et reconstruite, mais finalement réduite à un apaisant enclos de ruines et de tombes vides.
Peut-être faudrait-il se réjouir de ce que les villes, nos constructions de béton et de verre, de pierre et d’acier, soient à la merci d’un bombardement ou d’un tremblement de terre, que leurs façades Renaissance se lézardent, que leurs palais baroques s’enfoncent lentement dans la vase, que leurs cathédrales soient percées comme des cœurs et restent debout, à moitié calcinées, presque plus belles ainsi avec leur pierre rongée et leur toit crevé qui laisse passer les nuages, entrer la pluie et les pigeons.
Mais alors, il vaudrait mieux sans doute que Beyrouth ne soit pas reconstruite, que ses toits restent ouverts sur le soleil dur et le vent salé, que ses murs conservent la trace de leurs blessures, les trous, les failles, les cratères pareils au dessin subtil d’une calligraphie à moitié oubliée, que dans les rues défoncées poussent buissons et arbustes, et que s’installe petit à petit tout un monde discret et sauvage d’épines, de lézards, de rats, de grenouilles et de fleurs des champs.
Beyrouth et toutes les villes où les hommes se sont battus d’un quartier à l’autre, où les marchés se sont vidés d’un coup, avec quelques tomates qui roulent sous le soleil de juin et une femme étendue à côté de son panier renversé, son foulard la protégeant de la chaleur de midi, où les immeubles construits à la va-vite dans les années 1960 se sont abattus comme de géants jeux de cartes, formant des empilements de béton armé, tombeaux pour des familles entières qui regardaient la télévision et mangeaient le repas du soir : il vaudrait mieux qu’on les laisse, ces villes, se recouvrir doucement d’oubli, avec leurs couches de poussière et de sang, leurs carcasses de voitures calcinées et tous les détritus et les débris qui s’entassent, strates pour les archéologues à venir.
Ainsi, on pourrait reconstruire une nouvelle ville un peu plus loin, respectant le périmètre sacré des ruines modernes devenues cimetière, jardin à l’abandon, paradis des chats et des vagabonds, avec quelques îlots encore habitables où s’installeraient les réfugiés descendus des montagnes ou venus du Sud avec leurs enfants qui vont nu-pieds jouer dans les fourrés et ramasser des mûres, les artistes en quête d’espace, les solitaires, les amants en fuite, quelques ornithologues et entomologistes à la recherche d’espèces endémiques. Pour le reste, la ville retrouverait le silence d’avant les autoroutes, les ponts, les tunnels, d’avant les banques, les boîtes de nuit et les aéroports ; elle serait seulement vrombissante d’insectes, caquetante d’oiseaux et bruissante du vent dans les arbres, tandis qu’à l’horizon, on verrait se dresser la ville nouvelle, irréelle et polie comme un jouet d’acier. Des groupes, depuis le reste du pays, viendraient visiter de temps en temps les ruines de l’ancienne capitale et se recueillir sur les tombes envahies de lierre et de chèvrefeuille. Certains se souviendraient de la ville d’avant-guerre, quand elle n’était que lumière et fête, belles femmes en fourrure, hommes aux cheveux gominés, vieillards jouant au trictrac aux terrasses des cafés, odeurs de jasmin et d’essence, vendeurs ambulants de sorbets et de pistaches grillées. Mais ils se souviendraient aussi de la guerre et de ses blessures encore fraîches que, doucement, tendrement, la végétation recouvrerait et cautériserait.
Ainsi, la ville reconnaîtrait et accepterait la destruction qu’elle s’est infligée à elle-même, à ses habitants, au tissu vivant de ses quartiers, des églises et des mosquées, des parcs et des cafés, des écoles et des hôpitaux, des maisons mauresques et du souk ottoman.
La ville regarderait ses propres vestiges et n’y verrait plus que les traces d’un passé proche et déjà rêvé, sa beauté éventée comme un vieux parfum : dans l’eau troublée du port où flotte la carcasse d’un bœuf entier, elle ne verrait que les taches iridescentes du pétrole et les milliers de méduses qui dansent au soleil, se nourrissant de tous les déchets de la ville, du pays, du monde, tandis qu’un dernier pêcheur attend patiemment que la nuit tombe pour retirer sa ligne, vide, et rentrer dans son noir logis, quelque part dans les méandres souterrains de la ville ruinée.
I. Beyrouth, 1978
Nous devions partir le lendemain pour Baalbek, une excursion pendant les vacances de Pâques – Pâques arrivait assez tôt, cette année-là, vers la mi-mars, et les montagnes étaient encore couvertes de neige (nous étions même allés faire du ski, comme beaucoup de bourgeois libanais, et la station, les pistes, les remonte-pentes avaient un air familier et inoffensif qui nous apaisait). Je me réjouissais de cette escapade hors de la ville, qui promettait de l’herbe verte à profusion et des brassées d’anémones, comme à Byblos. Nous avions fait de gros bouquets que nous avions posés dans le vaste appartement toujours froid : les fleurs rouges et blanches avec leur épais cœur de velours noir, plus qu’une simple décoration, étaient une incarnation du printemps, une promesse de vent et de lumière, un souvenir du souffle frais de Byblos et de nos courses à travers les ruines pleines d’herbes folles et de buissons.
Je crois que nous aimions toutes les trois les ruines, ouvertes et silencieuses, livre en partie indéchiffrable, palimpseste des civilisations qui se sont succédé et mêlées sur ce rivage. Elles nous rappelaient les aimables temples grecs, les théâtres antiques d’Ēgine et de Chypre, avec la paix des pierres roulées, rongées, ou vaillamment, par on ne sait quel miracle d’équilibre, encore debout, marquant l’espace sacré du lieu d’un culte depuis longtemps oublié. Se promener, errer, courir dans le site de Byblos, ce promontoire qui avance sur la mer, avec ses rares cyprès, ses éboulis de fleurs qui dégringolent vers les vagues, et l’horizon bleu pâle où passe un cargo fatigué, ramasser par brassées plus grosses que nous les anémones, c’était retrouver le bonheur du mouvement et de l’espace, que nous avions un peu oublié dans notre vie quadrillée, d’une urbanité déglinguée et rouillée. Cette miraculeuse floraison du printemps méditerranéen, si colorée, si variée, est d’autant plus intense qu’elle est précoce et courte : en mai déjà l’herbe de Byblos aura brûlé, et je m’y promènerai sur une terre caillouteuse et brune, avec les bouquets de lauriers-roses, qui eux défient la sécheresse, et la poussière, pour seuls compagnons.
Ce miracle du printemps grec et libanais, c’est celui des mythes et des chansons, c’est celui d’Adonis, dont on dit que les anémones pourpres sont le sang qui réapparaît chaque mois de mars dans le frais vallon qui porte son nom (et où poussent aussi des cyclamens, des petits lys blancs, des géraniums sauvages, des arnicas…) Ce sont les narcisses et les tulipes sauvages de l’Arcadie, Perséphone cueillant des jacinthes avec ses compagnes et enlevée par le jaloux dieu des Enfers – car sous la surface verdoyante de la terre se cachent les forces sombres et envieuses, le contre-pouvoir de la mort et de l’obscurité, le monde souterrain dont on a conscience quand on marche dans ces vallons résonnant d’eaux vives et qu’on se penche pour cueillir ces fleurs fragiles. Le sang et la guerre et le fracas des armes ne sont jamais loin, et c’est ce que nous allions découvrir à notre tour, innocentes brebis gambadant dans les vertes prairies, aveugles et sourdes et naïves, grisées par tout ce vert et le vent frais descendu des montagnes.
La ville, coupée par la ligne de démarcation, pleine de trous, de cratères, occupée par les différentes milices qui régnaient sur des quartiers, des carrefours, des routes, bloquant les accès, étouffant la circulation vitale des hommes et des biens, était un réseau difficile à appréhender dans lequel nous nous déplacions avec prudence, selon des trajectoires que je ne comprenais pas, mais qui nous menaient par des chemins détournés de notre appartement à l’école (d’après ma géographie reconstituée, notre logement comme le Collège protestant français se trouvaient à Beyrouth Ouest, ce qui nous évitait de traverser la dangereuse ligne de la rue de Damas mais ne nous empêchait pas de frôler d’inquiétantes zones, floues et mortelles). Il y avait aussi des friches, des jardins plus ou moins sauvages (qui se mélangent dans mon souvenir avec les jardins abandonnés d’Achrafieh, les oliviers, les orangers chargés de petits fruits amers que personne ne ramasse). Beyrouth était une ville trouée qui laissait passer beaucoup d’air, et les terrains vagues où poussent la rose trémière, le mimosa et la capucine étaient un espace où nous allions jouer avec les enfants du quartier et un lieu propice aux promenades botaniques. Le vent qui secouait les stores de notre appartement me tenait éveillée et apportait la fraîcheur des montagnes et l’odeur de la mer, par-dessus les fumées des pots d’échappement et le vacarme des rues – klaxons, sirènes des ambulances ou des alertes, haut-parleurs appelant à on ne sait quelle manifestation. Le printemps se glissait dans les nombreux interstices de la ville, et je me délectais des fleurs et des buissons, des grappes mauves du jacaranda et des explosions du flamboyant, rouge vif contre l’écorce gris pâle, plus exotiques, plus inquiétantes que les anémones, les minuscules cyclamens se dressant hors de leur feuillage d’un vert presque bleu. De nos promenades avec mon père j’avais pris le goût de l’observation (il collait dans des cahiers les arnicas et les coquelicots ramassés sur le bord des routes à Égine ou à Limassol, inscrivant soigneusement leur nom, savant et populaire, de son écriture fine et déliée, précise, très lisible). Le plaisir vagabond des textures, des couleurs, des odeurs, qui me plaçait dans le rythme d’une saison, dans un paysage, même fragmenté, était une consolation dans nos vies bousculées, un lien avec les talus familiers et les chemins de notre pays, avec les jardins de Chypre plantés de géraniums au parfum de citronnelle, avec un autre doux printemps pascal, sur l’île d’Égine, que nous avions en grande partie passé à courir dans les champs sous le parfait petit temple d’Aphaïa.
J’étais sensible, à douze ans, au passage des saisons, aux nuances des feuilles, aux odeurs de terre, d’herbe, de chèvrefeuille, au parfum âcre du lierre et du buis de notre jardin savoyard. Nous venions d’une petite campagne, entourée de routes et de stations-service, mais close comme un antre moussu plein de limaces et d’escargots, une caverne qui nous protégeait et nous enchantait – le reste du monde pouvait vrombir, se couvrir d’asphalte et de ciment, de lotissements aux villas posées comme des cubes avec leur façade identique et leur haie de thuyas, nous, nous jouions dans les bois et mangions des fraises, des merises noires qui éclataient sous la dent, des framboises, des poires vertes…
Ce que Beyrouth offrait, c’était des enclos presque sauvages où grimpait le chèvrefeuille, au-dessous d’un entrelacs de fils électriques, derrière des clôtures poreuses, avec, en toile de fond, des immeubles blafards vérolés par les impacts de balles. Il y avait aussi le jardin bien entretenu du Collège protestant français, planté d’eucalyptus et de flamboyants, de pins et d’oliviers. Mais je n’ai que des souvenirs morcelés et imprécis de Beyrouth : malgré la lumière du printemps, j’entrevois des silhouettes dans une pénombre presque constante (due sans doute aux fréquentes coupures d’électricité, au couvre-feu, à la menace de cette nuit imposée que nous sentions jusque dans le grand appartement de marbre clair). J’entends des murmures, des conversations lointaines au téléphone à l’autre bout de l’appartement. Je nous vois nous aussi en silhouettes, un peu perdues dans l’espace trop vaste et vide du dedans, et dans l’espace fragmenté du dehors. J’aperçois les visages de quelques collègues de mon père, celui de Florette qui s’occupait de notre ménage, et sa douce voix de prophétesse apeurée nous disant – « On va tous pour mourir à Beyrouth avec les bombes » – avec son accent de l’île Maurice ou de la Réunion, une fleur tropicale délicate qui ne pourrait endurer longtemps le dur printemps libanais, avec ses ombres sous les yeux, ses longues mains qui préparaient le petit déjeuner et balayaient le sol de marbre. Les enfants des voisins jouaient avec nous dans le terrain vague et le gros petit garçon collectionnait les douilles de tous les calibres, qu’il nous montrait fièrement, alignées sur une étagère. Ces enfants passaient plus de temps que nous à l’intérieur, comme les enfants chypriotes, couvés et trop nourris. Ma sœur et moi, nous étions de petites chèvres, gambadant dans les décombres, et nous n’avions pas grand-chose à montrer dans nos chambres vides. Les enfants nous avaient appris à écrire notre nom et à compter en arabe.
Je me souviens aussi d’avoir passé des heures à regarder des images de guerre dans les numéros de Paris Match qui s’entassaient à la bibliothèque de l’Alliance française, des images noir et vert sombre dont je me grisais avec un plaisir nauséeux (j’apprenais la guerre, je la découvrais à travers ces images des désastres mondiaux, indirectement, comme Persée se protège du regard pétrifiant de Méduse par le bouclier de bronze poli que lui tend Athéna). J’en étais dégoûtée comme de manger trop de chocolat, mais j’y revenais, à mes heures perdues, qui semblent avoir été nombreuses – il y a dû avoir pas mal de jours sans école pour cause de zones trop dangereuses à traverser ou d’alertes. Pendant ce temps, notre mère dessinait la silhouette déchiquetée de la ville, ses immeubles presque transparents devant un ciel d’orage, transfigurés par des ors et des bleus célestes, les ruines modernes devenues aussi légères que des décors de théâtre vénitien.
Beyrouth était une ville criarde, une ville qui essayait peut-être de nous dire quelque chose, qui appelait au secours, qui se débattait, en proie aux forces contradictoires de la fête et de la destruction, de la légèreté et de la haine, de la nostalgie et de la frénésie. Elle avait gardé, comme tout le pays, des restes de beauté et de frivolité, des restaurants, des cafés, des palmiers, des plages encore vides à cette saison. On aurait pu se croire en visite, presque en vacances, et l’école même était une école de passage, seulement pour quelques mois, une école ouverte qui contrastait avec le pensionnat suisse, une école pour apprendre un peu d’arabe, une école pour entendre des histoires de cours donnés sous les bombes par de vaillantes femmes qui avaient conservé leur gaieté, une école dont l’enseignement œcuménique, je le devinais, était une forme de résistance héroïque à ce qui déjà avait détruit le tissu vivant de la ville et du pays.
C’était une parenthèse dans notre vie, une nouvelle excentricité de nos parents, qui n’avaient jamais hésité à nous emmener avec eux, à nous faire changer d’école en cours d’année ou à prolonger les vacances selon leur caprice. Après Chypre et les mois idylliques passés ensemble à Limassol, le Liban ne semblait pas une mauvaise idée : accompagner notre père, Louis, dans sa nouvelle mission pour le Comité international de la Croix-Rouge était en réalité la condition imposée par notre mère. C’est pourquoi nous nous retrouvions à Beyrouth, en ces premiers mois de l’année 1978, tandis que notre père travaillait au sud, à Tyr. Notre mère allait acheter des cigarettes aux Palestiniens des camps voisins et se promenait sur la Corniche, d’après le souvenir précis qu’en a ma sœur, avec un abat-jour sur la tête. Pour protéger son visage des regards noirs des vendeurs de pistaches et du soleil, ajoutant sa touche burlesque et absurde au carnaval funèbre qu’était Beyrouth.
Les ruines de Byblos, celles de Tyr où nous sommes allées une ou deux fois rendre visite à notre père, étaient gracieuses, légères, ne pesant d’aucun poids sur nos épaules et dans nos esprits – nous ne connaissions même pas la curiosité un peu angoissée des archéologues amateurs et des touristes avec leurs plans et leurs guides : pour nous, ces ruines étaient de vastes champs de course et de jeux, sur lesquels roulait un ciel plein de nuages et de vent et de menace de pluie et d’embruns. Alors que Beyrouth était une ville sombre et labyrinthique, parcourue de failles qui pouvaient à tout moment nous engloutir, à Tyr, nous marchions sur la plage au sable noir, à la recherche de fragments de mosaïque et de verre poli que nous mettions ensuite dans des bocaux, tandis que flottait sur le Resthouse, ancien hôtel transformé en bunker, un immense drapeau de la Croix-Rouge, et que volaient bas les avions israéliens. Nous courions parmi les ruines de l’hippodrome à l’herbe drue, ravies de tout cet espace, dans le vent de mars qui jouait avec nos cheveux.
Levées de bon matin – c’était encore une journée de vacances – nous étions prêtes à partir pour une nouvelle excursion dans les ruines, promesse de pierres silencieuses et bienveillantes et de nouveaux espaces à explorer ; quelqu’un a sonné à la porte, nous avons entendu un bruit de voix assourdies, puis les lamentations de notre mère. J’ai tout de suite compris que nous n’irions pas à Baalbek, j’ai pensé que la déception de ma mère était encore plus grande que la mienne, et que c’était pour ça qu’elle pleurait. Car j’en aurais pleuré, moi, de ne pas aller à Baalbek, je me réjouissais tellement de cette échappée vers un air plus vif, comme si cette sortie hors de la ville et de ses contraintes avait été notre seule chance de survie. Pourtant, je ne me souviens pas d’avoir pleuré ni d’avoir parlé, comme si après cette conversation entre le gentil délégué devenu messager de malheur et notre mère, était tombé sur nous un lourd, épais silence.
Notre mère nous a mises toutes les deux dans une chambre sombre, alors que le matin nous appelait au-dehors, ce jeudi 30 mars 1978, allongées sur les lits comme des malades ; elle nous a donné à chacune une aspirine. Le même jour, ou peut-être le lendemain, j’ai trouvé la cuvette des toilettes rouge de sang – il me semble n’en avoir parlé à personne, mais c’est en réalité ma sœur, plus jeune et pourtant plus avertie, qui m’a expliqué ce qui m’arrivait et qui m’a rassurée. À ma mère, je ne pouvais rien dire, car elle était perdue dans sa douleur, et nous n’avons ensuite jamais reparlé de ce sang, ni du reste d’aucun autre sang que celui versé par notre père dans la poussière de Tyr (et notre mère nous a avoué plus tard qu’elle avait gardé sa chemise tachée de sang, enfermée dans un coffret comme une relique – mais moi, je n’ai jamais vu cette chemise, dont les taches seraient devenues brunes avec les années, dont le tissu aurait jauni, se serait raidi et finalement se serait défait sous nos doigts comme la peau abandonnée d’un serpent depuis longtemps disparu sous les pierres chaudes). J’ai tout de suite compris que la douleur de notre mère, devenue tout à coup veuve, nimbée d’un noir qui ne la quitterait plus, était unique, et que nous ne pourrions jamais nous en approcher, comme elle ne pourrait pas approcher le mystère de mon propre corps qui se transformait (ou plutôt, qu’elle ne voudrait jamais en entendre parler, comme d’un secret tacite et honteux, d’une innommable initiation que je devais subir seule). Elle non plus ne pourrait pas saisir notre peine. Ou peut-être le pouvait-elle, si elle avait eu assez de force, puisqu’elle avait perdu son père quelques années auparavant, et que son chagrin, déjà, avait débordé, l’emportant dans sa crue, la déstabilisant et introduisant, à notre insu, le ver du malheur dans notre petit fruit rond et mûr. Mais dans la révélation soudaine de la catastrophe, nous ne savions pas encore combien le chagrin allait occuper notre territoire, ni à quel point il resterait entre nous comme une pierre, inamovible et infranchissable.
Nous sommes reparties le jour suivant, sans avoir vu Baalbek, sans avoir le temps de dire adieu aux quelques amis et connaissances, et sans jamais revoir notre père ; je crois que notre mère a pleuré sur son corps et sa tête blessée, mais nous les enfants, nous n’avons jamais pu lui dire adieu, ni au Liban ni plus tard en Suisse quand on l’a enterré : nous avons été écartées des rites et des cérémonies, et le silence a continué, s’est alourdi, sans doute pour nous protéger, mais de quoi puisque le malheur était déjà définitivement et radicalement arrivé ? Le soir même où j’ai appris la mort de mon père, étendue sur mon lit dans le bruit perpétuel du vent, je me persuadais que j’allais me réveiller de ce mauvais rêve, et que je le verrai, devant moi, souriant, un peu ébouriffé, ayant couru pour nous rejoindre, sentant le tabac et la sueur, comme il y avait quelques jours je l’avais vu à Tyr, quand nous nous promenions, penchés sur la sable à la recherche de monnaies antiques. J’ai très longtemps attendu son retour, non pas comme un Christ ressuscité et transfiguré mais plutôt comme un clown farceur qui a joué un bon tour à tout le monde et qui revient, rieur, les bras chargés de cadeaux pour nous consoler de nous avoir fait si peur.
Alors nous avons quitté Beyrouth, l’école, les flamboyants et les mimosas, laissé Florette dans le grand appartement vide, les guinguettes au bord de la mer où mes parents allaient boire un verre devant l’eau moirée où rouillaient les paquebots et où flottait la carcasse gonflée d’un bœuf. Nous avons laissé derrière nous les ruines de Byblos et de Tyr, les bouquets ronds d’anémones, et les collègues de Louis sous le choc de sa mort, qui resteront pris dans la tourmente qui balayait le pays. Derrière nous, Beyrouth et le Liban tout entier implosaient, mais nous n’avons pas tourné la tête pour regarder les explosions rouges et bleues et vertes du feu d’artifice, nous n’avons senti que le souffle mortel de la déflagration. Nous sommes retournées dans notre petit pays lacustre, paisible et frais en ce début de printemps, nous avons retrouvé la famille en larmes, et nous avons joué au poisson d’avril avec nos cousins, courant dans l’herbe acide.
Je ne suis toujours pas allée à Baalbek, comme si quelque chose me retenait loin de ce lieu.