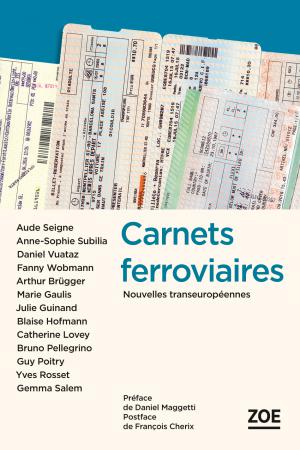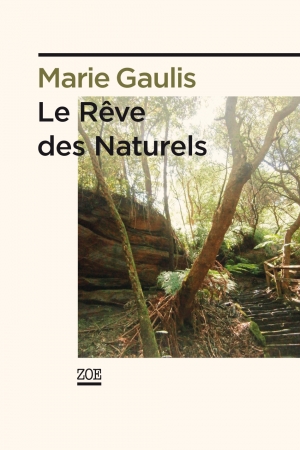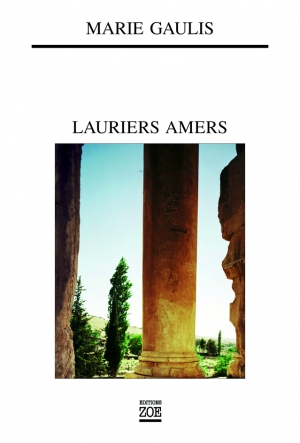parution janvier 2016
ISBN 978-2-88927-297-6
nb de pages 128
format du livre 140 x 210 mm
Le Royaume des oiseaux
résumé
En faisant parler Max le patriarche débonnaire et Mary sa femme américaine, puis Joson le grand-père voyageur et Dora la bien-aimée grand-mère, Marie Gaulis raconte le lieu aimé de l’enfance, une terre savoyarde à la fois réelle et rêvée. Dans le château familial, la peinture s’écaille, les canalisations gèlent, les cheminées fument, les guerres passent. Tandis que les aïeux, désormais âmes légères comme des oiseaux, se confient, honnêtes, la narratrice se souvient, réfléchit et se console. Dans Le Royaume des oiseaux, Marie Gaulis saisit la place que prennent parfois malgré nous les légendes et les rituels ancestraux et les confronte à la nature si sensuelle et à la vie d’aujourd’hui.
Laudatio pour le prix des Charmettes 2016 :
« Le Royaume des oiseaux de Marie Gaulis ne se raconte pas. Il se vit, écrit Sabine Faulmeyer sur le site littérature-romande.net. Elle a raison. A travers l’évocation d’un lieu bien précis et au gré de ce que lui en livrent les différents personnages de ce roman, ce sont autant d’horizons spatio-temporels et socio-culturels qui s’ouvrent au lecteur. Or c’est de l’au-delà que proviennent les voix des personnages. Ainsi suspendues hors de temps, elles livrent leurs considérations, leurs sentiments ou autres impressions que leur inspire la vie menée dans ce château savoyard, épicentre du livre. Par la qualité de son style, par la richesse de son vocabulaire, par le rythme de son phrasé, Marie Gaulis invite son lecteur à la suivre dans cet univers dont la géométrie varie selon celle de tous les autres qui s’y côtoient, s’y rencontrent sinon s’y confrontent. »
Hélène Richard-Favre
Ecrivain, membre du jury du Prix des Charmettes-J.-J. Rousseau
Spécialiste de la Grèce moderne, traductrice de Karaghiozis, Marie Gaulis (1965-2019) est l'auteure de plusieurs romans. Son écriture est ample et précise, souvent empreinte de mélancolie mais aussi d’audace.
lauréat du prix des Charmettes
« Le Royaume des oiseaux de Marie Gaulis ne se raconte pas. Il se vit, écrit Sabine Faulmeyer sur le site littérature-romande.net. Elle a raison. A travers l’évocation d’un lieu bien précis et au gré de ce que lui en livrent les différents personnages de ce roman, ce sont autant d’horizons spatio-temporels et socio-culturels qui s’ouvrent au lecteur. Or c’est de l’au-delà que proviennent les voix des personnages. Ainsi suspendues hors de temps, elles livrent leurs considérations, leurs sentiments ou autres impressions que leur inspire la vie menée dans ce château savoyard, épicentre du livre. Par la qualité de son style, par la richesse de son vocabulaire, par le rythme de son phrasé, Marie Gaulis invite son lecteur à la suivre dans cet univers dont la géométrie varie selon celle de tous les autres qui s’y côtoient, s’y rencontrent sinon s’y confrontent. »
Hélène Richard-Favre
Ecrivain, membre du jury du Prix des Charmettes-J.-J. Rousseau
Le Chênois
"...Le style de Marie Gaulis est éblouissant." Lilianne Roussy
La Gruyère
"... on savoure la douceur veloutée d'une écriture parfaite..." Eric Bulliard
Marie Claire Suisse
"(...) Marie Gaulis, avec son raffinement coutumier, signe un petit bijou de subtilité, de poésie et d'humour triste!"
Le Temps
«La Cerisaie» en Savoie
Marie Gaulis signe une envoûtante chronique familiale
Pour qui aime observer la mousse qui envahit les vieilles demeures et les rêves qui s’émoussent au contact du monde, Le Royaume des oiseaux de Marie Gaulis est une lecture qui inspire. Fortement tchekhovien, le récit raconte un château, posé dans une cuvette de verdure en Savoie, et les générations qui y ont vécu. La demeure existe et ses habitants étaient les aïeux de l’auteure. Le château, impossible à entretenir, trop lourd de vies, de larmes, de tout, a été vendu par la génération des parents. A l’image de La Cerisaie de Tchekhov, le château est aussi ici la matérialisation d’un monde disparu.
Veuf et caractériel
Le charme envoûtant du «Royaume des oiseaux» tient d’abord aux voix, celles des fantômes en premier lieu: ce sont eux qui racontent ici. Devenue bientôt brume et rosée, dotée des «yeux aveugles des spectres», c’est Marie, l’aïeule américaine, qui commence le récit. Formidable Marie, tombée dans cette famille de comtes de Savoie, par la volonté de son père, mort trop vite. Lucide, Marie sait que Maximilien, son mari veuf et caractériel, l’a épousée pour qu’elle s’occupe de son fils et pour sa dot, aussi. Elle sera énergie et volonté, dans une famille empêchée face au réel, accablée par le concret, déconnectée en somme. Marie va installer une salle de bain moderne, construire une chapelle. A cette aïeule comme aux autres personnages qui suivront, Marie Gaulis répond, sous forme de notes en italiques, contre-point d’aujourd’hui. On apprend ainsi que la chapelle demeure encore, à l’abandon sur sa parcelle. Maximilien le velléitaire prend ensuite la parole, lui qui aimait tant les bains.
En fine portraitiste, Marie Gaulis sait doser les ombres et la lumière de chacun. Suivront, dans le vaste tourbillon vers la fin, les vies des grands-parents, entre derniers fastes et pièces glacées. L’écriture de Marie Gaulis emporte par un art précis du rythme, parvenant à rendre l'entêtante mélodie des humains en lutte, entre joies et déceptions, contre la décrépitude. Pas de nostalgie dans ces pages. La vente du château, douloureuse, permet surtout un allègement, un vaste appel à un nouveau printemps. Si les vies se sont évaporées, demeurent «la précieuse eau des fontaines» et «la permanence sans cesse rafraîchie» des arbres.
Lisbeth Koutchoumoff
4 étoiles
le dauphiné libéré
"... Ces pages ont la saveur délicates et le charme désuet des mondes inexorablement disparus, mais portent un regard lucide sur leur mode de vie (...).
Cette chronique familiale lucide et touchante, écrite avec talent, plonge le lecteur dans l'intimité d'une famille de hobereau savoyard, dont la vente du domaine semblait avoir scellé le destin à tout jamais.
Marie Gaulis a su rendre attachants ses ancêtres en s'interrogeant sur cet 'essouflement' manifesté par 'l'incapacité à faire face au monde qui changeait, par la peur masquée sous la nonchalance, de tout changement'. (...)" J.T.
Marie Gaulis sur Espace 2
Marie Gaulis était l'invitée de Entre les lignes sur Espace 2 le 19 janvier pour parler de "Le Royaume des oiseaux".
dans Le Canard Enchaîné
(...) Comment se déprendre [d'une] demeure au charme puissant, comment congédier en douceur le passé et garder l'élan de l'enfance : c'est ce que raconte avec grâce et sérénité Marie Gaulis. Une plume légère poure des choses graves... Des adieux pleins d'allégresse: "Je n'ai plus besoin des murs ni des toits pour me sentir à l'abri."
Les châteaux ne meurent jamais. (F.P.)
Marie Gaulis n’a pas son pareil pour faire parler ses ancêtres, qui ne sont plus que des fantômes chers à son cœur. De sa plume élégante, elle met à nu avec une grande délicatesse et parfois même une touche d’humour, les motivations profondes de ses aïeux et autant dire leur essence même. Le château savoyard familial, personnage à part entière, fonctionne comme une formidable machine à remonter le temps et le lecteur recueille avec bonheur les confessions de ces âmes qui se livrent sans filtres. Grâce à ces belles pages l’éternité leur appartient.
Carine Bastié
Gros coup de coeur des libraires et du public samedi 23 janvier chez Payot rive gauche pour le Royaume des oiseaux de Marie Gaulis !
Le Royaume des oiseaux (2022)
En quatre portraits, Marie Gaulis esquisse le destin de deux couples qui se succèdent dans un vieux château savoyard, aussi superbe que décati, aussi coûteux qu’empreint d’une grâce surannée. Sur un siècle, elle raconte, fine et douce observatrice, la fin d’un mode de vie et l’acceptation réjouie d’une renaissance dans un monde contemporain, plus compliqué, mais plus vivant.
Que ce soit de Lausanne à Paris, de Vienne à Genève ou de Glasgow à Londres, chacun des treize auteurs de ce recueil situe son histoire à bord d’un train qui parcourt l’Europe. À l’occasion d’un long trajet en chemin de fer, l’une se souvient de son voyage dix ans plus tôt, elle traque la différence entre son être d’hier et d’aujourd’hui. Un autre se remémore la géniale arnaque dont il a été l’auteur, un troisième retrace l’incroyable hold-up ferroviaire du South West Gang dans l’Angleterre de 1963.
Ces nouvelles donnent une vue d’ensemble inédite sur la manière de concevoir l’Europe comme espace physique et symbolique. Les auteurs étant de générations très diverses, le lecteur appréciera les différentes manières d’appréhender notre monde proche et de s’y situer.
Nouvelles de Aude Seigne, Blaise Hofmann, Anne-Sophie Subilia, Gemma Salem, Bruno Pellegrino, Arthur Brügger, Daniel Vuataz, Marie Gaulis, Fanny Wobmann, Catherine Lovey, Julie Guinand, Guy Poitry, Yves Rosset.
Préface de Daniel Maggetti, postface de François Cherix
Le Rêve des Naturels (2012)
Après la belle enquête sur la mort de son père au Liban, sur le fil entre fiction et reportage (Lauriers amers, Zoé 2010), Marie Gaulis nous livre un nouveau texte au statut troublant. Rêverie, méditation, réflexion ou fiction, il s’agit en tout cas de l’exposé d’une tristesse anthropologique, du constat d’un paradis perdu, du rêve d’un état encore sauvage. Rousseau n’est pas loin, mais la narratrice est bien une femme du XXIe siècle, lucide, curieuse et joueuse, vivant dans le monde hybride d’aujourd’hui. A travers marches, rencontres et lectures, elle évoque les Aborigènes d’Australie, ces Naturels dont le mode de vie millénaire a basculé au moment de leur rencontre avec les Européens.
Attentive à tout, au paysage qui l’entoure, à la brutalité de la nature comme à l’agitation de la ville, aux pulsations de son corps comme aux échappées de son imagination, la narratrice développe un état de réceptivité qui se creuse et s’affine, permettant à la fois d’exprimer ses propres rêves d’une sauvagerie perdue et d’accepter l’imperfection du monde dans lequel elle vit.
Marie Gaulis vit à la Chaux-de-Fonds et à Sydney. Ecrivain, elle a publié plusieurs recueils de prose et de poèmes (Editions de l’Aire et Métropolis). Traductrice, elle a adapté Karaghiozis et le château des fantômes, théâtre d’ombres grec, pour Les Classiques du Monde (Zoé). Le Rêve des Naturels est son deuxième livre chez Zoé après Lauriers amers.
Lauriers amers (2009)
Ce récit est une quête et une enquête, un retour personnel et historique sur le passé. Marie Gaulis est née en 1965 d’une mère française et d’un père genevois. Son père, Louis Gaulis, écrivain, est mort en 1978 à Tyr, au Liban, lors d’une mission qu’il effectuait pour le Comité international de la Croix-Rouge, dans des circonstances qui n’ont jamais été élucidées.
Qui, sur l’ordre de qui, a tiré sur la voiture du CICR au crépuscule alors que Louis Gaulis rejoignait sa base ? Trente ans après, Marie Gaulis est retournée au Liban, s’est rendue sur le lieu exact de l’accident, a cherché minutieusement des témoins, les a interrogés. Non pas pour construire un tombeau à son père, mais pour le retrouver au-delà des communiqués officiels et des rapports d’experts. Et pour renouer les liens avec une histoire, un pays et une décennie qui continuent de peser sur le présent. Sans oublier que morts et vivants cohabitent dans les ruines de Tyr, entre les bouquets de lauriers-roses.
Le Royaume des oiseaux: extrait
Chapitre 1
La chapelle
(…)
Mais je devais tenir bon au milieu d’une vie réglée par d’immuables rituels qui me paraissaient arbitraires et, à l’intérieur de ce cadre, s’écoulant sans véritable but. Je me suis vite rendu compte que l’étrange suspension du temps qui régnait au château m’absorberait si je me laissais aller, comme tout le monde finissait par le faire, mari, cuisinière, jardinier, puis les enfants eux-mêmes, indisciplinés et indolents, impatients, avec quelque chose, au fond, que je n’arrivais pas à comprendre, une sorte de résistance passive et obstinée, que Max considérait comme une inaptitude familiale : « Nous ne sommes pas faits pour ce monde avide », me disait-il souvent, quand les factures, que je payais, continuaient de s’accumuler ou que les tuyaux éclataient sous le gel ou qu’un désaccord l’opposait au maire, au notaire, au médecin (qu’il ne fréquentait pas, mais c’était pour la rougeole ou la varicelle d’un des enfants). Il regimbait quand le monde ne le laissait pas vaquer à ses inoffensives occupations.
Je savais qu’il m’avait épousée pour sortir de son veuvage – il avait perdu sa première femme Jeanne, morte à dix neuf ans en mettant au monde un fils – par amitié pour mon père et pour ma dot. L’argent que j’apportais allait permettre au château de ne pas s’écrouler et à la famille de recevoir, de danser et de manger, dévorant avec une insouciance que je m’efforçais de ne pas trouver cynique ce que j’avais hérité de mon père. Je le savais et je ne lui en voulais pas : n’étais-je pas après tout exactement cela, une jeune fille aisée et de bonne famille, Américaine élevée en France, en apparence parfaitement adaptée à la situation — mais en réalité, déplacée et déracinée, ce que j’ai bien gardé de montrer à quiconque, détestant les longs hivers humides des bords du lac et m’ennuyant en compagnie des amis de mon époux, leur solide appétit paysan, leur goût pour la chasse et la politique, leurs discussions émaillées de patois qui m’étaient tout à fait hermétiques.
Mais je conservais ma fierté et mes chagrins par devers moi. J’étais censé être une naïve roturière américaine, comme dans les romans de Henry James. Max aimait à se moquer de mes origines « yankees », comme il disait, de « cette fausse démocratie créée par les puritains, qui est en réalité le culte de l’argent, permis et même encouragé par le protestantisme », faisant semblant d’oublier que j’étais catholique, comme ma mère, que les Read furent des hommes politiques actifs, juges, sénateurs, d’une lignée d’Anglo-Irlandais courageux et méritants et que mon argent venait de leur travail. «Pas comme vos nobliaux inactifs, ceux qui ont échappé à la guillotine », lui répondais-je avec une certaine méchanceté. Il sortait furieux de la pièce, ne supportant pas que j’aie des opinions politiques, accusant d’ailleurs les Américains d’avoir préparé la Révolution française et d’avoir ruiné Louis XVI en lui demandant, par l’intermédiaire de l’habile Benjamin Franklin, une aide considérable en espèces et en armes. Max n’aimait en réalité ni la révolution ni la république, mais il ne prônait pas non plus un retour à la monarchie. Il regrettait l’annexion forcée de la Savoie à la France, la grandeur passée du Royaume du Piémont ; il ne se sentait pas plus proche des Suisses et encore moins des Genevois, dont il moquait le goût du travail et de l’argent et qu’il appelait les « pique meûrons ». Dans cet isolement de principe, il ne pouvait que rêver à un passé glorieux et attendre la déchéance, tandis que mon dynamique lignage américain devait lui apparaître comme une fantaisie, une sorte d’utopie dont il se tenait éloigné, par méfiance.
Mon père même, qu’il avait bien connu, John Meredith Read, qui fut général et consul des Etats-Unis en Grèce et en France, qui reçut un brevet de la ville de Paris pour avoir soutenu le siège de la Commune, a dû lui sembler très loin de lui, malgré leur estime réciproque. Je n’ai d’ailleurs aucun souvenir de conversations communes. Tout au plus ont-ils pu évoquer la chasse, que mon père pratiquait un peu, ou l’histoire locale, à laquelle ils s’intéressaient tous deux. Mais on ne pouvait parler de rien, avec mon époux, toute conversation sérieuse débouchait sur des malentendus, et sa susceptibilité les transformait en disputes.
*
J’ai toujours entendu mon oncle, ma grand-mère dans une certaine mesure, tenir un discours non pas nationaliste, puisqu’ils étaient opposés à l’idée de nation, qu’elle fût d’ailleurs française ou italienne, mais régionaliste. Mon oncle avait été actif dans le Mouvement Région Savoie, il en avait même été je crois l’un des fondateurs, mouvement qui avait connu son heure de gloire relative dans les années 1970. Mon oncle assurait que la Savoie, qui aurait d’ailleurs dû être une grande entité et pas deux départements, était plus proche de régions alpines comme le Piémont, le Valais, voire le canton de Vaud (dont il louait le goût du petit blanc et la bonhomie roublarde) que des centres urbains français ou suisses. A l’étroit entre le lac et les montagnes, entre la Suisse et la France, la Savoie historique n’était plus qu’une région périphérique, dépendant de l’administration centralisée française et de la richesse nouvelle produite par les stations de ski comme par les « frontaliers ».
On ne vivait plus dans la Savoie libre et glorieuse depuis longtemps, et si tous les mâles de la famille ont été nommés chevaliers de l’ordre des saints Maurice et Lazare, c’était un titre honorifique reçu sans doute en reconnaissance du seul fait d’exister encore et de contribuer à la préservation de leur espèce, dans une enclave qui était en train de perdre sa signification spirituelle et historique. Pourtant, le lien gardé avec la Maison de Savoie et avec un ancien ordre hospitalier de Terre sainte, je le trouve intéressant et même honorable, c’est une partie de l’histoire de cette lignée qui n’est pas honteuse, mais qui reste seulement suspendue dans un étrange anachronisme.
*
« Mais, continuait Max si la discussion n’avait pas encore dégénéré en dispute, vous, vous les Américains, vous avez massacré les Indiens et maintenu en esclavage toute une partie de votre population ». C’était vrai, mais je n’avais jamais ressenti de remords ni même de mauvaise conscience car ma famille était depuis longtemps sortie de ces âges obscurs. Nous nous faisions face, alors, pâles tous les deux de ce combat mené à l’abri des regards, le soir au petit salon quand dormait la maisonnée. Il n’y avait pourtant ni perdant ni gagnant, aucun peuple n’était exempt de crimes. « Et vous, terrés dans votre château, vous croyez échapper à l’histoire, mais elle est là, elle vous cerne, elle attend son heure. » « Quelle heure ? Bon Dieu, nous avons déjà donné ce pauvre Rodolphe à la France, cette patrie ingrate. » Le beau Rodolphe, si jeune dans son uniforme, mort en 1914, au tout début de la guerre, et enterré avec nous désormais, un des seuls je crois dont le nom est inscrit sur une plaque. « Oui, pauvre Rodolphe, et sa toute jeune épouse, devenue veuve, encore une, et tous les Américains, lui disais-je, les Canadiens, les Néo-Zélandais et les Australiens, les Algériens et les Sénégalais, et même de braves citoyens suisses, morts pour rien, dans les tranchées visqueuses de boue et de sang ? C’est absurde – je me redressais – il n’y a pas de gloire, à la fin, pour personne, et moi je vous parle de citoyens qui ont essayé de construire un pays, comme les Read. » « Oui, oui, je sais, et nous, conseillers des ducs de Savoie et des rois d’Italie, mon propre père, Amédée, grand chambellan à la cour du roi Ferdinand de Bulgarie… »
J’avais peu connu mon beau-père, Amédée, mais je savais qu’il avait été un homme actif, bienveillant, fondateur de l’Académie chablaisienne, musicien, lettré, bienfaiteur. Il avait écrit d’innombrables polkas adressées à des dames de la région, et laissé quelque part un harmonium et la chaise haute qui l’accompagnait. Peut-être le premier et le dernier de sa lignée qui ait joué son rôle avec générosité. De mon beau-père je conservais un bon souvenir, bel homme affable, cultivé, qui avait accompli une tâche immense, celle de recenser toutes les familles de Savoie dans ce qu’il a appelé l’Armorial, des années entières de sa vie passées à consulter des archives, des grimoires, des lettres. Pendant ce temps, il ne vivait pas vraiment, sa femme se morfondait, ses enfants ne le voyaient pas et sa belle moustache pendait tristement comme les fanes d’un navet. « Oui, un navet ! » Et je sortais, toute droite, me retenant de claquer la porte, privilège qui était réservé à mon époux.
Car toutes les manifestations de colère lui étaient permises, et il les exploitait toutes, parfois en une seule journée, des colères au début qui me faisaient si peur que je courais m’enfermer dans ma chambre, attendant que le bruit des chiens, dehors, et des pas sur le gravier m’annoncent le départ de mon fulminant époux. C’est alors que m’est venu le goût de la prière, pour patienter, pour apaiser mes nerfs, pour adresser à quelqu’un mes doléances.
*
La chapelle que j’ai faite construire est toujours là, perchée sur son talus, avec ses pierres grises et bleues, son petit clocher ouvert où est suspendue une cloche que je n’entends plus. Il y a eu encore des mariages et des baptêmes, l’enterrement d’Etienne, le fils de Max et de Jeanne, celui de mon fils Joson et de ma bru Théodora, tous les deux réunis, comme Max et moi, sous les murs de la chapelle, mais en fait, séparés, flottant eux aussi dans les nuées, devenus oiseaux peut-être, ou nuages ou vent. Unis dans l’oubli plutôt que dans la foi, entre la légende et le mythe, la croyance qu’on veut nous inculquer, depuis l’enfance, en la vie éternelle et l’immortalité de l’amour.
Malgré mon désir de croire, je n’ai retrouvé aucun de ceux que j’aimais, partis avant ou après moi, même dans la promiscuité de la chapelle, os dormants et pourrissants côte à côte, ce qui faisait notre personne, envolé, et c’est peut-être une consolation, après tout, que de se découvrir si légers : ce sont les vivants qui imaginent le poids des morts, leur permanence, leurs exigences même, mais si nous pouvions leur dire que plus rien n’a d’importance et qu’ils doivent vivre sans béquille, sans attelle, sans le joug du devoir, ils se redresseraient et vivraient enfin, respirant, jouissant, comme nous ne l’avons pas fait, toujours inquiétés par le passé et bercés par une fallacieuse promesse d’immortalité.
Je suis heureuse pourtant d’avoir bâti la chapelle, témoignage de mon affection et de ma fidélité, refuge pour les promeneurs, peut-être maintenant seulement pour les abeilles et les chats qui se glissent sous les barrières. Construite sur une butte surplombant le château, à l’écart des routes (mais les routes se rapprochent, il reste de moins en moins d’espace pour les oiseaux et les insectes), solitaire, modeste, trapue. Moi qui n’étais pas de ce pays et qui suis restée toute ma vie loin des prairies, des forêts, des villes de brique rouge et de frondaisons dorées de mes aïeux, je me suis souciée des mânes d’une famille qui n’était pas la mienne, j’ai voulu laisser une trace de mon passage, non pas par vanité mais dans l’espoir que quelque chose survive à notre disparition.
Mais la cloche ne sonne plus, les visiteurs se font rares, le terrain autour s’est rapetissé, la chapelle reste bien seule sur sa parcelle. Elle est devenue un souvenir, un monument oublié à la mémoire d’une famille qui se perd elle aussi, lentement, dans le vacarme confus d’un nouveau siècle que je n’aurai pas connu. Je ne saisis pas tous les troubles et les difficultés de mes descendants, mais j’ai vu, de mes yeux aveugles de spectre, la fin d’un monde, dont la chapelle reste le témoin.
*
A la chapelle se sont mariés mes parents, et je conserve une série de photographies montrant un joyeux et désordonné cortège entourant le jeune couple, si beau, si frais, d’avant ma naissance, d’avant les drames, ma mère encore toute ronde de l’enfance qu’elle quittait à peine. Mais depuis qu’on ne l’utilise plus, la chapelle est désacralisée, et comme le diocèse n’encourage pas la fonction privée, il avait même fallu une dérogation spéciale de l’évêque pour pouvoir y célébrer le baptême des enfants de mon cousin, dernière cérémonie avant l’abandon.