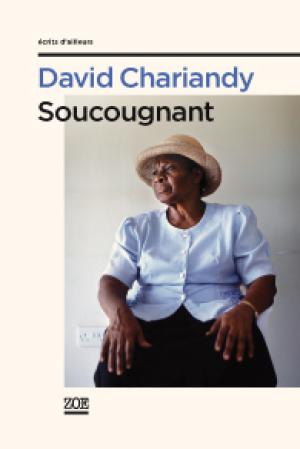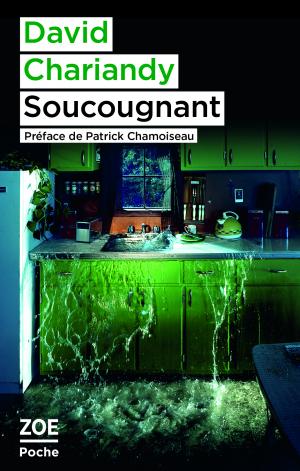parution mars 2012
ISBN 978-2-88182-857-7
nb de pages 240
format du livre 140 x 210 mm
Soucougnant
Traduit de l'anglais par Christine Raguet
résumé
Un fils retourne auprès de sa mère après l’avoir abandonnée. Deux ans sans la voir, sans l’entendre, sans la soutenir, sans l’aider, sans l’aimer ni la supporter. Sa mère souffre de démence sénile précoce. Elle oublie les choses, le sens des mots, celui des habits, qui sont les gens. Elle fait des recettes étranges et saupoudre la cuisine entière de farine ou de sucre. Aux moments de lucidité, elle sourit pour s’excuser, s’indigne qu’on la prenne pour folle.
Par la voix du fils, elle se souvient : son enfance dans la Caraïbe à laquelle elle s’agrippe, son arrivée jeune adulte au Canada, sa solitude de Noire parmi les Blancs, son mari caribéen comme elle, mais originaire d’Asie, qui l’aimait passionément; mais elle mélange. Elle confond son fils bien aimé avec sa garde-malade ou le prend pour son mari et l’embrasse furieusement sur la bouche.
Témoin bouleversé et pudique, le fils prodigue raconte l’érosion d’une femme, sa mère, dans une écriture précise et intense qui donne à cette histoire aux contours rudes une humanité lumineuse.
Né en 1969, David Chariandy a grandi près de Toronto. Il vit aujourd’hui à Vancouver, où il enseigne la littérature à la Simon Fraser University. Son premier roman, Soucougnant, (Zoé, 2012), l’a consacré parmi les principaux auteurs canadiens contemporains. Chariandy puise son inspiration au sein de la diaspora caribéenne au Canada et traite de son intégration à la culture locale.
La Quinzaine littéraire
"(...) une langue à la fois simple et puissante, concrète et poétique, obsessionnelle et parsemée dans la bouche de la mère de mots créoles qui, petit miracle, se fondent avec naturel et beauté à la texture de l'ensemble, créant un réseau d'émotions, un "tout-monde" selon l'expression d'Edouard Glissant." (Emmanuèle Sandron)
Livres critiques
« Soucougnant, un roman pudique et fort, a déjà été primé une dizaine de fois au Canada et dans la sphère anglophone (…). Autant d’ingrédients d’une lecture réussie ! »
Le Temps
"David Chariandy parle avec pudeur et force de la démence précoce de sa mère et de la vie des immigrants de Trinidad et Tobago" (Isabelle Rüf)
Soucougnant (poche) (2020, Zoé poche)
Après deux ans d’absence, un fils revient dans la maison de ses parents, en banlieue de Toronto. De la famille, il ne reste plus que sa mère, dont la mémoire s’érode. Une mémoire que le garçon va recueillir avec délicatesse : l’enfance à Trinidad, l’arrivée au Canada, sa solitude d’immigrée noire parmi les Blancs, l’histoire passionnée avec celui qui, caribéen comme elle, deviendra son mari.
Préface de Patrick Chamoiseau
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Christine RaguetDavid Chariandy a beau être né au Canada, une femme dans un restaurant éthique lui fait comprendre qu’il n’est pas ici chez lui. Même s’il a grandi dans ce pays pourtant réputé plus tolérant que les États-Unis, il y a été souvent traité de nègre.
Dans cette lettre ouverte qu’il adresse à sa fille de treize ans, il est question d’appartenance ; de ses ancêtres à lui, d’origines afro-asiatiques ; de son identité à elle, dont la mère est issue de la grande bourgeoisie canadienne blanche. Pas de hargne pour parler de la blessure du racisme, mais une lucidité, une pudeur et une tendresse qui font de ce texte important une invitation à se déterminer librement : un véritable manifeste dans la continuité de James Baldwin.
Traduit de l'anglais (Canada) par Christine Raguet33 tours (2018)
À Scarborough, on boit des bières au bord de la Rouge, on rêve d’Aisha, la fille la plus intelligente du lycée, on se bat avec les gangs rivaux. Ou alors, on se retrouve chez Desirea’s, qui tient autant du salon de coiffure que du night club. Michael et Francis, deux frères adolescents, mènent dans cette banlieue de Toronto une existence rythmée par les descentes de flics et le racisme ambiant. Ils n’ont jamais connu leur père et leur mère, Ruth, travaille nuit et jour pour leur donner une chance. Mais les espoirs de ces trois-là volent en morceaux lorsqu’une fusillade éclate, un jour d’été 1991.
33 tours est une histoire à haute tension, un hommage à l’art métissé du hip hop et un hymne à l’amour fraternel.
« Le roman le plus bouleversant que j’aie lu cette année » Dina Nayeri, The Guardian
Traduit de l'anglais par Christine RaguetSoucougnant: extrait
Elle est devenue une vieille femme. Elle regarde par la porte de sa maison, mais la scène semble la perturber, les ecchymoses du ciel du soir et la course de crabes que font les feuilles le long du rivage en dessous. Ce sont là les falaises qui bordent le lac à Scarborough. C’est là la saison que l’on nomme automne.
« Tu devrais entrer », dit-elle, cherchant la chaîne de sécurité, mais elle constate qu’elle est déjà défaite. C’est alors seulement qu’elle lève soudain les yeux pour croiser les miens.
Je me suis accroupi pour délacer mes chaussures, évitant le tabouret qui s’est toujours avéré indigne de confiance. Je suspends mon manteau à la patère imperceptible à côté du disjoncteur. Elle remarque ces gestes et ralentit, pensive, tandis qu’elle me conduit dans ce vestige de foyer. Les mêmes courants d’air et le même plancher qui grince, le même calendrier avec ses photos d’animaux sauvages et l’élan de septembre 1987, aujourd’hui vieux de deux ans. Dans la cuisine, elle installe la bouilloire sur un des feux et tourne le bouton du réchaud sur « on ». Ensuite elle vérifie encore une fois pour être sûre.
Le gaz a été coupé. Je le vois immédiatement et je sais que nous allons attendre en vain que la flamme s’allume ou que la bouilloire commence à grésiller avant l’ébullition. Elle se tait à cet instant et ses yeux baissés m’évitent. Un rythme caverneux semble émaner des lames du parquet et des chevrons, mais ce n’est que le lac qui a son mot à dire au beau milieu de notre paisible rumination. Ceci pourrait continuer encore longtemps. Tandis que le soleil poursuit son chemin et que les ombres s’épaississent autour de nous. Tandis que cette vieille femme, ma mère, est tellement peu disposée à admettre qu’elle m’a oublié. Tandis que nous deux sommes libérés de notre passé.
Voici ce que je fais.
Je me relève et défais ma ceinture. Je déboutonne mon pantalon, j’en descends la fermeture éclair et je le laisse tomber sur mes genoux. Manman ne rit pas en me voyant avancer vers elle d’un pas incertain en me dandinant comme un canard. Elle ne s’affole pas quand sa main est tenue et guidée jusqu’à la peau sombre d’un jeune homme.
Allez. Appuie tes doigts sur le morceau d’os en forme de noix qui est sur le côté de mon genou. Maintiens-les ainsi jusqu’à ce que mon genou fléchisse et qu’un tendon aberrant se bloque contre cette protubérance et sous tes doigts avant de soudain se détendre. Avec un bruit sec. Un truc propre à mon corps.
Son sourire.
– Il a des os bizarres. Ils font des désordres jusqu’au fond de sa chair, dit-elle.
– Ton fils…
– Sa gran-manman aussi. Tu ne peux rien les faire pour les os. Ils sont comme l’histoire. Mais tu peux faire un thé de feuilles zavocat pour soigner les douleurs de ton corps. Et de feuilles de plantain pour faire le sang couler moins vite. Et il y avait quelque chose qu’on appelait plante scientifique qui pouvait te protéger des malédictions et des quimbois…
– Ton fils. Ton plus jeune fils. Tu te souviens, manman ?
– De l’aloès sur les petites brûlures. Tout le monde se souvient de ça. Mais il y avait une autre chose. Une chose humide et puissante qu’ils pouvaient te donner quand tu avais de grandes brûlures. Quand ta peau sortait comme un gant…
Je reste avec manman, pourtant je n’ai pas vraiment été invité à rester. Cette première soirée après mon retour, manman quitte soudain la cuisine et gravit les escaliers jusqu’à sa chambre au deuxième étage. J’entends le grincement sourd du verrou. Plus tard, je monte dans l’autre chambre du deuxième étage. Les lits superposés que je partageais autrefois avec mon frère sont encore faits, même si les draps et les oreillers sentent l’humidité.
La fenêtre de ma chambre donne sur la crête érodée de la falaise, et au-delà, sur un grand lac effleuré par la lumière déclinante de la ville. En dessous, à plus de dix mètres, quelques arbres s’inclinent sur une berge sablonneuse et sur des détritus imbibés d’eau. Une danse de feuilles et les cabrioles d’un sac de chips vide. Malgré la vue et le fait que de nombreuses personnes considèrent cet endroit comme « un très bon quartier de Scarbourough », il nous est difficile d’être fiers de notre maison. Nous sommes les seuls au fond d’un cul-de-sac qui a jadis servi de décharge aux entreprises de construction immobilière. La maison est vieille et se prépare maintenant aux derniers assauts de l’érosion. Même l’été, toutes les fenêtres qui donnent au sud sont fermées. Parce que la voie ferrée est à moins de trois mètres.
Je suis réveillé en sursaut pendant la nuit. La maison est saisie d’une énergie brutale et des atomes de poussière ont transformé en masses compactes les rayons de lune qui s’immiscent par la fenêtre. Le vacarme atteint son paroxysme et ce n’est qu’alors qu’il me paraît évident que c’est un train de marchandises. J’attends que la voiture de queue soit passée et que les bruits du lac refassent surface. Je regarde le vent pousser des fantômes entre les rideaux. Je rêve, aux marges de l’éveil, des pas qui résonnent dans l’air au-dessus de moi.
Le matin, en entrant dans la cuisine, je tombe sur une jeune femme en train de lire un livre, assise à la table avec manman. Elle a les cheveux d’une extravagante couleur bronze, des cheveux frisés de métisse tout juste retenus par un élastique ; elle porte la chemise blanche à deux poches que manman avait l’habitude de me faire mettre pour les occasions exceptionnelles. Apparemment, elle a posé de la nourriture devant manman, du porridge de farine de maïs additionné de sucre et d’essence de vanille. Une théière d’un thé si fort qu’il semble tacher les tasses et attaquer les cuillères. En me voyant, elle se lève brusquement, sa main se portant instinctivement jusqu’à une marque sur son cou. Pendant un instant très bref, elle lit sur mon visage et sur mon corps avant de laisser retomber sa main et de se rasseoir.
« Je suis son fils », je dis.
Elle prend une cuillère pour offrir un peu de porridge à manman qui fait la moue sans que son visage bouge pour autant. Le livre est à présent ouvert sur la table, couverture apparente. Le mode diatonique en musique moderne, dit le titre. La marque sur son cou est rouge. Énigmatique sur le brun clair de sa peau, à l’arête de sa clavicule. Une marque de naissance, très certainement.
– Vous êtes infirmière ? Je ne suis qu’en visite. Je ne vais pas vous déranger.
– Comme c’est aimable à vous, réplique-t-elle.
Et puis elle m’ignore, pourtant ses yeux ont l’air perdus dans des pensées bien éloignées de ses tentatives ininterrompues de faire manger manman. Je fais un signe de tête et je m’en vais en silence ; je passe presque toute la matinée et l’après-midi dans ma chambre, à l’écart.
Dans la soirée, je suis seul dans le salon lorsque j’entends au-dessus de moi le couinement d’un robinet qu’on ouvre et le sourd grondement de l’eau dans la baignoire. J’entends deux voix et des clapotis étouffés, puis la jeune femme qui chante et manman qui se joint à elle sans hésitation, ni faille. Je veux en entendre davantage de ce chant et savoir comment manman réussit à tout si simplement retenir une chanson dans son état. J’attends que les bruits du bain et que les succions de la tuyauterie cessent, mais je vais à l’étage dans la chambre de manman bien avant qu’il ne soit tout à fait sans danger de le faire. Manman, torse nu, me fait face et la jeune femme est debout derrière elle, en train de la masser. Les yeux de manman sont clos et elle continue de fredonner de sa voix éraillée, tandis que la jeune femme, cachée à ma vue, malaxe sa chair. Les rides luisantes sur le haut des épaules de manman et sur son cou, signes avant-coureurs de la véritable dégradation de son corps. Il y a dans l’air et sur ma langue une consistance huileuse ; la nudité et l’intimité m’humilient un peu. Je me retourne pour partir, mais pas avant que la jeune femme ait perçu mon malaise et qu’elle ait souri malicieusement.
Je l’entends cette nuit-là. Impossible de se tromper cette fois-ci, la jeune femme dans le grenier. Le craquement de ses mouvements.