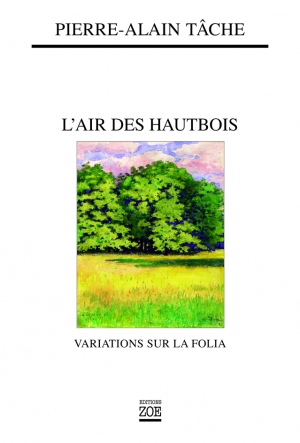L'Air des Hautbois
résumé
Une des plus anciennes mélodies d’Europe originaire du Portugal, la Folia, a connu son apogée d’abord en Espagne au XVIe siècle puis sur tout le continent. De nombreux musiciens s’en sont inspirés pour des variations célèbres, dont Corelli et Marin Marais.
Dans ces variations en prose, L’Air des hautbois agit comme un souvenir premier. Cette musique peut surgir n’importe où, dans la chapelle d’un village valaisan, au milieu d’un vignoble de la plaine du Rhône, au Pavillon Vendôme d’Aix-en-Provence lors d’un «distingué congrès de psychanalystes» où le hasard a conduit l’écrivain. Y a-t-il une relation entre la Folia et la folie ?
L’art de ce livre est de ne pas répondre mais de raconter l’histoire d’une mélodie qui a inspiré plus de cent musiciens tout en faisant vibrer l’univers intime d’un écrivain, comme si celui-ci cheminait avec son ami lecteur, échangeant avec lui ses goûts sur la littérature, la musique, les villes et la nature.
Pierre‑Alain Tâche, né en 1940, vit à Lausanne (Suisse). Juriste de formation, il est docteur en droit. Il fut magistrat judiciaire de 1981 à 2002 après avoir pratiqué le barreau pendant une dizaine d'années. Il se consacre désormais à l’écriture, tout en étant actif dans le mécénat culturel par le biais de diverses fondations. Il est l'auteur de plus d'une vingtaine de recueils de poésie, ainsi que de textes critiques.
L'Ombre d'Hélène (2015)
L’Ombre d’Hélène est une minutieuse élucidation du cheminement créatif lié à la relation incessante de Pierre-Alain Tâche à Hélène, personnage romanesque de Pierre Jean Jouve qu’il admire passionnément.
Au fil d’un texte à la fois introspectif et manifeste poétique, l’essayiste parcourt les étapes qui ont scandé ses échanges avec cet être imaginaire : sont examinés tour à tour son lieu d’origine, son statut sexué, sa dimension mythique, son existence comme métaphore de l’écriture poétique.
Enfin, Tâche ne pouvait que ponctuer son ouvrage par une invitation à la découverte de ses derniers poèmes appelés par la figure sacrée d’Hélène. Le recueil La fausse Morte se lit avec bonheur, en écho avec l’essai foisonnant qui précède.
L'Idée contre l'image (2013)
Le discours est entré dans l’art comme un ver dans le fruit. Tel est le constat de l’auteur qui visite, depuis longtemps, les musées et les expositions où s’affiche l’art contemporain. Le regard qu’il porte sur ce qu’il voit reste celui d’un amateur – et il tient à ce statut, souhaitant rester capable de comprendre l’œuvre en tant que ce qu’il est : un dilettante. Or, de plus en plus souvent, il se trouve confronté à des œuvres dont il faut avoir lu l’argumentaire pour espérer les voir vraiment et, peut-être, les comprendre. Leur part visible, alors, étouffe sous le texte, n’arrive plus à exister seule, échoue à donner un sens par elle-même. De quoi susciter quelques interrogations...
L'Air des Hautbois: extrait
À l’illuminée de la place d’Espagne
Komm lieber Wahnsin
Nimm mich hinweg in dein Reich
Da bin ich geschütz.
Beat Brechbühl
« Le livre dont j’écris ici les premières lignes, j’aimerais qu’il devienne quelque chose comme une mémoire – donc une fiction – rêveuse, qu’il soit une traversée d’images, de souvenirs, d’instants, qu’il ressemble à la rêverie à laquelle s’abandonne le dormeur éveillé, avant que l’excès de clarté n’y mette fin. Il sera bien temps alors d’affronter le jour. »
L’emprunt que je fais ici à J.-B. Pontalis est plus qu’une adhésion au projet, à l’espérance qu’il formule : il contient, en miroir, l’expression de la nostalgie d’un texte que je n’écrirai sans doute jamais, mais qui est sous-jacent à ma rêverie, depuis toujours ; il dit enfin cette « traversée » que j’aurai tout de même fini par tenter, comme un « dormeur » éveillé, oui, sachant qu’elle est peut-être un chemin vers l’ouvert où la poésie, parfois, s’invite.
Je voudrais que l’on trouve trace de ce temps d’avant « l’excès de clarté » dans ces pages nées d’une longue, d’une durable fréquentation de la folia, mais aussi d’une velléité sans cesse remise en question par un profond besoin d’évasion hors des réseaux auxquels ma pensée se sera soumise, pendant des décennies, autant par paresse que par nécessité. J’aurai à rendre compte, en amateur qui se voudrait éclairé, d’une petite mélodie, dont le mystère et le pouvoir restent intacts. J’ai voulu savoir d’où elle venait, ce qu’elle fut et ce qu’elle est devenue : je l’ai trouvée fraîche, intacte et vivante. J’escompte aussi de cette relation, qui ne saurait être à sens unique, qu’elle achève de me désentraver, qu’elle me délie, au gré de libres associations, de toute obligation de cohérence comme de la tentation ou, pire encore, de la prétention de faire sens à tout prix. Car j’ai rêvé depuis longtemps, contre le cours de mon destin d’homme de loi, d’écrire, à partir de presque rien, un texte affranchi des contraintes du récit, qui soit sans véritable commencement et qui puisse se conclure sans n’avoir rien démontré ; un texte, en somme, auquel on pourrait peut-être faire le magnifique reproche d’être sans queue ni tête et qui doive plus aux zones d’ombre qu’au plein jour.
Telle sera donc ma tentative de rêve « éveillé » qu’une musique intemporelle, vorace aussi, comme un feu de pinède, ponctuera d’éclats, d’embrasements imprévisibles, afin que parte en cendres, s’il se peut, le mensonge des genres, qui n’a jamais cessé d’en contrarier le cours.
FOLIA
Il y a, quand on regarde vers le sud depuis le quai 2 de la gare de Sierre où, je ne sais combien de fois, j’aurai, tout à la joie des retrouvailles, attendu l’arrivée d’un voyageur, un soufflé limoneux mal levé, de modeste dimension et comme dépourvu de l’élan soulevant jusqu’à la moindre aspérité du pays. On hésiterait, ainsi, à parler d’une colline ; mais j’imaginerais sans peine qu’un rêveur vaguement archéologue y situe les vestiges d’un tumulus, quand bien même il saurait qu’il s’agit, tout simplement, d’une petite éminence couverte de chênes nains. À la considérer distraitement, comme je le faisais jusqu’à tout récemment, il est difficile d’évaluer la distance à laquelle elle se trouve ; et sans doute est-elle, tour à tour, proche et lointaine, au gré des saisons et des jours.
J’ai fait vingt fois, au cours des ans, le projet d’escalader ce monticule ; mais, comme il se trouvait être, invariablement, à contre-jour, je finis par ne plus le voir vraiment, le laissant flotter dans un espace flou, incertain, où il en vint bientôt à se dépouiller de toute matérialité. Et puis, eût-il trouvé moyen de reprendre consistance dans mon esprit, j’eusse été bien en peine d’imaginer le temps qu’il me faudrait pour l’escapade que j’y projetais ; si bien qu’il m’eût paru, sans nul doute, hasardeux de quitter l’abri de la marquise au risque de voir filer le train dont l’arrivée imminente occupait, à vrai dire, tout mon esprit.
Un jour du printemps dernier, où l’air était, dès l’aube, d’une douceur et d’une transparence assurément propices à l’allégement du corps et de l’esprit, je me suis retrouvé dans le parking situé en face de la gare, de l’autre côté des voies, avec près d’une heure à tuer devant moi à la suite d’un banal concours de circonstances : j’avais trouvé porte close chez un excellent vigneron de Muraz, avec lequel, à chaque visite, je prévoyais le temps de partager un verre d’arvine en devisant courtoisement sur la qualité de la dernière récolte, sur l’état de la vigne et sur les travaux à venir. Le fait est que j’use peu souvent de ce vaste espace dévolu au stationnement et, quand cela m’arrive, je suis trop pressé de rejoindre le quai pour avoir jamais pris le temps de faire le plus sommaire état des lieux. Puis la compagnie retrouvée accapare, sans doute, toute mon attention. Il en allait tout autrement ce jour-là.
Je fus ébahi de constater que la butte dont j’évoque la paisible existence était plantée là, devant moi, à l’autre bout d’une surface asphaltée, au demeurant totalement déserte à cette heure. On eût dit un mur de fond, encore qu’elle m’apparût plutôt comme un décor contigu à l’espace où je me trouvais. Et c’est vrai qu’il n’y avait plus la moindre barrière – si l’on excepte quelques platanes, dont les feuilles projetaient au sol une ombre étroite – entre mon projet, si souvent différé, et ce petit mont noir, rond comme une montagne dessinée par un enfant. Il me semblait que j’aurais pu le trouer de l’index ou bien encore prendre toute sa masse dans une seule paume, comme je l’ai parfois fait d’un fruit prêt à tomber. Passé ce mouvement d’étonnement, j’eus bientôt, physiquement, le sentiment de me retrouver à pied d’œuvre ; et celui de ne plus pouvoir me dérober. C’était un peu comme si le monticule ne me laissait pas le choix de reculer ; on aurait pu croire (mais que sait-on de ces choses-là ?) qu’il voulait me contraindre à l’escalader. Je crois pourtant qu’il s’est agi d’un consentement mutuel. J’étais soucieux, en tous les cas, de ne pas perdre la face. C’est pourquoi je fis mine de céder volontiers à l’invite d’une touffe de primevères, à l’orée de la forêt naine. Sa touche acide me parut être le blanc-seing discret du hasard ou, peut-être même, une signature que le destin venait d’apposer au bas de notre accord muet.
En quelques pas, je fus sous le couvert des arbres, au flanc d’un bois malingre et tourmenté. Je ne tardais pas à m’apercevoir que le monticule était cerclé de sentiers qui le paraient de rangs étagés comme ceux d’un collier, l’enserrant de part et d’autre, et de telle manière que l’on était tout naturellement conduit à imaginer que leurs fils se rejoignaient sur le revers, à mi-hauteur, et peut-être même, ce qui resterait à vérifier, juste au-dessous de son point culminant. Il y avait aussi, sur l’ubac où je me trouvais engagé, deux ou trois volées de marches faites de rondins et de terre qui achevaient de quadriller tout l’espace. Le plan de ces chemins possibles n’avait rien d’un dédale : la clarté de sa géométrie permettait d’exclure le moindre cul-de-sac. Cela n’empêcha pas pourtant mon embarras, car je ne savais quel parti adopter. Fallait-il couper au plus droit vers la hauteur ou tenter un contournement sans doute moins éprouvant ? Je finis par opter pour la lenteur du détour, d’autant que, sur ma gauche, une trouée laissait espérer un coin de ciel bleu comme on en voit dans les lointains de Patinir. J’empruntai donc la première sente orientée vers l’est. D’une faible déclivité, elle était jonchée de feuilles mortes ; ce qui ne manqua pas de m’étonner : l’yeuse, en effet, perd les siennes à l’instant où les bourgeons les chassent de la branche. Or, les arbres, au-dessus de moi, étaient presque nus et je n’y devinais pas l’impatience violacée des jeunes pousses. « Ce ne sont donc pas des chênes verts, me dis-je, ou bien la sève neuve, encore discrète, vient d’affleurer – et tout l’ancien feuillage est tombé d’un seul coup. » (J’ai le vif souvenir d’un frêne se délestant ainsi de sa toison d’or, en un instant. Mais c’était en octobre.) On voit à quelles profondes réflexions j’occupais mon esprit ! Cet exercice, quoique d’apparence superficielle, aurait mérite de lui assurer une disponibilité dont j’allais avoir le plus grand besoin.
Je m’élevais ainsi, sans hâte aucune, vers la lumière, avec un sentiment d’accord qui n’est jamais, chez moi, sans se doubler d’une allégresse que je sais proche du regret mélancolique qu’elle engendre. L’œil détaillait, maintenant, un grand pan de montagne qui surplombe le bois de Finges. Et le bleu coulait, au-dessus, comme un miel d’acacia. Je fus bientôt, l’ayant contourné plus vite que je ne l’aurais pensé, sur le versant sud du petit mont, où sont des pins sombres et râblés, qui lui confèrent enfin l’apparence d’une colline – et même, d’une colline méridionale. Je ne fus pas surpris, en conséquence, détournant le regard des hauteurs, de me retrouver soudain nez à nez avec un lézard cuivré de belle taille. Le saurien goûtait à la chaleur printanière au bas d’un escalier de pierres sauvages, comme on en voit partout dans les vignes du Vieux Pays. Il était immobile et son cœur semblait battre par à-coups en soulevant la peau finement écaillée de son dos. Il me parut tout à la fois fragile et rayonnant d’une force souple et solaire. Ses yeux brillaient comme deux têtes d’épingle noire. Je ne sais combien de temps dura notre face-à-face, mais l’intensité de ce dernier parvint à me distraire de la vue qui s’ouvrait devant moi en direction de Chippis et de la vallée d’Anniviers. Ce dont, en revanche, je suis certain, c’est qu’il revint au lézard de rompre l’échange ; il s’était éclipsé à la vitesse de l’éclair. Si son image n’avait pas subsisté sur ma rétine, une infime fraction de seconde après sa disparition, j’eusse pu douter de sa réalité et, bientôt, me convaincre que j’avais imaginé cette rencontre panique.
Pour observer le reptile, je m’étais vivement retourné vers le nord, si bien que je me retrouvais maintenant face à la pente et près d’achever la manœuvre de contournement que j’avais entreprise. Il me suffit de lever les yeux, dans l’axe de l’escalier, pour apercevoir le sommet du monticule ; il était, de ce côté-ci, dégagé de toute végétation. Les multiples sentiers n’y convergeaient pas, comme je l’avais supposé. Ils se rejoignaient à mi-pente, dégageant, du même coup, tout l’espace au-dessus et lui conférant comme une affectation sacrée. Je me souviens avoir pensé aux degrés usés d’un temple aztèque.
Toujours est-il qu’il fallait maintenant achever l’ascension pour le plein accomplissement d’un projet trop longtemps différé. Mais j’obéissais aussi à quelque impératif ; et je le savais. J’eus tôt fait de gravir les dernières marches vers un petit tertre aménagé pour la contemplation du paysage. On y trouvait un banc et une pierre plate, dont je ne tardai pas à faire une table où j’aurais pu écrire. Mais je ne renonçai pas, pour autant, à prolonger ma première impression, en imaginant là je ne sais quel autel promis à la célébration de sanglants sacrifices. Je m’arrêtai pour reprendre mon souffle.
Le sommet était adossé à la lisière du petit bois de chênes nains. Étant donné que je me trouvais au point le plus élevé de la colline, il me parut tout naturel, en regardant au nord, d’apercevoir la gare à travers et au-delà des plus hautes frondaisons ; encore que n’ayant pas la foi du charbonnier, même pour ce qui relève de l’évidence aux yeux de tout un chacun, il s’agissait, là encore, d’un point que je fus heureux d’avoir vérifié. Comme je le fus aussi de réaliser que j’opérais de la sorte la jonction, désormais sûre, entre deux éléments du paysage. Ce point était donc acquis ; mais je ne pouvais ignorer que si j’étais monté jusqu’ici, c’était avant tout pour répondre à un appel plus profond, à une nécessité intérieure autrement plus pressante et, peut-être même, pour espérer percer un peu du mystère que propose ce qui nous demeure invisible. Ma curiosité, en effet, m’avait aussi porté depuis toujours (par quoi j’entends : depuis mon enfance) vers l’espace dérobé par la colline, dont l’arpenteur du quai numéro 2 ne sait et ne peut rien savoir, s’il n’est allé, un jour, au-delà du décor. Et c’est vrai qu’un rideau d’arbres crépus lui ferme le théâtre où vaticine son imaginaire.
Aussi ne tardais-je pas à me retourner. La vision qui m’attendait était imprévisible, incongrue – et propre à provoquer une sorte de stupéfaction. Je n’en croyais pas mes yeux et ce que je voyais me laissa, dans un premier temps, sans réaction. À mes pieds, au-delà des pins dont je surpassais maintenant les nœuds d’aiguilles sombres, s’étendait un cimetière, qui me parut immense. À tout le moins dans sa profondeur, car il était aisé de constater que sa largeur, assez modeste, n’excédait pas celle de la colline, ce qui explique, soit dit en passant, qu’il soit impossible d’en deviner l’existence depuis le quai. Au premier plan, des caveaux aux toits flanqués de tourelles, parfois ornés de créneaux, s’y dressaient si serrés qu’on eût dit une ville peinte en grisaille au fond d’une prédelle. C’était comme une involontaire et triste figuration de la Jérusalem céleste. Au-delà s’étageait, dans la puissante perspective, l’innombrable forêt des croix. De leur confrontation hirsute dans l’espace naissait un sentiment de désordre que je m’explique mal, connaissant le souci de belle ordonnance qui préside à l’organisation d’un tel lieu. On croyait voir une bousculade silencieuse, quand ce n’étaient sans doute que jeux funèbres de la lumière, illusion d’optique ou bribes d’une hallucination, dont je me remettrais bientôt – une bousculade dans un vide qui ne parvenait pas à faire croire qu’il était habité, l’immobile mouvement peinant à masquer une absence criante.
Il me fallut un certain temps pour me sentir hors d’atteinte. Entre le cimetière et moi, le tenant à distance, il y avait pourtant ce socle de pierre vive, de terre chaude, de troncs roux et poisseux, de plantes grasses où se concentre peu à peu l’huile d’une éternité colorée et mortelle. Et c’était là de quoi reprendre pied. Et puis, mon petit sanctuaire était résolument solaire ; et joyeusement païen. Il me donna force et volonté de resserrer tous ces morts dans le giron d’un regard libre, désormais, de porter beaucoup plus loin, au-delà du Rhône. Je pouvais aisément imaginer le tracé du fleuve pour l’avoir maintes fois longé à cet endroit, à l’autre bout du champ clos, et sans avoir jamais soupçonné la présence, en quelque sorte imminente, de la nécropole. Mais, depuis mon observatoire actuel, je ne pouvais apercevoir le cours tumultueux des eaux. Dans l’exact alignement du cimetière (ou peu s’en faut), on distinguait sans peine, en revanche, le débouché des gorges de la Navizence. De part et d’autre de la rivière, dans l’ombre qui leur conférait une autre densité et comme un poids de chair, deux levées de roche et de broussailles s’évasaient vers on ne sait quel corps, sinon que c’eût été, que c’était, maintenant, celui du val vivant que j’avais vu respirer imperceptiblement, au lever du jour, puis onduler sous la caresse du premier soleil. M’était offerte ainsi, dans son intimité secrète, humide, une faille nerveuse, musculeuse, d’où la vie surgissait à foison, dans un bouillonnement d’écume. La puissance métaphorique du réel était telle que je ne pouvais lui échapper. Et ce fut soudain comme si tout le chemin qui va de la naissance à la mort se frayait, sous mes yeux, un passage dans le paysage et s’y résumait à la surface de deux stèles superposées dont je fis, dans le même élan, des icônes ; comme si l’humaine destinée s’était résumée devant moi, puis concentrée dans ces deux images – et le resserrement des lieux aura manifestement favorisé ce raccourci. Je sus, dans l’instant même où je la recevais, que cette vision ne me laisserait plus en repos, bien qu’elle eût, d’un seul coup, dénoué le bandeau de son énigme.
Je piquai au plus court pour rejoindre la gare, non sans risquer tomber, plus d’une fois, dans le revers, tant la pente du sous-bois était glissante. J’étais en d’étranges dispositions, vidé de l’intérieur, mal à mon aise et très hésitant quant à savoir ce qu’il fallait penser de ce que je venais de vivre. Je ne voulais pas exagérer la portée de cette expérience, mais je ne pouvais pas non plus, dans le même mouvement, la passer par pertes et profits, ne pas en tenir compte. D’ailleurs, l’eussé-je souhaité, voulu, qu’il m’eût été impossible de m’en déprendre – et je le savais pour avoir vécu d’autres instants de même nature.
Je me retrouvai bientôt sur le quai, à ressasser le sentiment prégnant d’étrangeté que je venais d’éprouver. Je ne tardai pas à me sentir envahi par une nostalgie qui eût été totalement injustifiée s’il n’eût été patent qu’elle avait fortement affaire avec le sens même de ma vie. Elle se nourrissait de tout ce que je savais irrémédiablement perdu dans le surgissement de l’évidence que j’ai dite. Je compris que la gaîté des retrouvailles, qui ne suffirait pas à la masquer et encore moins à la dissiper, s’en trouverait ternie. Je gâcherais la fête et me montrerais, une fois de plus, sous le jour d’une humeur lasse, vaguement triste, dont je devine sans peine ce qu’elle peut avoir de détestable ou d’irritant pour mes proches. Celle qui allait venir d’un instant à l’autre, maintenant, pressentirait mon trouble. Nous nous connaissons trop bien l’un l’autre pour qu’il puisse en aller autrement. Et puis, je n’avais pas le moins du monde l’intention de lui en cacher la cause ; mais trouverais-je les termes justes pour l’évoquer sans trahir mes émotions, sans rendre le tableau ridicule ? Ce fut comme le début d’une mélancolie. Elle était née du spectacle du monde ; et je la savais étroitement accolée au sentiment aigu de la finitude.
Le train venu du lac en remontant le fleuve entrait en gare, maintenant. Et le vague à l’âme où j’avais sombré ondulait en une suite de sons très doux, familiers, en une succession d’accords convenant à la houle de mes sentiments et qui semblaient sourdre du plus intime de mes fibres. Je reconnus ma petite folia – et reconnaître, en l’occurrence, consiste à prendre peu à peu conscience de sa présence en moi, aussi discrète qu’insistante ; et c’est alors que je chantonne, à l’intérieur, en évitant de remuer les lèvres, pour ne pas trahir qu’elle m’habite ou pour ne pas l’effaroucher avant qu’elle ne s’en aille, comme elle sera venue, en me laissant, le plus souvent, réconcilié. Ma petite folia, qui ne me quitte jamais vraiment pour être là et me bercer, comme si j’étais son enfant, quand je perds pied ou bien courage.