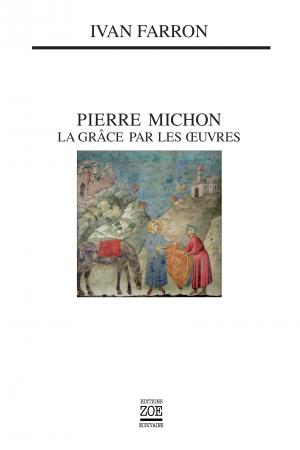parution janvier 2006
ISBN 978-2-88182-545-1
nb de pages 144
format du livre 140 x 210 mm
prix 27.00 CHF
Les Déménagements inopportuns
résumé
«Dans mon rêve, Hélène et moi longions un cours d’eau qui ressemblait au canal Saint-Martin et débouchait sur le lac de Zurich. Je reconnaissais la promenade de l’Utoquai et l’Opéra. Hélène me parlait d’un ton animé, mais je n’entendais pas ses paroles.
De telles confusions entre deux villes m’arrivent souvent, même à l’état de veille. Je traverse la Bahnhofstrasse et il me semble que je marche sur les Grands Boulevards, jusqu’à ce que l’étroitesse de la rue me ramène à la réalité. »
Ce court roman file la métaphore du déménagement, en suggère à la fois la tentation et la difficulté. Un homme quitte Zurich, où il réside, pour un court séjour à Paris dont il s’empressera de revenir. Il s’installe à l’hôtel dans sa propre ville et retourne parfois chez lui en cachette de sa femme. La perspective des fêtes de Noël en famille ne l’enchante pas. Sa solitude est le prétexte à de nombreuses réminiscences, le passé semblant l’emporter sur un présent peu engageant. La traversée de soi se décline sur le mode d'une errance dans les villes, mais aussi d'une promenade dans la mémoire littéraire et cinématographique. Au romanesque de la péripétie, ce texte substitue le récit poétique d'une aventure intérieure.
Ivan Farron est né en 1971 à Bâle. Après des études en Suisse et en Allemagne et quelques années de journalisme, il se consacre à l’enseignement et à la recherche universitaire et publie deux romans, dont Un après-midi avec Wackernagel (Zoé, 1995,prix Dentan). Il a dirigé un volume collectif consacré à Pierre Michon et est l’auteur d’études sur Bouvier, Larbaud, le roman policier et la psychanalyse.
Un après-midi avec Wackernagel (2014, Zoé poche)
Mais, malgré la précision de ses gestes, les surprenants projectiles n’avaient pas atteint le fleuve et leur atterrissage sur les grands arbres riverains avait démenti l’existence du pacte que Wackernagel prétendait désormais avoir conclu avec les éléments pour corriger les erreurs des hommes.
Ivan Farron a publié son premier roman, Un après-midi avec Wackernagel, à l’âge de 23 ans, en 1995. Ce monologue terrifiant, écrit par le narrateur le jour où son ami va sortir de l’hôpital psychiatrique, a valu à l’auteur une reconnaissance immédiate et forte. Le livre a reçu le Prix Dentan, la plus haute distinction littéraire suisse romande.
Ivan Farron a toujours vécu entre les cultures de langues allemande (Bâle, Zurich), et française (Lausanne), son style a évoqué d’emblée celui de Thomas Bernhard.
Né en 1945 dans la Creuse, Pierre Michon est considéré aujourd’hui comme un des plus grands écrivains français. Dès les Vies minuscules, paru en 1984, s’imposait une langue intense, chargée d’électricité poétique, saturée d’un classicisme à la fois vénéré et bouffonné, pour dire le petit et l’indigne, célébrer des vies infâmes avec les apprêts du grand style et sur le mode de l’hagiographie. Nourrissant un dialogue avec la critique littéraire ainsi que l’histoire de l’art, l’œuvre de Michon interroge anxieusement l’émergence de ses propres conditions de possibilité. Van Gogh, Rimbaud, Balzac, Faulkner et d'autres figures tutélaires, évoquées dans les Vies minuscules, font l'objet de volumes ultérieurs. Comment devient-on un grand auteur, un grand peintre ? La question est d’autant plus aiguë que, pour Michon, la littérature a été d’abord idéalisée. La possibilité d’écrire ou de peindre apparaît dès lors comme un miracle et est assimilée au salut.
Dans cette première monographie consacrée à Pierre Michon, l’auteur met en lumière l’itinéraire d'une œuvre encore en devenir. Il interroge les manières dont elle met en scène de nouvelles configurations narratives, qui font reculer les frontières des genres littéraires. Se penchant sur la question, cruciale pour Michon, de la filiation, il convoque la psychanalyse et la sociologie pour en montrer les implications. Plus qu'à une improbable réalisation définitive, la notion théologique de Grâce par les Œuvres désigne un des rêves qui animent cette entreprise littéraire parmi les plus singulières de notre temps.
Les Déménagements inopportuns: extrait
1
Ma décision avait été prise sur ce qui ressemblait fort à un coup de tête, même si je crois qu’elle se préparait en moi depuis longtemps. Le soir, j’avais profité de l’absence d’Hélène, partie au concert, pour emballer rapidement quelques affaires. Sur le chemin de la gare, je repensais à mon premier départ pour Paris à dix-sept ans, avec des rêves d’amour et Glenn Miller en tête. Je portais alors un trench coat crème à la Bogart que j’avait trouvé aux puces et dont les manches élimées étaient trop longues. L’imperméable vert bouteille et à la bonne taille de maintenant, la Samsonite qui avait avantageusement succédé au sac de voyage en simili cuir, je les aurais volontiers échangés contre quelques kilos en moins.
J’avais pensé à la réaction d’Hélène quand elle se rendrait compte de mon absence. Cela faisait longtemps que nous n’allions plus au concert ensemble. Chaque fois, j’exigeais d’elle une relation détaillée. Comment tel violoniste avait-il abordé le mouvement lent du concerto de Beethoven ? La soprano coloratur portait-elle une robe rouge ? En général, je me souvenais des œuvres exécutées. Hélène constaterait que la porte d’entrée était fermée à clé, mais pas de l’intérieur. Notre appartement comportait peu de meubles, juste le strict nécessaire. Devant l’énigme et la douleur de mon absence, le spectacle de ces quelques meubles lui semblerait peut-être insupportable, et elle tournerait en rond toute la nuit dans le salon en fumant cigarette sur cigarette.
Passage d’un pays à l’autre. Les lumières aperçues au loin depuis la fenêtre de mon compartiment appartenaient à des maisons françaises. J’ai béni l’existence des frontières, qui nous permettent de sortir, un peu, de nous-mêmes. Même le bruit des essieux me semblait d’une autre nature. Mon passeport et mon billet étaient entre les mains du contrôleur, je n’avais à m’occuper de rien. Je suis allé fumer dans le couloir. Ce geste nous réunissait peut-être maintenant, Hélène et moi. Il lui suffisait d’allumer une cigarette quand elle attendait l’autobus pour qu’il arrive après quelques bouffées, m’avait-elle expliqué. Espérerait-elle me faire revenir par le même moyen ?
Un rêve récent m’était resté en mémoire. Je me promenais à Paris avec Hélène et lui montrais la ville. Lorsque nous y étions allés ensemble il y a deux ans, son bras, accroché en permanence au mien, témoignait du plaisir qu’elle prenait à se laisser guider. Saint-Eustache, rue Montorgueil, rue de Cléry et le théâtre Antoine pour un Pirandello vite oublié. Nous étions arrivés en retard. Bien plus que des vertiges identitaires évoqués dans la pièce, je me rappelle du regard offusqué du portier, un Noir immense dont l’index posé sur ses lèvres nous exhortait au silence, tandis qu’il nous menait à pas feutrés à nos places. La très belle et très inutile porte Saint-Denis nous plaisait beaucoup. Dans mon rêve, Hélène et moi longions un cours d’eau qui ressemblait au canal Saint-Martin et débouchait sur le lac de Zurich. Je reconnaissais la promenade de l’Utoquai et l’Opéra. Hélène me parlait d’un ton animé, mais je n’entendais pas ses paroles.
De telles confusions entre deux villes m’arrivent souvent, même à l’état de veille. Je traverse la Bahnhofstrasse et il me semble que je marche sur les grands boulevards, jusqu’à ce que l’étroitesse de la rue me ramène à la réalité. À un moment du rêve, le visage d’Hélène était remplacé par celui d’une Jacqueline légèrement vieillie. Ce visage était un pur produit de mon imagination onirique, car je ne l’ai plus revue depuis l’époque où elle vivait à la rue du Château-d’Eau.
C’est l’envie de revoir cette rue qui m’avait donné l’impulsion du départ. Au moment de boucler ma valise, j’avais regretté ma décision. À Rome ou à Vienne, villes que je connaissais peu, la possibilité du neuf et de l’inattendu aurait été bien plus grande qu’à Paris où, devant un décor su par cœur, je ne ferais que ressasser des souvenirs. C’est pourquoi j’avais très sciemment oublié de prendre avec moi mon plan par arrondissement et la nouvelle adresse de Jacqueline, manière de résister à mes penchants passéistes et de m’ouvrir à l’éventualité de surprises auxquelles je ne croyais pas vraiment dans le fond, mais alors, du coup, pourquoi entreprendre ce voyage ?
2
Je me suis réveillé dans ma chambre d’hôtel en fin de matinée. Mes pas m’ont porté vers le Marais. L’hôtel où je séjournais n’était pas très éloigné de la rue du Château-d’Eau, mais une sorte de superstition m’en éloignait. J’aime la rue Vieille-du-Temple qui m’évoque les juifs coiffés de feutres verts des poèmes d’Apollinaire. Un attaché de presse proche de Jacqueline – il s’appelait Alain Ayache – nous avait invités un soir à manger chez lui, pas très loin d’ici. Nous étions sortis de chez Jacqueline sous la pluie et avions pris la rue de Lancry. C’est moi qui tenais le parapluie. Près de la République, Jacqueline m’avait montré le siège d’un quotidien célèbre. Elle aurait voulu quitter l’enseignement, qu’elle n’aimait pas, pour se consacrer définitivement au journalisme. Je trouvais quant à moi ses articles un peu laborieux, sans oser le lui dire.
Le Marais était rempli de gens pressés en quête de cadeaux de Noël. J’ai bu un café dans un bar-tabac de la rue des Francs-Bourgeois. Aurais-je dû prendre avec moi les coordonnées de Jacqueline ? Même si j’appelais un des journaux auxquels elle collaborait, nous étions samedi et je ne trouverais sans doute pas les gens qui auraient pu me renseigner. Je l’avais rencontrée au festival d’Avignon, à l’époque où moi aussi je faisais des piges. Quelques semaines et de nombreux coups de fil plus tard, elle me proposait de me prêter son appartement pendant ses vacances en Turquie. J’avais habité là plusieurs jours, prenant exagérément soin de tout, car je ne voulais laisser aucune trace de mon passage. L’après-midi, je traînais sur les grands boulevards. Par la suite, j’étais souvent revenu ici, mais pour y rejoindre Jacqueline.
Avant de la rencontrer, j’étais toujours allé à l’hôtel lors de mes séjours à Paris. Enfin, presque toujours. À dix-huit ans, j’avais séjourné pendant deux semaines près de l’avenue Trudaine. Le fait d’habiter un authentique appartement parisien me semblait alors un événement important. J’étais là en vacances avec mon ami Gaspard Sutter, invité par des proches de ses parents. Leur fille, Bérangère, avait le même âge que nous et fréquentait une école d’attachés de presse.
Lorsque j’avais mangé chez Alain Ayache, il avait évoqué ses années passées dans cette école, où, un soir, j’étais allé chercher Bérangère avec Gaspard Sutter. Fasciné par le monde du spectacle, Alain Ayache avait grandi en banlieue, à Pantin ou à Bobigny. Tout petit déjà, il était fasciné par les stars qu’il voyait le samedi soir à la télévision. À défaut de lui apporter la gloire et la fortune, son métier l’avait au moins amené à en côtoyer quelques-unes de près. Il devait avoir l’âge de Bérangère, mais je n’avais pas osé lui demander s’il la connaissait, car je l’avais perdue de vue depuis ces vacances avec Gaspard Sutter et ne m’autorisais pas à en parler comme d’une amie.
J’avais fait la connaissance de Bérangère à l’occasion d’un nouvel an chez les Sutter. Elle m’avait gentiment proposé d’accompagner Gaspard la prochaine fois qu’il viendrait lui rendre visite à Paris. Habitait-elle toujours ici ? J’aurais pu me lever et aller chercher son numéro dans l’annuaire. Il y a quelque temps, j’avais fait la réflexion à Hélène que la téléphonie mobile avait modifié nos habitudes au point que nous apprenions de moins en moins de numéros par cœur. Il suffisait de les inscrire dans la mémoire de l’appareil pour les en extraire au moment voulu.
Peu avant de partir à Paris avec Hélène, j’avais écrit à Jacqueline pour lui proposer un rendez-vous. Elle n’avait pas répondu à ma lettre, et j’avais imaginé qu’elle était encore fâchée contre moi. J’étais allé sous ses fenêtres à l’insu d’Hélène, sans savoir encore qu’elle avait déménagé. La lettre m'était revenue, munie d’un autocollant indiquant que sa destinataire n’habitait plus à cette adresse. Grâce à une Demoiselle du téléphone à voix numérique et aux pages blanches de l’Internet, j’avais constaté ensuite que Jacqueline n’était inscrite ni à Paris ni dans le reste de la France. Pendant de longs mois, j’avais vécu dans l’idée qu’elle était peut-être morte, jusqu’au jour où une inconnue m’avait téléphoné. Cette femme me dit être une amie de Jacqueline et habiter Zurich, comme moi. Elle m’avait proposé de rejoindre une troupe de théâtre francophone locale, mais ce n'était sans doute qu'un prétexte pour jouer les émissaires. J’avais appris ainsi que Jacqueline habitait désormais près des Buttes-Chaumont avec son nouveau compagnon.
3
La mère de Bérangère était venue nous chercher à la gare de Lyon. Nous avions remonté le boulevard Sébastopol à toute vitesse. C’était la première fois que je traversais Paris en voiture. J’avais été frappé de la manière dont cette ville s’ordonne différemment dans l’espace suivant qu’elle est parcourue à pied ou en voiture, quelles diverses gradations en font changer l’aspect. Je n’ai pas le permis de conduire.
Le souvenir d’un trajet automobile consécutif à une soirée passée chez des amis de Jacqueline se confond avec celui-ci. Un autre invité nous avait ramenés. Durant la soirée, bien arrosée, la conversation avait glissé sur les juifs français et ce goût proverbial du secret qui les éloignait du reste de leurs compatriotes. Jacqueline n’avait presque pas ouvert la bouche. Nous avions pris les voies express qui longent la Seine. La maison de la Radio et la tour Eiffel étaient illuminées. Je n’avais jamais traversé Paris à une telle vitesse. À cet instant, j’avais eu envie de tout plaquer et de m’installer ici avec Jacqueline. Nous serions allés nous promener le dimanche au Luxembourg. Finalement je n’étais pas allé à Paris mais à Zurich, où j’avais rencontré Hélène.
J’avais payé mon café et repris mes pérégrinations, passant devant l’architecture tubulaire qu’avait fait ériger cet homme politique dont j’avais lu enfant la mauvaise anthologie de poésie française. J'étais venu la première fois dans le quartier avec deux camarades de classe. Nous logions à l'hôtel Henri IV, place Dauphine. André Breton évoque cet établissement dans Nadja, dont quelques exemplaires en poche étaient exposés à la réception. L’hôtelier, une sorte de poussah barbu, avait failli nous mettre à la porte une nuit où nous étions rentrés très tard en hurlant dans l’escalier. J’éprouve une certaine nostalgie pour la bêtise enthousiaste et candide qui nous portait alors.
Ma promenade de maintenant ressuscitait l’adolescent d’autrefois, incontestablement plus attiré par la rive gauche que par la rive droite. Le temps s’était un peu réchauffé. J’ai acheté le Pariscope. L’Arrangement d’Elia Kazan au Ciné Actions Écoles. Je me rappelais le personnage joué par Kirk Douglas quand il ignorait ostensiblement les collègues de travail venus lui rendre visite après son accident de voiture. Je n’en étais sans doute pas à ce point, malgré mon goût pour les individualistes qui se soustrayaient à la société, écrivains aventuriers ou amateurs de corrida.
Hélène devait se faire du souci. Elle essaierait de m’appeler et entendrait sonner l’appareil dans la poche intérieure de mon veston brun rayé. J’avais raconté une fois à Jacqueline comment j’étais parti tout seul à Paris à vingt-deux ans, après un chagrin d’amour, passant trois jours enfermé dans les salles obscures du Quartier Latin à regarder film sur film. Quand je sortais du cinéma, j’avais l’impression de quitter le monde réel pour une fiction désespérante. Qu’allais-je faire ce soir ? Revoir L’Arrangement, que j’avais déjà vu si souvent ? Mes mauvais pressentiments d’avant le départ se confirmaient. Je perdais mon temps ici à la recherche de souvenirs enfouis et, surtout, sans personne avec qui les partager : autant donc rentrer à Zurich.
Sur le chemin de la gare de l’Est, je passerais par la rue du Château-d’Eau, soigneusement évitée auparavant durant ma promenade. J’ai salué l’ancien immeuble d’Hélène avec moins d'émotion que je ne l’aurais imaginé. Les brasseries ne manquent pas dans le quartier. J’en ai choisi une au hasard. Manger ici était dépourvu de tout charme, surtout quand les beuglements de Johnny Hallyday et la distraction du garçon oubliant une première fois la commande résonnaient comme autant d’offenses supplémentaires infligées à une solitude dont j’avais l’impression qu’elle aurait dû, au contraire, susciter un respect compatissant. J’ai hésité à commander un tartare, anticipant la portion congrue et vaguement dégoûtante que l’on balancerait sur ma table, flanquée de son jaune d’œuf et de ses condiments, avant de finalement opter pour un steak frites saignant.
La viande était tendre, les frites croquantes. Je me sentais comme un voyageur de commerce entre deux trains. Et si ma valise avait contenu un de ces miraculeux mixeurs-broyeurs dont les camelots démontrent les mérites dans les foires, accompagnant leur boniment des gestes précis qui substituent la lame au fouet, râpent la carotte avant de la disposer dans l’habitacle d’où elle va ressortir en jus ? Cette parole performative ne m’était pas échue, et c’était dommage, car les mines amusées de spectateurs forains m’auraient définitivement tiré du marasme, parachevant ce que les ingrédients du repas avaient déjà bien entamé. Après une courte promenade digestive aux alentours de la gare, je suis monté dans mon train presque de bonne humeur.