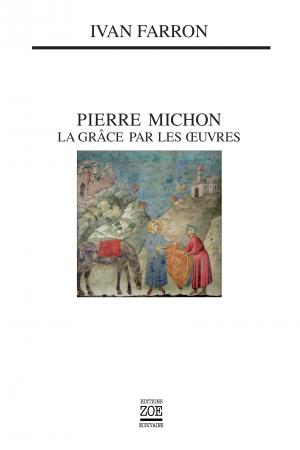parution juin 2014
ISBN 978-2-88182-921-5
nb de pages 96
format du livre 105 x 165 mm
Un après-midi avec Wackernagel
résumé
Mais, malgré la précision de ses gestes, les surprenants projectiles n’avaient pas atteint le fleuve et leur atterrissage sur les grands arbres riverains avait démenti l’existence du pacte que Wackernagel prétendait désormais avoir conclu avec les éléments pour corriger les erreurs des hommes.
Ivan Farron a publié son premier roman, Un après-midi avec Wackernagel, à l’âge de 23 ans, en 1995. Ce monologue terrifiant, écrit par le narrateur le jour où son ami va sortir de l’hôpital psychiatrique, a valu à l’auteur une reconnaissance immédiate et forte. Le livre a reçu le Prix Dentan, la plus haute distinction littéraire suisse romande.
Ivan Farron a toujours vécu entre les cultures de langues allemande (Bâle, Zurich), et française (Lausanne), son style a évoqué d’emblée celui de Thomas Bernhard.
Ivan Farron est né en 1971 à Bâle. Après des études en Suisse et en Allemagne et quelques années de journalisme, il se consacre à l’enseignement et à la recherche universitaire et publie deux romans, dont Un après-midi avec Wackernagel (Zoé, 1995,prix Dentan). Il a dirigé un volume collectif consacré à Pierre Michon et est l’auteur d’études sur Bouvier, Larbaud, le roman policier et la psychanalyse.
Le matricule des anges
« (…) Un texte écrit dans une langue cyclique, dont la puissance hypnotique, alliée à une approche particulièrement désenchantée du réel ne sera pas sans évoquer Thomas Bernhard. (…) » Guillaume Contré
"Ivant Farron nous livre un récit fort qui illustre parfaitement la puissance d'une amitié et l'attachement aux personnes qu'on aime. Un texte court, une grande découverte." Cyrille
Les Déménagements inopportuns (2006, domaine français)
«Dans mon rêve, Hélène et moi longions un cours d’eau qui ressemblait au canal Saint-Martin et débouchait sur le lac de Zurich. Je reconnaissais la promenade de l’Utoquai et l’Opéra. Hélène me parlait d’un ton animé, mais je n’entendais pas ses paroles.
De telles confusions entre deux villes m’arrivent souvent, même à l’état de veille. Je traverse la Bahnhofstrasse et il me semble que je marche sur les Grands Boulevards, jusqu’à ce que l’étroitesse de la rue me ramène à la réalité. »
Ce court roman file la métaphore du déménagement, en suggère à la fois la tentation et la difficulté. Un homme quitte Zurich, où il réside, pour un court séjour à Paris dont il s’empressera de revenir. Il s’installe à l’hôtel dans sa propre ville et retourne parfois chez lui en cachette de sa femme. La perspective des fêtes de Noël en famille ne l’enchante pas. Sa solitude est le prétexte à de nombreuses réminiscences, le passé semblant l’emporter sur un présent peu engageant. La traversée de soi se décline sur le mode d'une errance dans les villes, mais aussi d'une promenade dans la mémoire littéraire et cinématographique. Au romanesque de la péripétie, ce texte substitue le récit poétique d'une aventure intérieure.
Pierre Michon. La grâce par les oeuvres (2004, domaine français)
Né en 1945 dans la Creuse, Pierre Michon est considéré aujourd’hui comme un des plus grands écrivains français. Dès les Vies minuscules, paru en 1984, s’imposait une langue intense, chargée d’électricité poétique, saturée d’un classicisme à la fois vénéré et bouffonné, pour dire le petit et l’indigne, célébrer des vies infâmes avec les apprêts du grand style et sur le mode de l’hagiographie. Nourrissant un dialogue avec la critique littéraire ainsi que l’histoire de l’art, l’œuvre de Michon interroge anxieusement l’émergence de ses propres conditions de possibilité. Van Gogh, Rimbaud, Balzac, Faulkner et d'autres figures tutélaires, évoquées dans les Vies minuscules, font l'objet de volumes ultérieurs. Comment devient-on un grand auteur, un grand peintre ? La question est d’autant plus aiguë que, pour Michon, la littérature a été d’abord idéalisée. La possibilité d’écrire ou de peindre apparaît dès lors comme un miracle et est assimilée au salut.
Dans cette première monographie consacrée à Pierre Michon, l’auteur met en lumière l’itinéraire d'une œuvre encore en devenir. Il interroge les manières dont elle met en scène de nouvelles configurations narratives, qui font reculer les frontières des genres littéraires. Se penchant sur la question, cruciale pour Michon, de la filiation, il convoque la psychanalyse et la sociologie pour en montrer les implications. Plus qu'à une improbable réalisation définitive, la notion théologique de Grâce par les Œuvres désigne un des rêves qui animent cette entreprise littéraire parmi les plus singulières de notre temps.
Un après-midi avec Wackernagel (1995, domaine français)
Un après-midi avec Wackernagel: extrait
C’était ce samedi d’arrière-automne, le dernier avant l’hiver, que le corps médical de la clinique psychiatrique et universitaire avait destiné à être le jour de sortie définitive de mon ami Wackernagel, après six mois de traitement complet, six mois pendant lesquels Wackernagel, certainement assommé par les médicaments qu’on lui aurait fait quotidiennement ingurgiter, n’avait reçu aucune visite, m’avait-il dit au téléphone ; ni celle d’un membre de sa famille, avec laquelle il avait de toute manière rompu depuis plusieurs années ; ni celle d’un ami, ce qui avait dû l’assommer encore davantage que les médicaments, car, si ses amis se comptaient sur les doigts de la main, ils avaient toujours été fidèles à Wackernagel dans les moments difficiles de sa vie ; ni même la mienne, alors que, parmi ces amis fidèles, je passais pour être celui qu’une complicité très particulière unissait à Wackernagel ; et, vu mon infidélité à son égard, j’avais été plutôt surpris de recevoir ce coup de téléphone inopiné qui me demandait de l’attendre le samedi suivant – il m’appela trois jours auparavant – à dix heures et demie, sur un des bancs de la petite terrasse qui surplombe le fleuve près de la cathédrale. Son départ de la clinique psychiatrique et universitaire avait été soigneusement planifié, m’avait-il encore dit au téléphone, de longues et hésitantes délibérations entre les membres du corps médical de la clinique psychiatrique et universitaire avaient été nécessaires pour aboutir au choix de la date et de l’heure de son départ, respectivement ce samedi et dix heures du matin, heure dont la mention me troubla à un tel point – car elle impliquait que Wackernagel n’aurait à sa disposition que trente minutes pour venir me rejoindre, jugées d’ailleurs par lui amplement suffisantes pour aller de la clinique psychiatrique et universitaire à la cathédrale – qu’elle me fit insister pour que nous repoussions notre rendez-vous jusqu’à onze heures. Cette proposition se heurta tout d’abord au refus de Wackernagel, puis il avait fini par l’accepter en ronchonnant un peu. Une heure lui laisserait le temps de prendre le bus qui s’arrête près de la clinique psychiatrique et universitaire, jusqu’à une station située au centre de la ville ; là, de changer de trottoir et – vraisemblablement après un léger temps d’attente – de grimper dans le tram qui le mènerait au bord du fleuve, à l’endroit où une rue en déclive, que Wackernagel monterait peut-être avec peine, se hisse en direction de la cathédrale. Je savais que, pendant son internement, Wackernagel avait perdu l’habitude des bruits et des coutumes de la ville (et peut-être même que son séjour entre les murs de la clinique psychiatrique et universitaire l’avait dépossédé de la simple connaissance des lieux, pensais-je, l’empêchant de se repérer aisément dans la ville, le privant de ce réseau de multiples coordonnées que nous utilisons inconsciemment chaque jour, pour nous rendre d’un point à un autre d’une agglomération familière). De là, mon insistance – répétée au téléphone, malgré les protestations de Wackernagel (car sans doute en devinait-il les causes, et sa fierté refusait de les admettre comme fondées) – pour que nous ne nous voyions qu’à onze heures, ce qui lui laissait une heure pour venir me rejoindre, pendant laquelle il aurait loisir de s’assurer qu’il devait descendre à tel arrêt des transports publics et non à tel autre, une heure qui lui permettrait de se réacclimater aux lieux de la ville, d’en établir une topographie sommaire, un plan qui, bien qu’encore incomplet et approximatif, l’aiderait à dissiper un peu l’épais brouillard intérieur qu’auraient fini par créer ces six mois où il avait été coupé du monde.
Le coup de téléphone m’avait ébranlé à un tel point que je passai les trois jours qui me séparaient du rendez-vous dans un état d’extraordinaire excitation où se mêlaient la peur, la joie, un sentiment aigu de culpabilité, mais aussi l’impression que, peut-être, cette rencontre dénouerait les conflits qui menaçaient notre amitié ; et il est étonnant que, dans un tel état, enfermé chez moi, les volets hermétiquement clos, dormant à peine alors que je restais étendu sur mon lit toute la journée, je sois parvenu à rassembler suffisamment d’énergie pour me convaincre qu’il me fallait absolument aller à ce rendez-vous malgré toutes mes réticences, et que je n’avais pas le droit d’abandonner mon ami Wackernagel dans un moment si difficile de son existence, sa sortie de la clinique psychiatrique et universitaire. Je prévoyais de passer les deux heures précédant notre rencontre à mon bureau des archives cantonales – situé tout près de la cathédrale –, deux heures qu’afin d’occuper mon esprit d’un autre sujet que Wackernagel je consacrerais au rangement de quelques dossiers, mais je ne peux prétendre avoir exécuté ce programme aussi bien que je l’aurais souhaité car, si je réussis, ce matin-là, à aller à mon bureau, les dossiers en revanche ne sollicitèrent guère mes pensées, requises presque toutes par la personne de Wackernagel, par les difficultés qu’il aurait – de cela, j’étais presque sûr – à se réorienter dans la ville, à revoir les lieux qu’il avait quittés plusieurs mois auparavant pour cette destination insolite (j’associe toujours les lettres qui la désignent au vert pâle et trouble d’une lumière artificielle répandue sur un fond d’endormissement thérapeutique) qu’était la clinique psychiatrique et universitaire. J’avais peur de revoir Wackernagel dans un état épouvantable, abattu par les médicaments que les blouses blanches spécialisées lui auraient sans doute administrés en doses éléphantesques, et par les conditions pénibles, voire inhumaines, dans lesquelles il aurait vécu cet isolement forcé ; sans compter une probable rancune de sa part à mon égard, due au fait que je n’étais jamais allé le voir à la clinique psychiatrique et universitaire. D’autre part, il était possible que son séjour ait modifié l’attitude de Wackernagel à l’égard de tous les êtres, même à celui d’un excellent ami (mais de quel droit m’attribuais-je ce privilège ?) d’une telle manière qu’il ne manquerait de me surprendre par son comportement, provoquerait une attitude fausse et des réponses malvenues de ma part, qui risqueraient d’irriter Wackernagel, de lui refléter l’image d’un monde trompeur, précipitant peut-être Wackernagel à nouveau dans la confusion et, dans le pire des cas, suscitant un nouvel internement à la clinique psychiatrique et universitaire. La première de ces deux causes avait certes en soi de quoi me tarabuster, mais la seconde, quand je regardai non plus les effets qu’elle pourrait avoir sur Wackernagel, mais bien ceux qu’elle risquait de déterminer sur ma personne, se révéla à son tour absolument terrifiante, éveillant ma peur de voir Wackernagel dans un état bien pire que je l’aurais imaginé, d’en être affecté au point de ne pouvoir le supporter, de m’évanouir peut-être, d’avoir un malaise, ou encore de rester pétrifié sur la petite terrasse, paralysé par une peur incontrôlable qui ne me quitterait plus par la suite, me ferait perdre ce qui me reste d’équilibre et finirait par me conduire à mon tour à la clinique psychiatrique et universitaire. Devant cette succession de pensées effrayantes, je n’avais pu terminer le travail que je m’étais assigné, ni même l’entamer sérieusement, et, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit, j’avais quitté les archives cantonales à onze heures moins le quart précises.